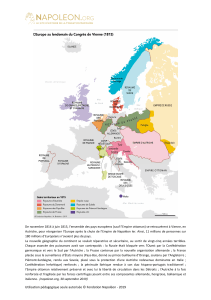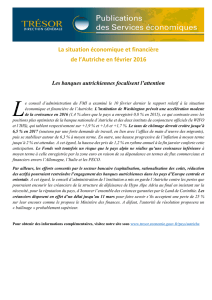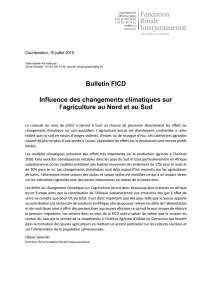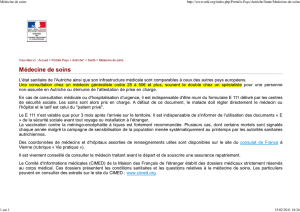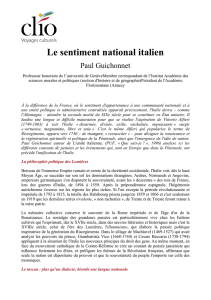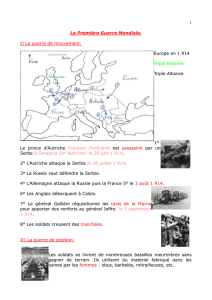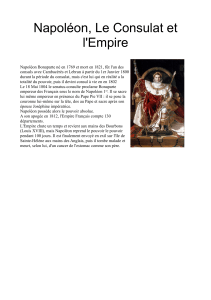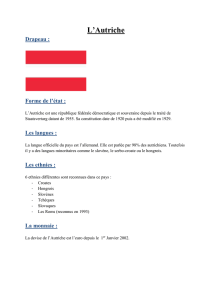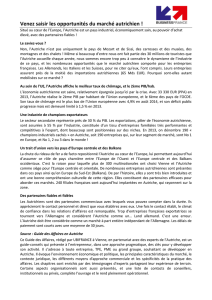La guerre, c`est la paix / par Anatole de La Forge

La Forge, Anatole de (1821-1892). Auteur du texte. La guerre,
c'est la paix / par Anatole de La Forge. 1859.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter


LA GUERRE
C'EST LA PAIX

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%