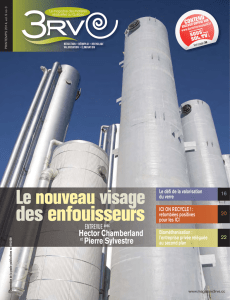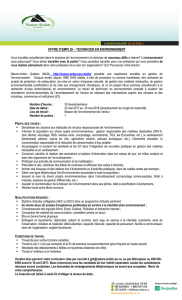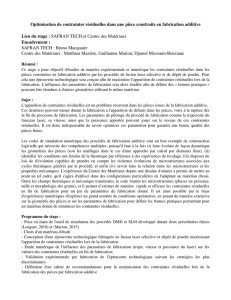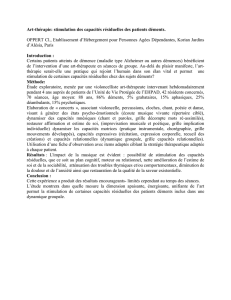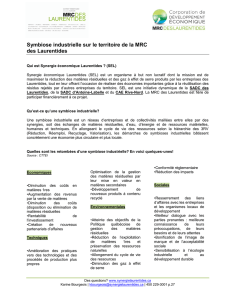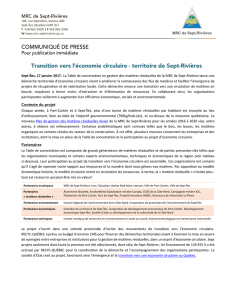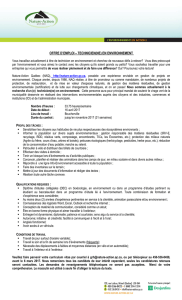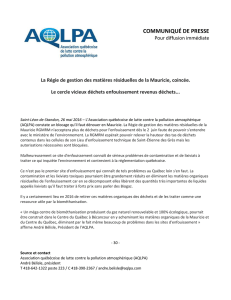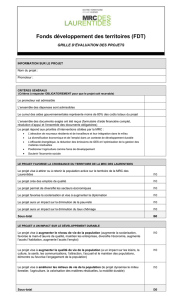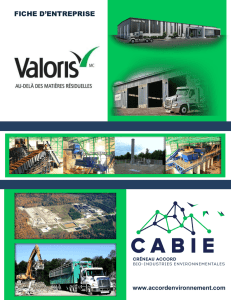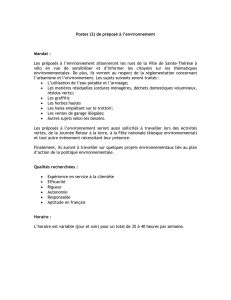LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN MILIEU RURAL

LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN MILIEU RURAL —
LE CAS PRATIQUE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
par
Kimberley Mason
Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement en vue de
l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)
CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Bouchette, Québec, Canada, juillet 2009

IDENTIFICATION SIGNALÉTIQUE
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN MILIEU RURAL —
LE CAS PRATIQUE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Kimberley Mason
Essai effectué en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env)
Sous la direction de Marc Olivier
Université de Sherbrooke
juillet 2009
Mots clés : économie sociale, hiérarchisation, matières résiduelles, milieu rural,
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, non-déchet, transport.
La gestion des matières résiduelles est un domaine en pleine expansion en réponse aux
grandes quantités de déchets générées, aux impacts environnementaux liés à l’élimination
et à la prévision de la rareté de certaines ressources premières. La gestion des matières
résiduelles en milieu rural comporte des défis particuliers. Grâce à des modes de gestion
adaptés et à une approche alternative, il est possible d’obtenir des résultats intéressants
tout en composant avec les défis présents. Hormis la créativité et la prise en main
nécessaires de la part des milieux ruraux, une modulation réglementaire qui reconnaîtrait
les forces et les défis particuliers à ceux-ci est souhaitable.

i
SOMMAIRE
La gestion des matières résiduelles est un domaine en pleine expansion en réponse aux
grandes quantités de déchets générées, aux impacts environnementaux liés à l’élimination
et à la prévision de la rareté de certaines ressources premières. Le domaine de la gestion
des matières résiduelles est relativement jeune comparativement à d’autres éléments
sociologiques connexes comme la consommation et le développement économique.
Depuis la fin du 20e siècle, des avancées technologiques et une poussée législative ont
forcé un développement rapide du domaine.
Au Québec, la génération de matières résiduelles ne cesse de croître; malgré que les
Québécois recyclent 40 % plus de leurs rebuts qu’il y a 10 ans, ils produisent tout de
même 14 % plus de déchets destinés à l’élimination. La réglementation provinciale cadre
est basée sur un développement d’outils de gestion et une approche par objectifs de
détournement de l’enfouissement. Malheureusement, l’État québécois ne semble pas
avoir procédé à une réflexion de fond afin d’établir des orientations cadres solides; de
plus, les politiques québécoises sont du type mur à mur, conçues pour les régions
urbaines d’où proviennent la plus importante quantité de déchets. La sécurisation des
sites d’enfouissement est actuellement prescrite par le Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération des matières résiduelles : ceci s’est traduit par une fermeture de plusieurs
lieux d’enfouissement sanitaires et de dépôts en tranchée au profit des lieux
d’enfouissement techniques, typiquement de grande taille et desservant une grande région
géographique. La Politique de gestion des matières résiduelles 1998-2008 qui tarde à être
renouvelée, a obligé les municipalités régionales de comté à se doter de plans de gestion
des matières résiduelles dans le but de mesurer et caractériser les rebuts générés sur leur
territoire et de planifier l’atteinte des objectifs fixés par cette Politique.
Dans les milieux ruraux québécois, il peut être difficile et coûteux de se conformer aux
exigences du Règlement et de la Politique lorsque des équipements et méthodes adaptés
aux milieux urbains sont employés. En vertu des faibles densités de population, de la
délocalisation des infrastructures et des longues distances à parcourir, les opérations de

ii
collecte et de transport sont complexifiées et rendues coûteuses. Par ailleurs, la
population rurale peut présenter une faible réceptivité envers de nouveaux projets si elle
conçoit ne pas être considérée de façon équitable. Une portion de la communauté qui se
sent brimée, mal desservie ou qui doit assumer des changements trop rapidement peut
réagir en créant des dépôts clandestins sur le territoire.
Heureusement, des modes de gestion adaptés au milieu rural sont proposés. Le transport
nécessaire peut être réduit par une diminution de la fréquence de certaines collectes,
l’implantation de l’apport volontaire pour certaines matières et l’exploitation de centres
de transfert. Pour ce qui est de la gestion des matières putrescibles, véritable embûche
pour la majorité des municipalités et des villes, les pratiques de compostage domestique,
de compostage communautaire, de co-compostage et de valorisation biologique en
partenariat agricole, sont toutes des mesures de valorisation efficace qui cadrent à
merveille dans la réalité rurale.
Afin d’arriver à implanter les services nécessaires, la maximisation des approches
collectives est souhaitable comme la gestion en régie intermunicipale et la gestion par des
organismes d’économie sociale ou solidaire. Ces derniers sont généralement habiletés à
participer à l’éducation et la à communication visant à assurer la participation publique
escomptée. Une fois que tous les services nécessaires sont en place, un milieu rural peut
envisager la tarification de la collecte et du traitement des déchets ultimes dans le but
d’optimiser les rendements et les coûts d’un programme de gestion complet.
Puisque la solution désirée ne relève pas uniquement de modes de gestion techniques, une
approche nouvelle à la perception des enjeux et à la hiérarchisation des actions à poser est
à considérer. Ces approches de pair avec des projets et des orientations qui soulignent
l’identité rurale sont susceptibles de connaître un franc succès.
Puisque cette étude a été élaborée dans l’optique de formuler des propositions pour la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, cette dernière est présentée selon ses caractéristiques
géographiques, socio-économiques et, bien sûr, sous l’angle de sa gestion des matières

iii
résiduelles. Grâce aux éléments rehaussés tout au long de la discussion, plusieurs
propositions sont émises pour le compte de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, elles
incluent : la planification soutenue par l’utilisation de la modélisation, la hiérarchisation
des services par type de rebut, l’établissement d’un centre de transfert et d’un écocentre,
la maximisation de l’économie sociale et solidaire, le développement de projets
identitaires, l’élaboration de programmes d’éducation et de communication et finalement,
la tarification éventuelle des services de collecte et de traitement de déchets ultimes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%