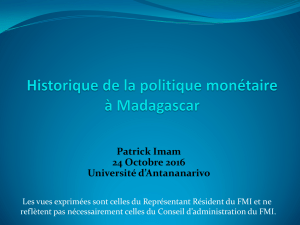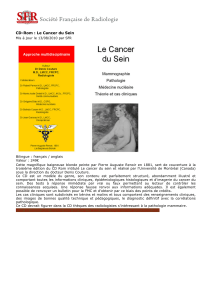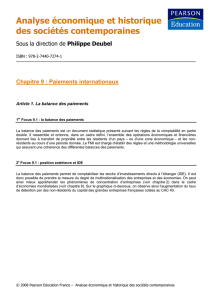Intégration commerciale et monétaire au Sud de la

Intégration commerciale et monétaire au Sud de la
Méditerranée :
Une utopie ?
(version préliminaire )
•
Par
Nassim Oulmane✳ Laetitia Ripoll-Bresson✠
RESUME
Cet article envisage la complémentarité d'une intégration commerciale et
monétaire dans le cadre du partenariat Euro-Méditerranéen. Les relations Nord-
Sud pourraient être facilitées par l'émergence d'un espace régional sud-
méditerranéen cohérent. La faiblesse des échanges entre les pays de la rive sud
de la Méditerranée, ainsi que le faible niveau des échanges intra-branche dans ce
commerce illustre le caractère peu intégré de la zone. Une intégration monétaire
devrait dès lors faciliter les échanges. Dans le cadre de la théorie des zones
monétaires optimales, l'examen du degré de symétrie des cycles des affaires et
des chocs affectant l'économie souligne la difficulté actuelle de ces pays à
pouvoir mener des politiques convergentes.
Mots Clés : Partenariat Euro-Méditerranéen, Intégration Sud-Sud, Commerce Intra-branche et
symétrie des chocs.
Classification JEL : F15, F33, F41
• Les avis et opinions exprimés dans cet article n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas les
institutions auxquelles ils appartiennent.
✳Direction de la Prévision – MINEFI 139, rue de Bercy - Télédoc 583 75572 Paris Cedex 12 et Lameta UFR
Sciences Economiques-Espace Richter- Avenue de la Mer- BP 9606- 34054 Montpellier cedex
Tel: +33.1.53.18.86.08 / na[email protected]
✠ Lameta UFR Sciences Economiques-Espace Richter- Avenue de la Mer- BP 9606- 34054 Montpellier cedex
Tel: +33.4.67.15.83.22 / r[email protected]

2
Introduction
Le partenariat euro-méditerranéen1 (ou processus de Barcelone) lancé en
1995 entend enclencher une dynamique vertueuse, grâce à l’introduction
progressive et accompagnée de la concurrence dans les économies du
bassin méditerranéen. Il s’articule autour de 3 piliers : le renforcement du
dialogue politique ; l’instauration d’une zone de libre-échange à l’horizon
2010 et l’approfondissement du dialogue social, culturel et humain.
Cependant, la juxtaposition d’accords Nord-Sud ne peut suffire à
l’avènement d’un espace économique régional. Un approfondissement de
l’intégration horizontale des pays de la rive sud demeure crucial. Se pose
alors la question de la pertinence d’une intégration monétaire venant en
complément de l’intégration commerciale ainsi que celle de l’existence
des conditions préalables à la réalisation d’une zone monétaire unifiée.
Cet article tente de répondre à cette dernière question en examinant non
seulement le volet commercial de l'intégration mais également l'aspect
monétaire. Dans une première partie, nous insistons sur la nécessité,
parallèlement au partenariat euro-méditerranéen, d’un approfondissement
de l’intégration commerciale Sud-Sud. Face à la faiblesse des échanges
entre les pays sud-méditerranéens, la deuxième partie est consacrée à
l'éventualité d'une intégration monétaire qui favoriserait le
développement de la zone.
1. Un partenariat qui doit tendre à dépasser le volet commercial
Malgré la conclusion récente de deux nouveaux accords (UE-Algérie et
UE-Liban) et l'aboutissement prochain des négociations de l’accord
d’association UE-Syrie, à ce stade, les premières avancées résultant de la
1 Du côté méditerranéen, les pays concernés sont : l’Algérie, Chypre, l’Egypte, Israël, le
Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, les Territoires Palestiniens, la Tunisie et la Turquie.

3
mise en œuvre du partenariat sont encore très limitées : seuls la Tunisie
(depuis 1996) et le Maroc (depuis 2000) ont entamé leur libéralisation
commerciale sur les biens industriels. La libéralisation des échanges en
matière agricole progresse très lentement. Les questions relatives aux
services doivent encore être précisées. Le niveau d’intégration de ces
pays peut s’évaluer en regardant la part de leur commerce qui s’effectue
avec les autres pays de la zone, ou encore en s’intéressant à leur
commerce intra-branche (l’échange croisé de produits similaires) qui
représente un bon indicateur du degré d’interpénétration des économies.
Le premier indicateur – part des échanges avec d’autres pays de la zone
dans les échanges totaux d’un pays – montre que les échanges intra-zone
des pays de la rive sud de la Méditerranée ne représentent qu’une faible
part de leurs échanges totaux. En moyenne, moins de 5 % des échanges
de ces pays se font entre eux, alors que plus de la moitié de leurs
échanges se font avec l’UE, premier partenaire commercial de la zone
(cf. tableau 1).
Tableau 1. Commerce intra-zone et avec l'UE en pourcentage des
échanges totaux des pays du Partenariat Euromed en 2000
Million
USD
Pourcentage
Monde Pays de la rive Sud UE
Algérie 29666 7 64
Egypte 24353 4 41
Israël 64543 1 38
Maroc 19654 3 63
Mo non-OPEP* 25977 10 36
Tunisie 14724 3 79
Turquie 79544 5 53
UE (15) 4357818 3 60
* Sont regroupés dans Moyen-Orient non-Opep la Jordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen qui
représente moins d'un quart du commerce du groupe.
Calculs des auteurs, Source Chelem du CEPII

4
Le deuxième indicateur s’intéresse au commerce intra-branche (CIB). La
mesure standard du CIB est l’indice de Grubel-Lloyd (GL) qui s’écrit
pour une année de référence t et un secteur donné2:
t
MX
MXMin
t
XM
XM
t
GL
+
=
+
−
−
=),(2
)(
1 ; où Xi et Mi représentent
les exportations et les importations du secteur. La valeur de cet indice
varie entre 0 et 1, inclus. La valeur 0 indique que tout le commerce est du
type inter-industries. A l’opposé, la valeur 1 indique que tout le
commerce est intra-branche
Tableau 2. Commerce Intra-branche des pays Partenariat Euromed
en 2000
Indice de Grubel-Lloyd
Monde Pays de la Rive Sud UE
Algérie 0,04 0,11 0,03
Egypte 0,29 0,44 0,22
Isräel 0,63 0,33 0,56
Maroc 0,32 0,37 0,31
MO non-Opep* 0,36 0,28 0,15
Tunisie 0,38 0,26 0,35
Turquie 0,4 0,17 0,36
UE(15) 0,88 0,38 0,99
* Sont regroupés dans Moyen-Orient non-Opep la Jordanie, le Liban, la Syrie et
le Yémen qui représente moins d'un quart du commerce du groupe.
Calculs des auteurs, Source CHELEM du CEPII
L’analyse montre que, globalement, hormis Israël, les pays de la zone
méditerranéenne connaissent un niveau de CIB très faible (cf. tableau 2).
Ce résultat est d’autant plus significatif que l’indicateur est calculé à un
niveau relativement agrégé (72 secteurs industriels)3. Ces pays sont
également très mal intégrés dans le commerce mondial puisque, dans
leurs échanges avec le reste du monde, les pays de la zone
2 L’indice GL se calcule au niveau sectoriel, puis il est agrégé en tenant compte de la part
des secteurs dans le commerce total.
3 Un calcul réalisé à un niveau sectoriel relativement agrégé comporte un biais en faveur
d’un CIB élevé. Un calcul sectoriel plus désagrégé donnerait un CIB encore plus faible.

5
méditerranéenne, avec un CIB moyen de 0,35, sont très loin derrière
l’UE qui a un CIB de 0,88.
Avec un CIB de 0,44, l’Egypte est le pays qui connaît le niveau de CIB le
plus élevé en ce qui concerne les échanges intra-zone, suivi du Maroc
(0,37). Avec la Tunisie et la Jordanie, ces deux pays sont signataires de la
déclaration d’Agadir (mai 2001) qui instaure une zone de libre-échange
entre les quatre pays. A l’opposé, c’est l’Algérie qui a le niveau de CIB
le plus faible et ceci aussi bien avec ses partenaires de la rive sud,
qu’avec l’UE ou le reste du monde ; la part prédominante des
hydrocarbures dans les exportations algériennes (95%) explique cette
spécificité.
La faible intégration de ces pays est préjudiciable, notamment en terme
d’attractivité des investissements directs étrangers( IDE ), pour lesquels
la taille du marché représente un déterminant majeur. En l’absence de
politique adéquate d’accompagnement, le seul démantèlement tarifaire
n'est pas suffisant pour assurer une plus grande intégration, entraînant un
développement rapide du commerce et l’augmentation significative des
investissements en Méditerranée4. Les entreprises (à capitaux
domestiques ou étrangers) doivent pouvoir bénéficier d’un
environnement économique où le commerce est facilité par une
adaptation ainsi qu’une harmonisation des dispositions réglementaires.
1.1 Une intégration horizontale nécessaire
L’élargissement des marchés intérieurs des pays méditerranéens par
l’intégration économique Sud-Sud constitue une condition primordiale du
développement de la région, compte tenu notamment de ses effets
4 Des simulation réalisées par le CEPII (Bchir, Decreux, Guérin et Jean mimeo 2002), à
l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable, indiquent, dans le cas du partenariat,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%