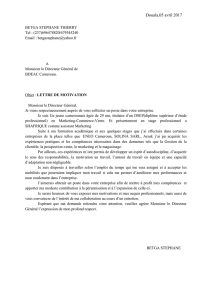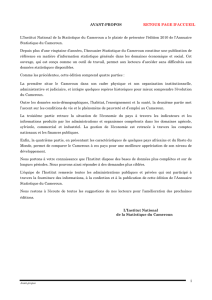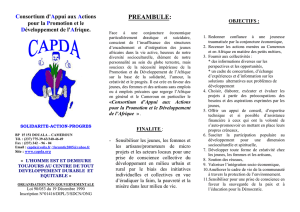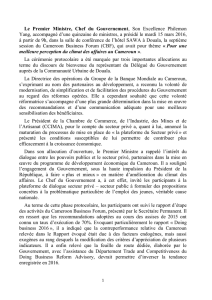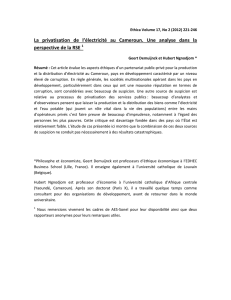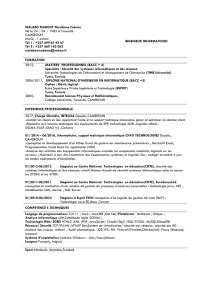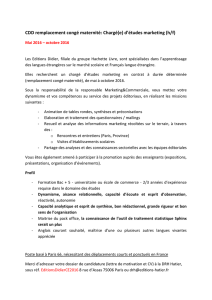Rapport de mission n°1

Vue de nos fenêtres sur le potager des
sœurs
Chers parrains, chers donateurs, chers famille et amis,
Après un mois passé à Yaounde au Cameroun en mission
de développement, voici venu le moment de vous donner de mes
nouvelles et celles du déroulement de ma mission à la maternité
du dispensaire de Nkolondom. Que le temps passe vite, voici déjà
l’heure de faire le bilan et, pourtant, il me semble que ce n’était
qu’hier que je foulais pour la première fois le sol africain. Ce qui est
sûr, c’est qu’à cette heure, il me reste encore tout à découvrir du
Cameroun.
Mais avant d’aller plus loin dans mon récit, laissez moi d’abord remercier tous ceux qui, par leur
parrainage, leur don et leur soutien tant amical que spirituel, ont rendu possible mon départ en mission. C’est par
votre soutien que je peux me mettre au service des autres en Afrique. De cela, je ne vous remercierai jamais
assez. Soyez assurés de mes prières et de ma plus sincère reconnaissance.
I Arrivée au Cameroun et présentation de la communauté des sœurs de saint
Joseph de Gérona
C’est donc par une chaude (et humide) soirée d’octobre que nous avons atterri à l’aéroport de Yaounde,
moi ainsi qu’Anne et Claire, deux autres volontaires Fidesco. A nous trois, nous formons un trinôme qui logera
ensemble à Nkolondom pour l’année à venir. Claire, sage-femme comme moi, occupe le poste de cadre
responsable de la maternité Notre Dame de Merci de La Briquetterie (le quartier musulman de Yaounde). Quant à
Anne, elle exerce son métier d’infirmière au dispensaire de Kol’Elton tenu par les sœurs du Sacré cœur (un autre
quartier de Yaounde, situé un peu au nord de la ville). Nous avons fait connaissance lors des sessions de
préparation à l’envoi de Fidesco. C’est donc ensemble que nous nous sommes envolées pour le Cameroun,
accompagné des Chabot, une famille de coopérant Fidesco. Gonzague est pneumologue, sa femme, infirmière ;
eux et leurs trois jeunes enfants sont basés au dispensaire de
Bikop, un village au sud de Yaounde.
Arrivées à l’aéroport de la capitale politique du
Cameroun, c’est tout un comité qui nous a chaleureusement
accueilli. Sœur Philomène, responsable du dispensaire de
Nkolondom, en faisait partie ainsi que Rodrigue, l’ingénieur
informaticien du centre. Ce n’est que plus tard que je devais faire
connaissance de sœur Prisca, la responsable de la maternité.
Sur la route menant à notre logement chez les sœurs de St

A l’arrière de la maison, avec les sœurs préparant un repas de
fête pour le bicentenaire de la naissance de la fondatrice de leur
ordre, Maria Gay
Joseph de Gerona à Nkolondom, j’ai pu avoir un avant-goût de la conduite camerounaise qui combine réflexe,
rapidité et précision sur un sol parfois très accidenté (surtout en arrivant au quartier). On peut ainsi très vite se
retrouver à trois voitures de front sur une route à deux voies, sans compter les voitures à contre sens (lorsque ça
bouchonne dans l’autre sens). Le code de la route me sembla d’autant plus exotique, pour la française que je suis,
qu’il n’y avait pas de ceinture de sécurité à l’arrière du véhicule. En effet, ici, rares sont les camerounais qui
l’utilisent. Malgré l’heure tardive (il fait nuit dès 18 h), il y avait encore quelques motos qui circulaient (deuxième
véhicule de prédilection à la capitale, un des plus dangereux aussi). C’est en voyant un camerounais, éclairé par
nos phares, nous dépasser sur une moto, son boubou bleu ciel gonflé par le vent, que je me suis convaincue de la
réalité de ce qui m’entourait ; après des mois d’interrogations puis de préparation, j’y étais enfin : ma mission au
Cameroun commençait.
Le Cameroun est un pays chaleureux tant dans son climat que dans les contacts entre ses habitants. Ce
fut donc tout naturellement que la communauté des sœurs de St Joseph de Nkolondom nous attendait au complet,
autour d’une table remplie de victuailles. Ici, me dit-on, un bon repas remplace tous les discours. Le temps de
déposer nos affaires et nous nous fîmes
donc un devoir de faire honneur au repas.
Nous fîmes alors connaissance de sœur
Basilia, supérieure de la communauté des
professes. D’origine espagnole, Sœur
Basilia a participé à l’implantation de la
communauté des sœurs de st Joseph de
Gerona en Afrique dans les années 80 ; tout
d’abord au Rwanda puis, après la guerre
civile, au Congo, pour arriver ensuite au
Cameroun. Forte de son expérience de 30
ans de mission en Afrique, elle dirige
actuellement la communauté de
Nkolondom. Sœur Rosario, qui a
accompagné sœur Basilia en Afrique, est,
quant à elle, responsable du noviciat qui se
trouve à Obili (un quartier plus au centre de
Yaounde).
Beaucoup des professes et jeunes professes résidant à Nkolondom sont rwandaises à l’exception de
sœur Françoise, originaire du Congo. En effet, le Cameroun étant, depuis longtemps, un des pays les plus stables
de la région, la communauté des sœurs de St Joseph y a installé son noviciat. Les postulantes des pays
environnants sont envoyées pour y faire leurs études. Les pré-postulantes (l’étape dure 1 an), postulantes et
novices, au nombre de 21, résident donc au noviciat à Obili. Tandis que la plupart des jeunes professes (ayant fait
leurs vœux temporaires) et professes (ayant fait leurs vœux définitifs) habitent Nkolondom, formant une plus petite
communauté de 9 personnes.

Anne et moi entourant sœur Françoise,
la veille de son départ
Nous logeons au rez de chaussée du couvent, occupant la
place des 3 postulantes de l’année précédente (résidant désormais
à Obili). Au moment de prononcer leurs vœux, les sœurs sont
envoyées en Espagne dans la communauté mère à Gerona. C’est
ainsi que plusieurs semaines plus tard, sœur Françoise nous faisait
ses adieux pour retourner au Congo et, de là, aller à Gerona pour y
faire ses vœux définitifs. Certaines sœurs sont encore dans les
études telles que les sœurs Viviane et Jeanne-Paule qui passent le
bac cette année ou encore sœur Marie Madeleine en étude de
gestion et les sœurs Marcelline et Odette, en étude d’infirmière. Le
charisme de la communauté étant de soulager la souffrance des
malades, la plupart des sœurs ont un métier en rapport avec la
santé.
Fondée en 1870 par Sœur Maria Gay pour venir en aide aux souffrants, la congrégation est actuellement
présente en Afrique dans quatre pays : la Guinée équatoriale, le Congo, le Cameroun et le Rwanda. « Apaiser la
douleur et semer la paix », tel est leur charisme. Leur présence au Cameroun y est d’autant plus précieuse que
l’accès aux soins reste très difficile dans le pays. En effet, les structures de
santé inégalement réparties dans le pays, le nombre limité de médecins (1
pour 10400 habitants) et surtout la pauvreté expliquent la difficulté
qu’éprouve une grande partie de la population à se soigner correctement.
II Petit tour d’horizon camerounais
Le Cameroun, pays de plus 20 millions d’habitants pour une
surface à peine plus petite que la France, se situe au fond du golfe de
Guinée, juste à l’endroit où le continent africain se creuse. Ce pays, en
forme de triangle mal dessiné, possède deux capitales ; l’une
commerciale, Douala, située sur le littoral Atlantique, l’autre politique,
Yaounde, siégeant dans la région plus montagneuse du Centre. On
compare le Cameroun à une petite Afrique miniature en raison de la grande diversité des paysages rencontrés
mais aussi de son incroyable diversité culturelle. Véritable puzzle ethnique, on dénombre plus de 260 ethnies
différentes, donnant naissance à tout autant de langues différentes. La colonisation allemande puis, à l’issue de la
Première Guerre Mondiale, celle française et anglaise, ont formé en grande partie les frontières actuelles du pays,
sans tenir réellement compte de la situation géographique des différents peuples composant le pays. Si le
Cameroun devint officiellement indépendant en 1961, les langues officielles sont restées, pour des raisons

pratiques, le français et l’anglais. Il existe huit langues véhiculaires d’importance inégale : l’arabe (plus à la partie
septentrionale du pays), le fufulde, le wandala, le duala, le basaa, le mongo-ewondo (littéralement « petit
ewondo », dérivé de l’ewondo, parlé béti de la capitale Yaounde et de ses environs, qui s’étend sur toute l’aire
géographique beti-fang du pays i.e. de la région Centre et Sud du pays), le pidgin-english (langue composite à
base d’anglais parlé dans les régions du Littoral, de l’Ouest et aux frontières du Nigéria) et enfin le français.
Yaounde, la ville « aux sept
collines », se situe dans la région Centre du
pays. S’étendant sur près de 7 km, chaque
quartier, fortement individualisé, a des
contours naturels (une colline, un plateau,
une vallée..). Peuplé au départ par l’ethnie
des Bétis, on y parle principalement
ewondo et etoun dans le quartier de
Nkolondom où nous sommes. Ces
différents dialectes se ressemblant, les
gens arrivent à communiquer entre clans
différents. Toutefois, Yaounde étant la
capitale administrative du pays, on assiste
à un métissage des différentes ethnies du
pays, sans compter une présence
importante d’immigrés des pays voisins.
Encore une fois, on mesure toute
l’importance des langues officielles, menant
un rôle fédérateur au sein même du pays.
Situé au nord-ouest de Yaounde et intégré relativement récemment à l’agglomération, Nkolondom
s’apparente plus au village campagnard qu’à la ville. Le maraichage
des bas-fonds est d’ailleurs une des principales activités des habitants
du village depuis que les missionnaires catholiques d’Etoudi (un
quartier voisin) l’y ont développé dans les années 60. On y compte
ainsi 500 exploitations regroupées sur 14 ha. L’accès aux zones plus
peuplées se fait par deux routes cabossées bordées par les champs et
quelques habitations. Si en taxis ou taxis motos, le trajet ne dure
qu’une quinzaine de minutes, il en faut une cinquantaine à pied. De ce
fait, la majorité des patients fréquentant le centre et la maternité
viennent du village ou de Messassi, le quartier situé entre Nkolondom et le gros axe routier de la ville.
De par la relative proximité de la ville, les habitants peuvent bénéficier des plus grosses structures
hospitalières du pays. Si donc ce n’est pas la question de l’accès au soin qui se pose pour la population des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%