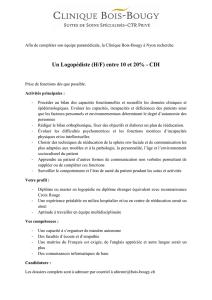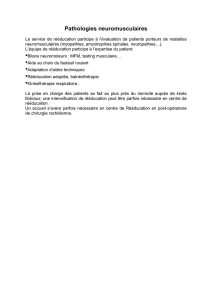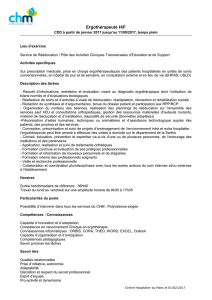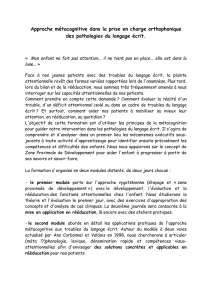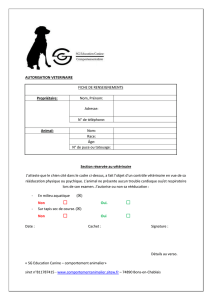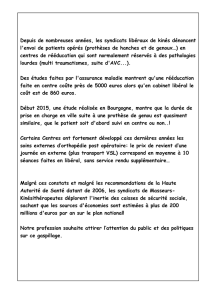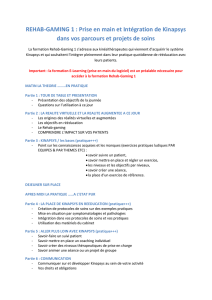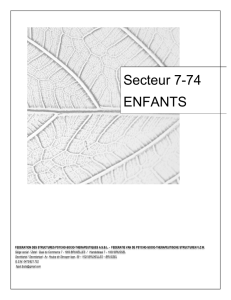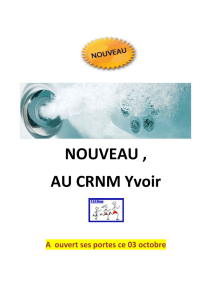AK1989_16_7-8_361-364

Ann. Kinésithér., 1989, t. 16, n° 7-8, pp. 361-364
©Masson, Paris, 1989 RÉPONSE A NOS LECTEURS
Question : Que peut-on attendre de la stimulation vibratoire transcutanée
en rééducation ?
Réponse rédigée par: M. ROMAIN (1), P.A. DURAND (1), C. KIZLIK (1), y. ALLIEU (2)
(1) Service Réadaptation Fonctionnelle B -C.M c., F 30240 Le Grau du Roi. (2) Service Chirurgie Orthopédique de la Main -C.M c.,
Le Grau du Roi.
La stimulation vibratoire transcutanée
(8. V.T.) est une technique encore récente dont
l'intérêt se manifeste en rééducation de la
sensibilité, en algologie et en rééducation
proprioceptive. Les auteurs font part de leur
expérience en insistant sur l'efficacité de la
méthode dans les douleurs tendineuses et
ligamentaires ainsi que dans les algies neurolo-
giques périphériques.
La Stimulation Vibratoire Transcutanée
(S.V.T.) est une technique thérapeutique récente
donc encore peu répandue. Son principe d'action
est purement mécanique. Les vibrations sont
transmises par application cutanée, en regard de
la zone àtraiter, d'un transducteur actionné par
un générateur de fréquence.
L'intérêt de la méthode se manifeste essentiel-
lement dans trois domaines:
- la rééducation de la sensibilité,
- l'algologie,
- la rééd~çation proprioceptive.
Rééducation de la sensibilité
Pendant longtemps le bilan de la sensibilité
était noyé au sein d'un examen neurologique
global et la rééducation sensitive totalement
ignorée. Il faudra attendre E. Moberg en
1958(6) pour avoir une approche fonctionnelle
du bilan de la main avec son «picking-up-
test ».
Tirés à part: M. ROMAIN, àl'adresse ci-dessus.
Il' tly_
Dellon (1) en 1972 souligne l'intérêt des
vibrations pour évaluer la récupération sensitive
après réparation des nerfs périphériques. Ces
informations vibratoires sont véhiculées par les
fibres myélinisées à adaptation rapide à partir
de mécano-récepteurs cutanés. Ces mécano-
récepteurs sont les corpuscules de Meisner
superficiels et ceux de Paccini situés en profon-
deur dans le derme. Les premiers seraient
d'après les travaux du physiologiste Mountcas-
de (7) plus spécialement adaptés aux vibrations
de l'ordre de 30cycles/seconde et régénèreraient
précocément, les seconds plus sensibles" aux
fréquences d'environ 250 cycles/seconde au-
raient une récupération tardive. Dellon utilise
deux diapasons, l'un de 30 hertz, l'autre de
256 hertz.
En France, Mansat et Delprat (4, 5) ont été
les premiers àsouligner l'avantage du vibromè-
tre sur le diapason grâce àsa maniabilité et à
la possibilité de réglage de la fréquence et de
la puissance du signal. Nous avons suivi cette
voie. Cependant, nous n'avons pas noté ces deux
étapes successives de récupération d'abord le
30 Hz puis le 256 Hz. Notre expérience est
plutôt en faveur d'une récupération très précoce
de l'information vibratoire aux alentours de
70 Hz, puis d'un élargissement progressif de la
plage de part et d'autre de cette fréquence au
fur et à mesure de la récupération.
En pratique, la fonction de test des S.V.T. est
indissociable de celle de rééducation.
L'appareil que nous utilisons (Vibralgic)
possède une plage de réglage en fréquence de
30 à1000 Hz et en amplitude de 0 à5 volts
(fig. 1).

362 Ann. Kin ésith ér.,1989, t. 16, n° 7-8
FIG. 1. - Application sur une épicondylite.
En mode d'utilisation test, l'appareil est calé
arbitrairement sur un volt et nous faisons varier
la fréquence entre 30 et 150 Hz sans que le
patient ne puisse voir les indications des cadrans.
Dès que le sujet ressent une information, on note
sa fréquence qui est en général assez proche du
70 Hz.
.Au cours des bilans suivants, la même
technique est employée en définissant à chaque
examen l'étendue de la plage de perception par
son seuil le plus bas et le plus haut.
La rééducation est entreprise dès que l'infor-
mation vibratoire est perçue. La sonde vibrante
est appliquée sans pression par balayage de la
zone àtraiter en faisant varier' les deux
paramètres : fréquence et amplitude. Après un
bref apprentissage, c'est le patient lui-même qui
réalise son traitement. Cette autorééducation est
particulièrement motivante grâce àla visualisa-
tion quantitative de ses propres progrès qui
s'inscrivent sur les afficheurs digitaux.
Rôle antalgique
C'est en utilisant la S.V.T. comme moyen de
rééducation de la sensibilité que nous avons eu
l'occasion d'observer son action antalgique.
A la même époque une équipe suédoise faisait
les mêmes constatations (2, 3).
Au début de notre. expérience nous ne
retenions comme indication que les douleurs des
nerfs périphériques. Depuis trois ans, nous avons
élargi ces indications aux douleurs aiguës ou
chroniques d'origine articulaire ou musculo-
tendineuse dont le siège est suffisamment superfi-
ciel pour être accessible àla transmission
mécanique des vibrations. Si le conflit est situé
en profondeur, les vibrations seront trop amor-
ties par l'épaisseur des tissus àtraverser pour
être efficaces.
DOULEURS TENDINEUSES ET LIGAMENT AIRES
Dans les maladies des insertions, qu'elles
soient tendineuses (épicondylite, pubalgie, tendi-
nite de la patte d'oie) ou ligamentaires (ligament
interépineux, ligaments latéraux du genou ou de
la tibio-tarsienne) l'effet de la S.V.T. est parti-
culièrement spectaculaire car l'action mécanique
des vibrations est amplifiée par le plancher
osseux sous-jacent. Cependant les autres tendi-
nites comme celle du long biceps ou du tendon
d'Achille sont également d'excellentes indica-
tions et le résultat est d'autant plus rapide
qu'elles sont d'apparition récente.
Sur 59 tendinites traitées en monothérapie la
S.V.T. nous a apporté 88 % de bons et exc~llents
résultats (13). Cette technique trouve ainsi une
place particulièrement privilégiée en médecine
du sport.
L'examen clinique précis est essentiel afin de
déterminer le point le plus douloureux qui sera
repéré au marqueur. La sonde y est appliquée
par une légère pression sans être déplacée
pendant une àtrois minutes, àune fréquence
de 200 Hz et à l'amplitude infra-douloureuse la
plus élevée possible.
LES DOULEURS NEUROLOGIQUES
PÉRIPHÉRIQUES
Nos premières observations relèvent de la
pathologie traumatique-des nerfs : névromes·
d'amputation, cicatrices névromateuses, dyses-
thésies après sutures nerveuses (9).
L'arsenal thérapeutique dans ce domaine est
très réduit et souvent décevant. La S.V.T. a ici
une place de choix avec dans notre expérience
80 % de bons et excellents résultats (11, 12).
Là encore la zone à traiter doit être minutieu-
sement recherchée. La sonde'Y est déplacée par.

effleurement pendant environ dix minutes. Les
paramètres antalgiques optimum sont ici de
120 Hz et de 4 volts. Cependant, il est rare que
le patient puisse d'emblée supporter ces valeurs.
Les premières séances seront donc pratiquées à
une fréquence plus élevée (250 Hz) et à une
amplitude infra-douloureuse, donc assez basse.
Les paramètres optimum seront atteints progres-
sivement en fonction des progrès.
Le même protocole est appliqué aux névral-
gies dont le conflit est superficiel telles que les
névralgies d'Arnold, les névralgies cervico-
brachiales, les méralgies paresthésiques avec une
qualité de résultat comparable à celle obtenue
sur les douleurs névromateuses.
LES DOULEURS D'ORIGINE DÉGÉNÉRATIVE
La S.V.T. peut avoir une action intéressante
sur les douleurs arthrosiques mais qui ne semble
pas aussi régulière que sur les tendinites ou les
douleurs neurologiques périphériques.
Nos meilleurs résultats ont été obtenus dans
les cervicarthroses, les rhizarthroses ou dans les
conflits vertébraux articulaires postérieurs du
sujet maigre.
Donc là aussi, la situation superficielle du
problème semble essentielle.
Le protocole utilisé est sensiblement identique
à celui des tendinites : application ponctuelle de
la sonde avec une légère pression sur la. ou les
zones les plus douloureuses à 200 Hz environ
pendant deux à trois minutes à l'amplitude
infradouloureuse la plus haute.
Rééducation proprioceptive
L'extrême sensibilité aux vibrations des termi-
naisons primaires des fuseaux neuromusculaires
et à un moindre. degré des organes tendineux
de Golgi a été étudiée par plusieurs auteurs, en
particulier par Roll (10).
La vibration tendineuse entre 70 et 100 Hertz
engendre, sans le contrôle de la vue, une illusion
d'allongement du muscle, donc une sensation de
mouvement.
La vibration tendineuse provoque une altéra-
tion du sens de position spaciale sans déplacement
véritable, dont'la direction est opposée à l'action
Ann. Kinésith ér., 1989, t. 16, n° 7-8 363
du tendon vibré. Ainsi la vibration du tendon
rotulien induit l'illusion de flexion du genou.
Cette véritable neurostimulation propriocep-
tive trouve un champ d'application intéressant
en rééducation pour conserver ou recréer une
image motrice menacée d'altération ou déjà
perturbée.
L'indication la plus habituelle concerne les
troubles liés à une immobilisation articulaire. Le
fait de vibrer alternativement le tendon agonis te
et antagoniste au travers d'une fenêtre réalisée
dans le plâtre, permettra au patient de retrouver
plus rapidement sa mobilité articulaire après
l'immobilisation. L'image motrice aura été en-
tretenue, les muscles ne présenteront pas cette
habituelle sidération d'immobilisation et le
patient aura beaucoup moins d'appréhension à
réaliser le mouvement actif souhaité.
En outre, mais cela reste à préciser, l'action
mécanique des vibrations péri-articulaires pour-
rait limiter les adhérences tissulaires.
Après l'immobilisation, les vibrations tendi-
neuses associées à la mobilisation passive
concourent à une récupération plus rapide de
l'amplitude articulaire qu'avec les techniques de
rééducation classiques. f
Cette méthode de rééducation motrice par
assistance proprioceptive vibratoire a été bien
étudiée par Neiger (8) sur deux groupes de
patients, l'un ayant bénéficié de vibrations
tendineuses, l'autre non, après immobilisation
du genou.
En rééducation fonctionnelle, la Stimulation
Vibratoire Transcutanée a un large champ
d'application dont nous n'avons très certaine-
ment pas encore cerné les limites.
Cette technique est originale à plusieurs
titres : son efficacité remarquable dans certaines
algies où l'arsenal thérapeutique est pauvre, son
intérêt irremplaçable en rééducation de la
sensibilité, son rôle de neurostimulation proprio-
ceptive. Enfin, et ce n'est pas son moindre atout,
il faut souligner sa totale innocuité.
Références
1. DELLON A.L., CURTIS R.M., EDGERTON M.T. - Evaluating
recovery of sensation in the hand following nerve injury.
Johns Hopkins Med. J., 1972, 130, 235-243.

364 Ann. Kinésithér., 1989, t. 16, n° 7-8
2. LUNDEBERG T. - Long term results ofvibratory stimulation
as a pain relieving measure for chronic pain. Pain, 1984,
20, 12-23.
3. LUNDEBERG T., NORDEMAR R., OTTOSON D. - Pain
alleviation by vibratory stimulation. Pain, 1984, 20, 25-44.
4. MANSAT M., DELPRAT J. - Rééducation de la sensibilité
de la main. Ann. Med. Phys., -1975, 18, 527-538.
5. MANSAT M., DELPRAT J., DELPRAT J.M. - Le Vibromètre:
un générateur de vibrations pour le bilan quantitatif et la
rééducation de la sensibilité. Rev. Réadapt. Fonct. Prof Soc.,
1980, 6, 20-23.
6. MOBERG E. - Objective methods of determining functional
value of sensibility in the hand. 1. Bone Joint Surg. (Br),
1958, 40, 454.
7. MOUNTCASTLE V.B. - (Ed.) Medical Physiology. Ed. 12,
Saint Louis: C.V. Mosby, 1968.
8. NIEGER H., GILHODES J.C., ROLL J.P. - Méthode de
rééducation motrice par assistance proprioceptive vibratoire
(Partie II). Ann. Kinésither., 1983, JO, 11-19.
9. RIERA G. - Intérêt des stimulations vibratoires dans la
pathologie traumatique des nerfs périphériques. Thèse
Médecine. Montpellier, 1986.
10. ROLL J.P., GILHODES J.c. - Méthode de rééducation
motrice par assistance proprioceptive vibratoire (Partie 1).
Ann. Kinésithér., 1983, 10, 1-10.
11. ROMAIN M., GINOUVES P., DURAND P.A., ALLIEU Y. -
Traitement des névromes par stimulations vibratoires. A
propos de 72 cas. Communication au G.E.M., Congrès
d'automne, Paris, 1987.
12. ROMAIN M., GINOUVES P., RIERA G., DURAND P.A.,
ALLIEU Y. - Effet antalgique des stimulations vibratoires.
Étude àpropos de 250 dossiers. Act. en Reed. Fonet. et Read.
13e série. Masson 1988, 178-183.
13. ROMAIN M., GINOUVES P., DURAND P.A., RIERA G.,
ALLI EU Y. - La stimulation vibratoire transcutanée en
algologie. Ann. Réadapt. Med. Phys., 1989, 32, 62-69.
1
/
4
100%