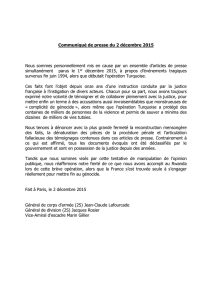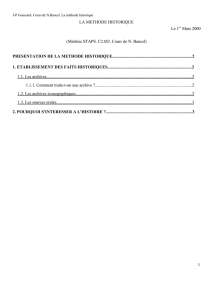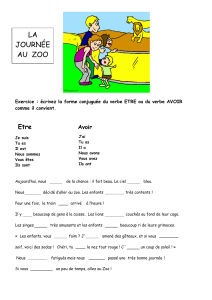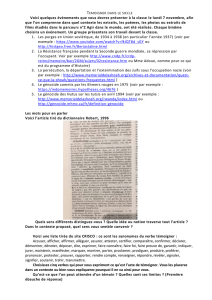COLONISE Nicolas Bancel La constitution d`un corps du colonisé

COLONISE
Nicolas Bancel
La constitution d’un corps du colonisé serait probablement à rechercher
dans les représentations qui renvoient, dès le XVI
e
siècle, aux populations
des “ vieilles colonies ”, populations indigènes caraïbes et esclaves
importés pour la culture de la canne à sucre (Vergès, 2001). Cependant,
dans le cadre de cette contribution, nous nous limiterons aux
représentations du corps colonisé apparues dans la phase moderne de
l’impérialisme hexagonal, soit depuis le dernier tiers du XIX
e
siècle. En
effet, à partir du début des années 1870 et jusqu’au début de la Première
Guerre mondiale, la progression des conquêtes réalisées par les
métropoles européennes est fulgurante : en quarante ans, près des deux
tiers du globe sont annexés par l’Europe. La France participe activement à
ce processus, étendant le second empire du monde après celui des
britanniques à l’Afrique, l’Asie et l’Océanie (Ageron C.-R., Thobie J.,
Meynier G., Coquery-Vidrovitch C., 1990).
Durant toute cette conjoncture, les conquêtes coloniales vont
connaître une “ mise en signe ” à travers la multiplicité des supports
qu’autorise la culture de masse naissante. Ainsi, journaux illustrés
destinés au grand public, livres, cartes postales, photographies, timbres,
objets, expositions, zoos humains et bientôt cinéma se font les véhicules
de représentations qui mettent en scène l’épopée coloniale, légitimant
d’abord la bravoure des soldats et construisant progressivement l’image
des territoires colonisés et des populations coloniales (Bancel N.,
Blanchard P., Gervereau L., 1993 ; Bancel N., Blanchard P., Delabarre F.,
1997). La formation de cette culture coloniale a fait l’objet, ces dix
dernières années de recherches approfondies (Blanchard P., Lemaire S.,
2003) et celles-ci montrent son extraordinaire puissance, le foisonnement
un peu vertigineux de représentations qui traversent, de part en part, le
corps social, excédant les clivages de classes, les oppositions politiques,
les fractures religieuses ou culturelles. Ces recherches indiquent aussi la
pérennisation de ces représentations et la stabilisation d’archétypes qui
semblent courir des années 1870 aux décolonisations, et même au-delà,
jusqu’à notre contemporanéité (Blanchard P., Bancel N., 2001). Ce qui se
joue dans ce processus c’est d’abord la construction d’un imaginaire
collectif sur la colonisation – entendue ici comme constituée d’espaces et
d’hommes –, c’est ensuite la formation d’une institution imaginaire –
institution étant prise ici au sens de “ quelque chose qui dure ” – qui
opère, d’une génération à l’autre par reproduction, non que les images se
reproduisent terme à terme mais les schèmes qui les structurent se
réitère, par un processus de filiation.
Cette configuration culturelle est à notre sens essentielle, en ce sens que
se définissent à travers elle le statut de l’Autre et de l’altérité, qui renvoie
à la construction en miroir des identités collectives dans le cadre des

bouleversements extraordinairement rapides que connaît la société
française depuis la première révolution industrielle.
Le corps du colonisé, dans ce contexte, peut être sollicité comme
l’analyseur privilégié de ce nouveau statut de l’Autre, car il est le
réceptacle sur lequel s’inscrivent les signes des projections imaginaires de
la société française de la fin du XIX
e
siècle. On ne pourra, dans le cadre
nécessairement limité de cette contribution, que donner quelques
indications sur les formes que prennent cette projection. En effet, le corps
du colonisé est multiple : il se distribue sur des échelles – raciales,
culturelles, sociales – aux frontières mouvantes, il se répartit entre les
principales populations coloniales, il se distingue par genres ; mais il est
aussi reproduit sur des supports hétéronomes, qui ne traite pas de la
même manière les représentations (il existe un monde entre la
photographie scientifique et le dessin humoristique), enfin, ces images
diverses, toujours polysémiques, font l’objet d’usages sociaux différenciés
qui en affinent et complexifient le sens (Bancel N., 2003). On se
contentera donc ici d’indiquer des schèmes suffisamment récurrents, sans
pouvoir approfondir plus avant la diversité de leur mise en forme.
Le corps du colonisé, dans la phase des conquêtes, est un corps
largement démonisé. Les “ sauvages ”, Africains ou canaques, représentés
généralement jusqu’à la fin du XVIII
e
siècle sous les traits du “ bon
sauvage ”, prennent figure menaçante : expressions “ féroces ”, détails
sur les “ cruautés ” (avec de nombreuses scènes de tortures et de
sacrifices humains), insistance sur les armes. Le “ sauvage ” est
l’“ ennemi ” que seule une force civilisée et supérieure peut vaincre. Les
représentations dessinent là une frontière civilisationnelle qui, en elle-
même, justifie la conquête et légitime le ressort européocentrique de la
“ mission civilisatrice ” de la France.
La seconde ligne de force que nous pouvons dégager est la
racialisation des représentations. Des années 1830 à 1860, ces
représentations sont surtout le produit d’une objectivation scientifique,
celle établie par l’anthropologie physique (mais également l’ethnologie,
tant l’épistémologie entre ces deux disciplines est vacillante jusqu’au
début du XX
e
siècle, cf. Blanckaert, 2002 ; Boëtsch, Ferrié, 1993) qui,
dans la perspective d’établir une taxinomie des populations du monde,
recueille des “ collections ” d’images, dans un premier temps des dessins,
puis des photographies. Les représentations produites par l’anthropologie
physique insistent sur les particularités somatiques (taille, poids, attitude,
éléments constamment affinés grâce aux progrès de l’anthropométrie) des
différents groupes qu’elle s’est donné pour tâche d’étudier, puisque ces
spécificités autorisent leur classement et leur hiérarchisation : des
caractéristiques physiologiques procèdent leurs capacités cognitives et
culturelles différenciées.
On voit très nettement se dessiner au cours des années 1860 le transfert
de ces représentations “ scientifique ” vers le grand public, par des
médiatisations originales : les cartes postales “ Scènes et Types ”, par
exemple, qui connaissent un succès qui ne se démentira pas jusqu’au
années 1940, les périodiques de vulgarisation scientifique (La nature, La

science illustrée), des périodiques destiné à un large public (Le Journal
des voyages, Le tour du Monde), mais aussi des spectacles tels les Zoos
humains (cf. infra). Ces représentations populaires spectacularisent les
particularités somatiques des représentés : le corps est le signe sur lequel
on repère la place des groupes sur une échelle raciale. Plus profondément
encore, sur le corps du colonisé est tracé la frontière qui sépare
l’humanité de l’animalité. Cette frontière est décelable dans la tenue (la
nudité ou la semi-nudité/le vêtement), les attitudes (le relâchement/le
maintien) et la motricité (le contrôle, la discipline/l’exubérance).
Cette sommaire description est heuristique si on l’articule à la
construction moderne de l’identité nationale en France. En effet, cette
dernière se construit sur un référent négatif – le colonisé – dont les
représentations subsument dans la dernière partie du XIX
e
siècle les
formes traditionnelles de l’altérité (le fou, le monstre). Le corps du
colonisé devient ainsi le point de focalisation qui permet d’édifier les
valeurs transcendantes qui sont au fondement de l’Etat-nation moderne :
le progrès, la supériorité de la civilisation européenne, et, pour la France,
la spécificité républicaine (définit par un horizon égalitaire rendue possible
par l’éducation, cf. Nicollet C., 1982 ; Nora, 1982, Bancel, Blanchard,
Vergès, 2003).
Or, le corps du colonisé et encore un corps communautaire. Il est articulé
au groupe auquel il appartient, par les liens de la famille élargie, du clan
ou de la race, à l’inverse du corps blanc, individualisé. Au fur et à mesure
que, durant les années 1900-1910 l’Empire recouvre ses frontières
définitives et qu’aux conquêtes succède la gestion coloniale, le corps
colonisé devient l’objet d’une éducation et d’un contrôle inscrit dans
l’“ œuvre civilisatrice ”. Investi par les savoirs de l’anthropologie physique
et de l’ethnologie culturelle, le corps colonisé est aussi façonné pas à pas
par les institutions coloniales (l’école, l’armée, le travail). Les archétypes
les plus violemment “ raciaux ” et stigmatisant tendent à être remplacés,
dans la propagande officielle tout au moins, par une représentation
concrète de la domestication/civilisation des corps colonisés. Moins
menaçants, plus dociles, le corps colonisé se soumet au pouvoir tutélaire
qui s’est chargé de l’élever – comme le professe l’utopie républicaine-
coloniale – vers le civilisation.
Les quelques perspectives établies ici sont indicatives. Les recherches
sur la dimension corporelle des représentations du colonisé sont en effet
encore à leurs balbutiements. Mais elles révèlent déjà l’extraordinaire
intrication, dans les représentations, entre procédés d’objectivation,
construction des savoirs et relations de pouvoir décelables dans l’image.
Une histoire politique du corps colonisé révèlerait sans nul doute la
complexité des relations asymétriques coloniales, mais aussi la formation
de schèmes culturels propres à l’édification d’une culture coloniale en
France qui produit vraisemblablement ses effets bien au-delà des
décolonisations.
Bibliographie

Ageron C.-R., Thobie J., Meynier G., Coquery-Vidrovitch C. (1990),
Histoire de la France coloniale 1914-1990, 2 Tomes, A. Colin, Paris.
Bancel N. (2003), L’image, le corps. Sur l’usage en histoire de quelques
formations non-discursives, Mémoire d’HDR en Lettres et Sciences
humaines, Université Paris XI, 3 volumes.
Bancel N., Blanchard P., Gervereau L. (1993), Images et colonies, Bdic-
Achac, Paris, 304 p.
Bancel N., Blanchard P., Delabarre F., (1997), Images d’Empire. Trente
ans de photographies officielles sur l’Afrique coloniale, La Documentation
française/De La Martinière, Paris, 340 p.
Bancel N., Blanchard P., Vergès F. (2003), La République coloniale. Essai
sur une utopie, Albin Michel, coll. “ Bibliothèque des idées ”, Paris, 178 p.
Blanchard P., Lemaire S., (2003)Culture coloniale. La France conquit par
son Empire, Autrement, Paris. Blanchard P., Bancel N. (2001), De
l’indigène à l’immigré, Gallimard, coll. “ Découvertes ”, Paris, 128 p.
Blanckaert C. (2002), Les politiques de l’anthropologie, L’Harmattan,
Paris.
Boëtsch G., Ferrié J.-N. (1993), “ L’impossible objet de la raciologie.
Prologue à une anthropologie physique de l’Afrique du nord ”, Cahiers
d’études africaines, n° 129, p.5-18.
Nicollet C. (1982), L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique,
Gallimard, Paris.
Nora P. (1982), Les lieux de mémoires, Tome I, La République, Gallimard,
Paris.
Vergès F., (2001), Abolir l’esclavage, Albin Michel, Paris, 234 p.
Cf : Anthropologie, Exotique, Noir, Race, Racisme, Zoo-Humains

ZOO HUMAIN
Nicolas Bancel
Les zoos humains, représentent, dans la seconde moitié du XIX
e
siècle en
Europe, un tournant majeur dans les représentations corporelles de
l’Autre. Plusieurs processus historiques convergents sont à la source du
phénomène. D’une part, depuis le XVI
e
siècle, l’essor des jardins
zoologiques matérialise le projet d’inventaire et de taxinomie de la
diversité animale et témoigne de la reconnaissance du monde par les
explorations européennes et le commerce maritime (Baratay E., Hardouin-
Fugier E.,1998). D’autre part, la présentation physique de représentant de
populations extra-occidentales peut-être attestée dès le XV
e
siècle (tel les
indiens Tupi présentés au Roi de France), puis, aux XVIII
e
siècle, dans les
cabinets de curiosités ; présentations destinées édifier l’aristocratie
éclairée et à servir l’extension des taxinomies du vivant aux groupes
humains, dont témoignent bientôt les grands projets encyclopédiques.
Au début du XIX
e
siècle apparaissent à Londres les premières expositions
publiques de l’Autre à visées mercantiles (Altick R. D., 1978), de la Vénus
Hottentote (1810) aux Indiens (1817), des eskimos (1824) aux guyanais
(1839). Mais l’essor des zoos humains se concrétise réellement sur le
vieux continent dans le dernier tiers du XIX
e
siècle, lorsque le principal
entrepreneur de cirque et plus grand importateur européen d’animaux
sauvages, Carl Hagenbeck, commence en 1874 à exposer dans un décor
directement inspiré du zoo animalier, des groupes humains “ exotiques ”.
Le phénomène s’étend d’abord à la France (première exhibition sur ce
modèle en 1877 au Jardin zoologique d’acclimatation), puis à l’ensemble
de l’Europe.
En France et dans la plupart des pays d’Europe, le zoo humain assure une
triple fonction. Tout d’abord une fonction pédagogique : les populations
exhibées témoignent en effet de la diffusion du discours que
l’anthropologie physique produit alors sur la diversité humaine, en opérant
une hiérarchisation des “ races ” (Boëtch G., Ferrié J.-N., 1993). Entre
1877 et le début du XX
e
siècle, les anthropologies de la Société
d’anthropologie de Paris valident en effet la “ pureté raciale ” des groupes
exhibés, en échange de la possibilité qu’il leur est offerte d’étudier ces
“ spécimens humains ”, afin de procéder à l’affinement de mesures
anthropométriques. Ensuite le zoo humain assure fonction de
divertissement : le zoo humain joue sur l’attrait pour l’exotisme et excite
la curiosité des visiteurs. Ce type d’exhibition devient rapidement, avec la
multiplication des troupes et la rotation des tournées, un authentique
média de masse, et on peut estimer, pour la France, la fréquentation des
exhibitions à plusieurs dizaines de millions de visiteurs entre 1877 et
1932, date à laquelle les recherches actuelles recensent la dernière
exhibition anthropozoologique (Bancel et alii, 2002). Enfin, le zoo humain
renvoie à la construction des identités nationales dans le contexte de la
formation accélérée, en Europe, des états-nations dans la seconde partie
du XIX
e
siècle. La représentation de l’“ exotique ” s’inscrit en effet dans la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%