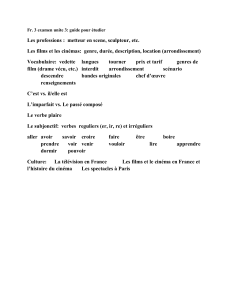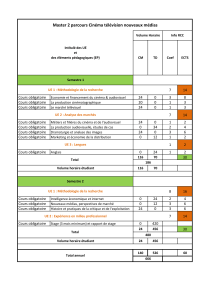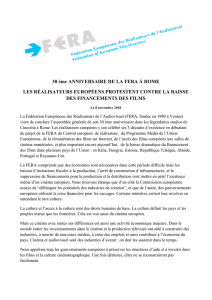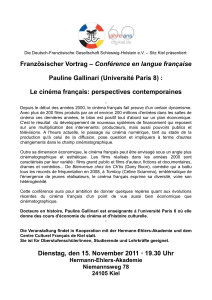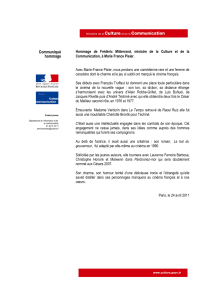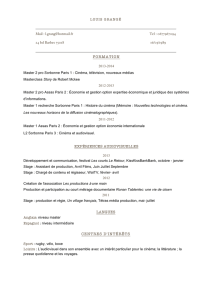Télécharger la version

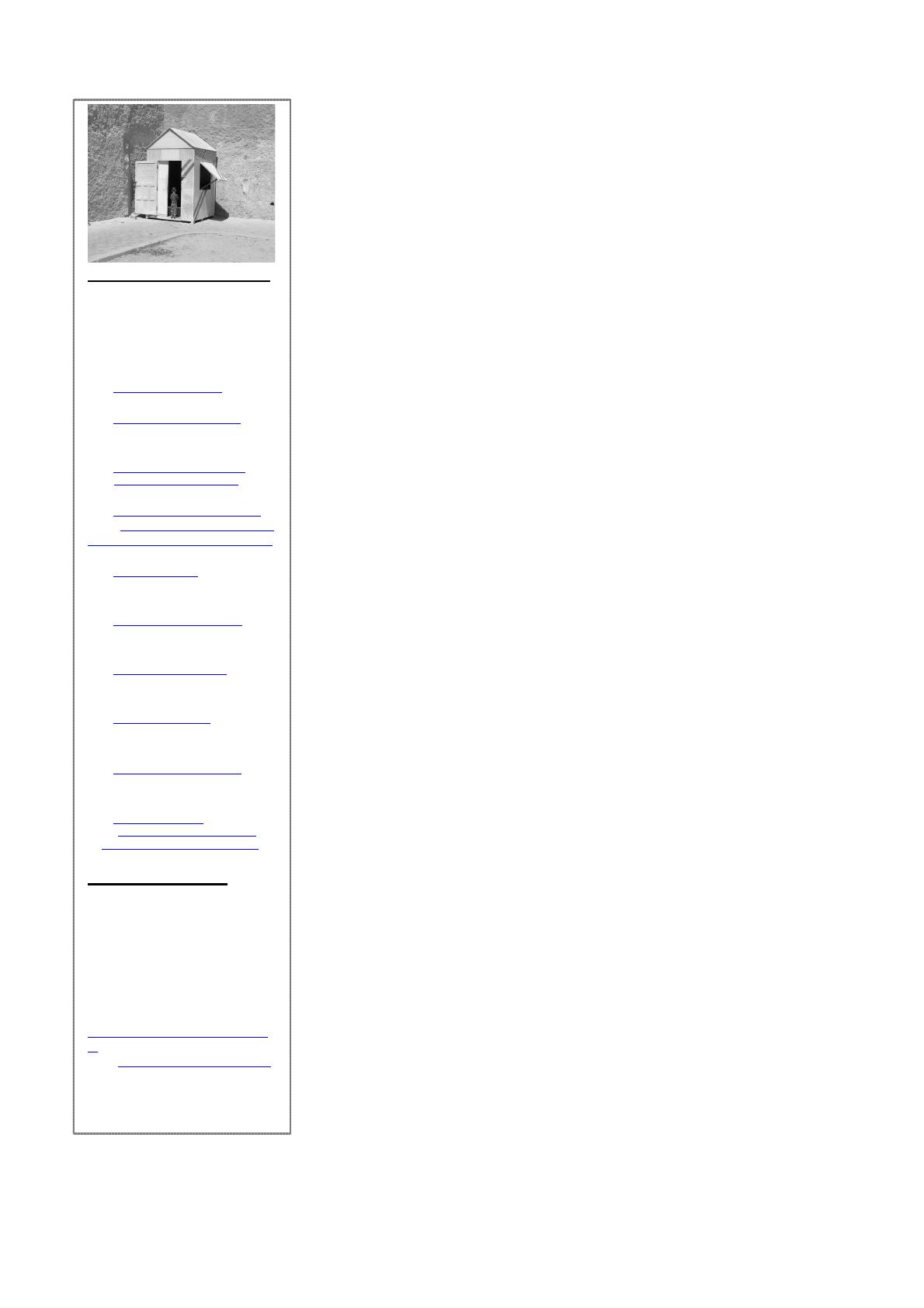
Membres de la rédaction
Entre parenthèses, nos pseudonymes
du forum des Cahiers du Cinéma.
Belliard Stéphane
(GLJ)
Mail: stephanebelliard@neuf.fr
Borges
Mail: jlborgesalternatif@gmail.com
Clairefond Raphaël
(Largo)
Mail: raphael.clairefond@gmail.com
Blog: http://wizzz.telerama.fr/largo
HarryTuttle
Mail: harrytuttle.screenville@gmail.com
Blogs:http://screenville.blogspot.com
http://unspokencinema.blogspot.com
Louis Lorin
Mail: lorinlouis@aol.com
Mees-Baumann Adèle
(Adeline)
Mail: adelemeesbaumann@yahoo.fr
Môlard Arthur
(diez)
Mail: diezcervantes@gmail.com
Pellegry Simon
(David_Boring)
Mail: jangomilo@gmail.com
Raulin Sébastien
(Eyquem)
Mail:
sebastienraulin@yahoo.fr
Rocher Jean-Maurice
(JM)
Mail: yoboay@wanadoo.fr
Blogs: http://cinechanges.blogspot.com
http://carnetdebord-jm.blogspot.com
Ont aussi participé
Claës Balthazar
Dreamspace
Lacuve Jean-Luc
Wootsuibrick
Plateforme internet de diffusion, de
communication et d'échanges :
http://spectresducinema.blogspot.co
m.
Mail: spectresducin[email protected]
Mise en page : Rocher Jean-Maurice.
Photographie du sommaire : "La
Cabane", par Largo.
Sectres du cinéma, numéro un, Automne 2008
•
••• SOMMAIRE •
•••
Des spectres hantent le monde du cinéma, par Borges. 3
Tract, par la rédaction. 8
Burdeau et Lanzmann, Badiou, par Jean-Maurice Rocher. 9
Sur les traces du documentaire, par Adèle Mees-Baumann. 11
Regard(s) morbide(s) 15
1. Terrain(s) battu(s), par Simon Pellegry. 16
2. La mort en cette image… (sur Diary of the Dead), par Lorin Louis. 18
3. Ce que la guerre du Golfe ne montrait pas, par Simon Pellegry. 22
Le Russe est-il un conservateur naturel ?, par Arthur Môlard. 24
Perte du temps (autour de Taken), par Jean-Maurice Rocher. 28
Approches du réel 30
1. En Avant Jeunesse / Still Life, à l'épreuve du temps, par Raphaël
Clairefond. 31
2. Contre la mort (autour de En Avant Jeunesse), par Adèle Mees-Baumann. 33
3. Travail de forces (sur Still Life), par Sébastien Raulin. 36
4. Coutures (autour de Useless), par Jean-Maurice Rocher. 39
Entretien avec Hamé de La Rumeur 40
What's happening Mr. Shyamalan ? 47
1. Les villes, par Sébastien Raulin. 48
2. La bulle brisée, par Jean-Maurice Rocher. 49
Zones (dos aux murs), par Jean-Maurice Rocher. 50
Représentation des minorités mexicaines dans le cinéma
hollywoodien du XXI
e
siècle 51
1. Sur quelques films hollywoodiens, par Borges et Jean-Maurice Rocher. 51
2. Bilan, par Jean-Maurice Rocher. 53
3. Los Bastardos, par HarryTuttle. 53
Entretien avec Charles Tesson 58
Guy Gilles ou l'adolescence mélancolique de la Nouvelle Vague, par Raphaël
Clairefond. 69
Tournent, les fantômes (autour de Ghost Dance), par Jean-Maurice Rocher. 71
Critiques 73
Les Ruines de C. Smith & Shrooms de P. Breathnach, par Lorin Louis. 73
Bon baisers de Bruges de M. McDonagh, par Stéphane Belliard. 74
Glory to the filmmaker! de T. Kitano, par Lorin Louis. 75
Falafel de M. Kammoun, par Lorin Louis. 77

Des spectres hantent le monde du cinéma
par BORGES
D
es spectres hantent le monde du cinéma, comme Dieu et le communisme hantaient le petit monde de Don
Camillo: les spectres des Cahiers du cinéma.
Nous ne visons pas à les faire revenir, ni à les chasser ; nous sommes contre la chasse, aux sorcières, aux bêtes, au
Snark, et plus encore au Boojum.
"Spectres du cinéma".
Une analyse spectrale révèlerait la présence des Cahiers et de Marx dans cette construction qui condense deux titres
fameux. Qu'on ne se trompe pas sur nos intentions ; nous ne cherchons pas à substituer des spectres à nos vieux
"Cahiers", ou à insinuer qu'ils ne seraient plus désormais que les spectres de ce qu'ils furent, encore moins cherchons-
nous à substituer le cinéma à Marx, en opposant à ceux qui cherchent à changer le monde, sa simple reproduction
divertissante. Un opium contre l'autre. L'opium du peuple contre celui des intellectuels. Si les discours sur le cinéma
contiennent nécessairement une rhétorique des drogues, nous ne croyons plus avec Griffith que les artifices de l'opium
nous ramènent au paradis, pas plus que nous ne croyons qu'une culture, une religion, disposeraient plus que d'autres à
faire du cinéma. A ceux qui conseillaient d'apprendre la mise en scène pour comprendre Mizoguchi et non pas le
japonais, nous ne disons pas qu'il faut se faire asiatique pour saisir les cinémas asiatiques. Ces histoires de culture ne
nous intéressent que modérément, surtout quand elles naturalisent l'histoire et, niant l'universelle capacité des hommes à
produire de la vérité au-delà des multiplicités, dérivent avec l'aplomb d'une logique scolastique indigne des médecins de
Molière les plans d'immanence de Hou Hsiao-hsien des vertus dormitives de la calligraphie. Que les gens écrivent en
arabe, en pictogramme, idéogramme, en forme de coins, en morse, cela ne dispose à rien d'essentiel, pas plus que
manger avec des baguettes, ses mains, une fourchette, porter le chapeau, la kippa, le voile ou la culotte ne prédisposent à
diriger le monde, et encore moins à égaler le génie de la rebelle, Katharine Hepburn.
Seules nous importent les vérités dont les singularités, les exceptions, toujours minoritaires, sont capables.
"Spectres du cinéma".
Notre intention ici n'est pas d'annoncer : "les Cahiers sont morts, vivent les spectres".
Ce serait d'un comique !
Aucun d'entre nous ne se sent de taille à se lancer dans une parodie admirative de Marlon Brando discourant sur le
cadavre de César assassiné, dans le film de Mankiewicz, qui, comme Shakespeare et Madame Muir, s'intéressait aussi
aux fantômes. On n'essayera donc pas de désigner aux lecteurs improbables, les plaies faites à la revue, par la bêtise
d'untel, les compromissions d'un autre, les lâchetés de tous ces hommes honorables, qu'un manque de désir de vérité, si
accordé au nihilisme d'une époque qui voit les rats se précipiter vers "le service des biens", aura finalement conduits,
sans que l'on comprenne comment, malgré le sérieux de nos efforts, et les prodiges de nos ironies, à égaler Ozu à je ne
sais quel auteur de série Z, Spiderman et Still life ; alors que n'importe quel amateur de comics vous prouverait avec brio
que la vie de Peter Parker est très loin de la tranquillité des natures mortes et de la vie des braves gens des Trois Gorges.
Si nous n'affirmons pas "les Cahiers sont morts, vivent les spectres", c'est aussi, sans doute, parce que nous ne
sommes pas assez magiciens, sorciers, ou fils de Dieu, pour faire revenir à la vie les spectres, bien que nous croyions au
lien de la vérité à ses résurrections ; et puis, pour qui veut bien considérer la chose, les spectres échappent à l'alternative
vie ou mort ; les spectres n'existent pas ; c'est du cinéma ; à moins que le cinéma ne soit un héritage des croyances au
surnaturel, magie, ombres chinoises et table tournante ; ce qui revient au même ou à l'autre.
Et Marx alors ?
On y reviendra.

ECRIRE DU CINEMA
Si les Cahiers du cinéma sont morts, meurent, risquent de mourir ; pour nous, en nous, pour le cinéma, nous restent
les spectres du cinéma ; ceux de Bazin, de Daney, des autres, de toutes ces signatures qui écrivent sur le cinéma ou, pour
le dire avec Godard, "écrivent du cinéma" ; un Godard que je m'invente peut-être pour le plaisir de le citer, pour le
bonheur de m'expliquer avec son spectre ; ici même.
"Ecrire du cinéma", Godard l'entendait comme écrire depuis le cinéma, le cinéma comme origine de l'écriture.
Le cinéma n'étant pas un lieu, l'espace prétendument empirique des salles obscures, ni la totalité des films tournés, la
liste des 100 meilleurs de tous les temps, les dix de l'année, mais ce qui nous arrive, nous affecte dans la rencontre
singulière avec un film qui nous fait dire : "putain, ça c'est du cinéma". Proust, l'amateur de pâtissiers bien connu, parlait
de "puissante joie" pour désigner cette rencontre, que nous cherchons à dégager afin de faire sentir l'essence spectrale du
cinéma. D'autres, plus costauds et amateurs de combats physiques, parlent de "coups de poing", de "gifles". Peu
importent les métaphores ; comme les prophètes de Spinoza, ces êtres d'imagination, nous dépendons de nos affects pour
approcher la vérité à travers les images. L'essentiel est qu'après avoir tendu l'autre joue, repris un peu de thé, posé sa
tasse, on se décide à ne pas rater sa chance, riposte et touche à la fin de l'envoi. Surtout ne pas manquer la chance de ces
signes qui nous sont adressés, chercher d'où vient le coup, le choc qui bouleverse l'être, et vous fait sentir moins
"contingent", "médiocre", "mortel".
La recherche des causes, après les effets.
Progression logique et spinoziste ; nous sommes désormais dans le deuxième genre de connaissance. Notons que
Spinoza, qui échangea sur la question quelques lettres avec un certain Boxel, ne croyait pas aux spectres, au sens propre
du mot.
Et nous ?
Ne nous égarons pas. Revenons à notre sujet, à notre cause.
Se tourner vers l'origine, c'est nécessairement chercher la cause, l'origine de l'affect, l'impression du monde, du dehors
dans une âme, un corps.
Comme les quatre causes d'Aristote, la matière, l'auteur, la fin, la forme, dont les Cahiers n'auront célébré qu'une
seule, l'efficiente, ne suffisent pas, on en inventera d'autres, plus subjectives, transcendantales, objectives,
pataphysiques, sans pourtant réussir à expliquer d'où ça vient. Du dedans ou du dehors ? Du cerveau ou du corps ? De
partout ou de nulle part ? On s'y perd, nécessairement ; l'origine se perd dans la nuit des temps, la nuit de ces "sommeils
touffus" où l'on aime les rêves et dont les salles dites obscures visent à recréer les conditions. Si l'origine se perd, c'est
que le cinéma, ça vient de loin ; il faut le croire ; des Lumières, des momies, du travail du deuil, de toutes les pratiques
plus ou moins fantastiques qui visent à garder les morts en vie, à faire revenir les absents, et de plus loin encore, de la
lumière qui éclaira pour la première fois le monde, et dont l'astrophysique fait l'analyse spectrale ; l'origine se dérobe
avec les galaxies, que l'on fait fuir en les poursuivant, selon cette logique comique décrite par Derrida, et souvent mise
en scène par Chaplin, qui nous fait moins courir après l'autre pour le rattraper, le capturer, que pour le faire fuir, le tenir
à distance, l'éloigner, l'exorciser.
Les filles le savent, qui trop court après elles, risque de les chasser, de les faire courir.
Chassons plutôt les spectres du cinéma.
"Ecrire du cinéma", si l'origine du cinéma nous fuit en nous attirant, nous hante, comme toutes les origines, c'est
nécessairement écrire sur l'absence d'origine, la fuite des origines, leurs fugues. D'une voix à l'autre. Ecrire du cinéma,
depuis le cinéma, n'est qu'un rêve, une vaine passion, la passion vaine du désir métaphysique de présence, de la
présence, à quoi certains auront identifié l'essence du cinéma ; art ontologique qui donne, montre, ce que les autres arts
ne font que représenter, en redoublant, et doublant nécessairement l'être, le réel, et sa "robe sans couture". Si l'on ne peut
écrire du cinéma en faisant du cinéma l'origine de l'écriture, son unique objet, sa seule fin, notre seule référence, alors, il
faut se tourner vers notre pratique, ici, l'écriture de la pensée et des affects, la mise en scène de l'amour du cinéma, et
trouver en elle, l'origine du cinéma ; "écrire du cinéma", dès lors, ce n'est plus chercher dans le cinéma la loi de
l'écriture, mais bien plutôt faire du cinéma en l'écrivant ; "écrire du cinéma", comme on écrit un roman, une lettre
d'amour, un scénario, une carte postale, un texte sur un blog ou sur un forum ; écrire du cinéma, ce serait alors le
fictionner, l'inventer autant que l'agencer. Pour qui écrit c'est l'évidence. Le cinéma n'est pas une donnée ; il faut l'écrire,

le penser, si on l'aime et cherche à le garder dans la pensée. Cela est nécessaire plus que jamais, à l'heure des
spectralisations spectaculaires, des menaces fantômes, numériques et ludiques ; à l'heure où une certaine critique, qui fait
du plaisir un combat et du combat un plaisir, perdant dans ce tour de passe-passe sans magie, le plaisir de jouer et le
risque du polèros émancipateur, se complaît dans la caricature ; amnésique, sans sens de la généalogie déconstructrice,
sans fidélité à la puissance évanouissante de l'événement, sans capacité à le répéter en le gardant dans sa vérité, sans
force pour oser se libérer du cinéma afin de le libérer à cette essence sans essence qui laisse venir le monde en présence,
spectralement. Car l'écriture qui s'essaye à faire le cinéma, en l'écrivant et le pensant, n'est jamais seulement un discours
sur le cinéma. Le cinéma n'est pas, sans ses spectres ; toutes ces présences absentes qui le divisent en son dedans,
l'ouvrant à ses dehors, le mettent au dehors, le grand murmure anonyme. Que l'écriture du cinéma ne porte pas seulement
sur le cinéma, ne puisse jamais ne porter que sur le cinéma, même si elle ne vise que lui, cela peut se dire autrement,
simplement, en partant de son impureté bien connue, qui nous interdit de rien dire du cinéma, sans que ne se glissent
dans la pensée les fantômes, le souci de toutes ces formes, de ces arts, de ces pratiques qui le contaminent, la peinture, le
théâtre, la littérature, les télé-techno-sciences…
Parlant du cinéma, on parle nécessairement de ces spectres.
C'est pourquoi il nous faut garder à l'esprit que le cinéma n'existe pas, n'est pas, un objet, un référent, un étant, mais
une foule de spectres et de traces ; mémoires et promesses de résurrection, de retour, de répétition, d'avenir.
COMMENT NE PAS PARLER, DES SPECTRES, DU CINEMA
En apparence, rien ne nous oblige à cette aventure, à nous lancer dans cette chasse aux spectres du cinéma. On
pourrait ne rien dire, fermer sa gueule, ne pas protester, ne pas manifester, se manifester ; à quoi bon ajouter des mots
aux images, se plier aux exigences de la machine à produire de l'oubli et concourir ainsi à l'"universel reportage", cette
errance muette et spectrale des signes ? Mais, d'un autre côté, on ne peut y résister ; comment ne pas parler, quand on est
ému ? Comment ne pas parler si on est touché ? Comment ne pas parler quand on aime, et qu'il faut bien d'une manière
ou d'une autre se risquer à une déclaration ?
Comment ne pas parler du cinéma si on aime le cinéma ?
La question ne se pose pas parce que nous serions sommés de choisir entre le silence et la parole ; la décision
concerne uniquement l'essence critique de la critique, le partage entre bien parler, parler bien ou mal parler, parler mal ;
car parler, il faut bien le faire.
Si on aime le cinéma, il faut bien parler du cinéma.
Et pas de ses spectres ?
Mais comment les séparer ?
Comment séparer les spectres du cinéma ?
Affaire de rhétorique, de bonté, d'ajustement, de justesse, question éthico-politique ; il faut faire justice au cinéma et à
ses spectres, leur rendre justice ; eux, qui dans la fiction et dans la vie ne reviennent souvent nous hanter que pour
réclamer une manière ou l'autre de justice, réparer un oubli ; il faut bien parler pour rendre justice aux spectres du
cinéma ; une histoire du bien et de ses rhétoriques, de ces tours de passe-passe où parfois le bien parler, le parler bien, se
perd dans le jeu de formules vides qui oublient la chose même pour tourner autour du pot, dans le vide, faisant la roue ;
on doit dénoncer cette prostitution de l'esprit de l'écriture, de la pensée, qui ne doivent recevoir leur loi, leurs règles,
leurs injonctions que de la chose à dire, à penser, de cela à quoi il faut rendre justice ; cela est juste, pourtant, on ne peut
sacrifier le plaisir de dire, à dire, son amour, à jouer. L'amour, que certains placent à l'origine même de la parole, fait
causer selon bien des guises, des déguisements ; il s'avance masqué, parfois, faisant mine de jouer, de peur d'être pris au
sérieux et repoussé, ou alors il joue sérieusement, vraiment, débordant d'esprit, d'invention.
L'amour donne de l'esprit, quand il ne le fait pas perdre, quand il ne vous fait pas bafouiller, balbutier des âneries ou
bégayer comme l'inventeur d'une langue étrangère à la langue commune.
Cet esprit, donné, perdu, retrouvé, il faut bien en faire quelque chose ; faire de l'esprit avec l'esprit ? Oui, puisque
l'esprit n'est pas un, étant partagé, divisé, hanté, comme le rappelle Derrida à Heidegger, qui, lui, prenait l'esprit au
sérieux, le croyait un, propre à la seule langue allemande.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
1
/
77
100%