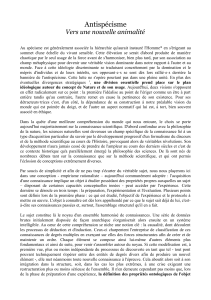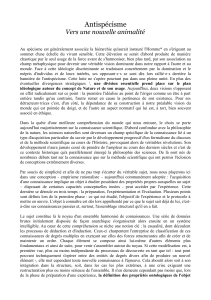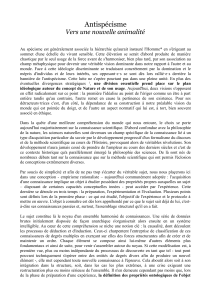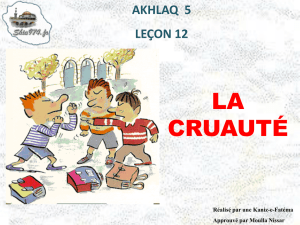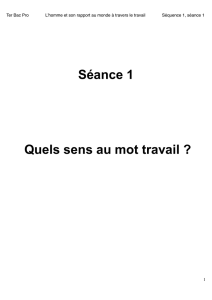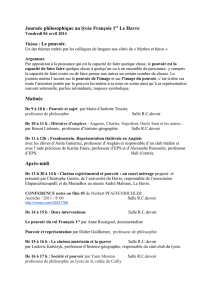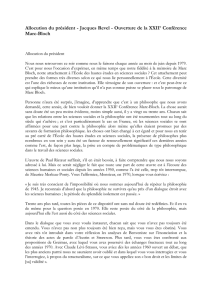L`APOSTILLE, Janvier 2013, N° 40

JOURNAL DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE PARIS 7
http://www.depaes.univ-paris-diderot.fr
D
Soit un «grand» philosophe - Kant - et un gros animal - l’éléphant. Mélangez.
Vous obtiendrez la dénition suivante : «l’éléphant a aussi une queue courte
avec de longs poils raides dont on se sert pour nettoyer les pipes». (in Géo-
graphie, le règne animal).
Qu’est-ce qu’un animal en dehors des propriétés et qualités dont nous pourrions
faire usage, et qui décident de son sort, c’est à dire, en fait de sa vie ou de sa mort ?
Chasse, domestication, élevage, objet d’expérimentation en laboratoire, objet d’ex-
hibition voire matériau du bio-art, l’animal est partout instrumentalisé, exploité,
nié dans son être propre quand il n’est pas massacré pour nos besoins alimentaires
ou simplement ludiques… Cette habitude millénaire dans notre civilisation nous
a accoutumés à anesthésier tout sentiment vis-à-vis de la sourance animale.
L’empathie que d’aucuns manifestent spontanément apparaît comme suspecte, et
sujette à moqueries. L’on objectera que le tableau est exagérément noirci et que
notre culture occidentale a évolué puisqu’elle a ni par adopter des lois condam-
nant les tortures et actes de cruauté gratuite inigés aux animaux. La question
que l’on est en droit de se poser ici est jusqu’où va la «gratuité» ? Doit-on, par
exemple considérer que la mise à mort du taureau dans l’arène n’est pas un acte de
cruauté gratuite parce qu’il y a le déploiement d’un «art» - l’art tauromachique - et
que par ailleurs, cet art produit une jouissance esthétique dont s’enorgueillissent
tous les acionados de corridas, et qui ne doit rien à la jouissance vulgaire, celle
que donne chez certains la puissance de faire sourir ? Par ailleurs comment ne
pas souligner combien cette législation a été tardive, combien elle est inexistante
dans la majorités des états du monde et combien elle est dicile à appliquer…
Combien est donc profonde notre indiérence au sort des animaux que nous
exterminons par millions en cas d’épizootie ; que nous livrons sans état d’âme à
l’abattage massif dont nous voulons ignorer les conditions réelles dans lesquelles
celui-ci s’eectue ; indiérence aussi vis-à-vis des conditions de vie qu’impose aux
animaux l’élevage industriel : poulets de batterie qui meurent étoués par manque
de place ; animaux rendus obèses pour accélérer l’exécution, considérés comme de
la viande sur pieds avant qu’elle ne se retrouve dans nos assiettes !
Cette cruauté, ou au mieux, cette indiérence au sort réservé à l’animal pose
de multiples questions d’ordre, juridique, éthique, politique, écologique et…
philosophique. En ce qui concerne la philosophie j’aimerais renvoyer aux deux
ouvrages qui sont la source de cette réexion : il s’agit d’une part de Liberté et
inquiétude de la vie animale (Editions Kimé, Paris, 2006) et d’Une autre existence-
La condition animale ( Editions Albin Michel, Paris 2012) tous deux écrits par
une philosophe : Florence Burgat . Celle-ci poursuit deux objectifs : repenser
le concept d’animal pour lui donner un nouveau statut, l’arracher à celui d’objet
vivant, an de lui reconnaître des droits. Montrer comment notre façon de pen-
L’ANIMAL, AVENIR DE L’HOMME ?
par Marie-Pierre Baudrier
Directrice Pédagogique de L’Université Ouverte
L’université Ouverte
vous présente
ses meilleurs voeux
et vous souhaite

ser l’animal et l’animalité est la consé-
quence d’un rationalisme triomphant
inauguré par Descartes, conduisant à
cette hégémonie de la technique toute
puissante, dénoncée par Heidegger et
soutenue par nos valeurs humanistes.
Il y aurait donc une face cachée de
nos valeurs humanistes qui appelle
un véritable travail de déconstruction
de ces dernières et de leur étayage sur
des concepts fondateurs de la philoso-
phie occidentale. Cette déconstruction
produit un véritable vacillement
philosophique, qui voit ses assises
considérablement ébranlées. Mais, il
est des vacillements salvateurs…
A
C’est une forêt profonde, mys-
térieuse trouée par une petite
mare reétant la brèche des
cieux d’un bleu lapis lazulli, dans la-
quelle s’épanouit une vie luxuriante :
des espèces variées, domestiques ou
sauvages, exotiques aussi (on distingue
un lion, un dromadaire mais aussi un
dodo - ancêtre du dindon - disparu
depuis le XVIIIème siècle) s’ébattent
dans cette nature édénique. La toile,
œuvre du peintre amand Roelandt
Savery du début du XVIIème siècle,
porte comme titre : Noé remerciant
Dieu d’avoir sauvé la création. Mais
l’œil ne voit pas Noé, petit personnage
à demi dissimulé par la végétation et
les animaux qui paissent autour de lui.
Tout se passe comme si le peintre avait voulu xer un eacement, un décentre-
ment invitant par là à la méditation sur notre place : que sommes-nous face à la
richesse innie de la création ? Traduisons : que sommes-nous dans l’histoire du
développement des formes du vivant ?
La Bible, comme la philosophie qui s’en réclamera longtemps accordent à
l’Homme une place centrale, dessinant une ligne de partage entre l’animal et l’hu-
main ; frontière infranchissable pour le plus grand malheur de l’un comme de
l’autre (c’est ce que nous essaierons de montrer).
Cette coupure anthropo-zoologique confèrera à l’animal une indigence
ontologique : en eet l’animal est l’être qui est dépourvu de langage, de raison,
de conscience, de pensée ; l’animal est cette «grandeur négative» dont l’homme
a besoin pour asseoir sa suprématie. Mais cette privation de toute faculté qui
de près ou de loin nous apparenterait à lui, nous inscrivant ainsi dans une sorte
de continuum du vivant, est ce qui, philosophiquement parlant, autorise la cho-
séication de l’animal et par là, les violences qui lui sont faites. Comme le dit
très justement Françoise Armengaud, éthologue : «l’humanité est cette vaste
entreprise d’extraction de l’animalité». En eet, «s’humaniser» signie s’arracher
à sa propre animalité, ou bien encore substituer au poids de l’instinct, la force
de notre raison. Cette rupture homme/animal, permet donc, non seulement de
mettre l’homme au centre de l’univers, seigneur et maître disposant à sa conve-
nance de toutes choses ; mais elle est ce qui dote durablement la philosophie d’un
ensemble d’oppositions conceptuelles qui formeront un véritable carcan de notre
pensée : nature/culture ; instinct/raison ; déterminisme/liberté ; âme/corps etc…
L’animalité a été construite de toute pièce, dans notre histoire, pour asseoir l’idée
d’une spécicité humaine, d’un «propre de l’homme», intangible, célébré par
la métaphysique, veine nourricière de notre humanisme, le tout corroboré par
l’anthropologie. De sorte que la question de l’homme est venue occulter l’homme
comme question : au lieu de suivre l’élaboration du concept d’humanité dans l’his-
toire, et d’en faire la généalogie au sens nietzschéen, c’est à dire, d’interroger les
forces obscures à l’œuvre dans son édication, la philosophie en a fait une évidence,
un sol originaire que rien ne pourrait jamais venir ébranler. Ainsi le monstre, le
pervers dont le comportement aberrant nous emplit d’eroi est-il, pour nous,
celui qui «a perdu son humanité» et est retombé dans l’animalité. Mais cette «ani-
malité» de l’homme - synonyme de brutalité, de dépravation - que montre-t-elle
d’autre si ce n’est un champ de possibles qu’ouvre en permanence le sillon que
creuse l’humain ? Car, comme le rappelle si justement F. Burgat citant Derrida :
«L’on peut s’interroger sur le fait que le seul propre de l’homme dont on soit sûr, le
2
Noé remerciant Dieu d’avoir sauvé la création - Roelandt Savery

3
seul trait, qui, une fois passé au crible la
liste des propres de l’homme, ne saurait
en aucun cas être attribué à l’animal ou
au dieu, c’est la bêtise ou la bestialité».
Voilà donc l’animalité : la projection
d’une humanité horriée par sa propre
férocité ; ce qui doit être nié et promp-
tement dompté par la loi morale. Mais,
paradoxalement l’animalité ne nous dit
rien de l’animal ; toujours elle nous ren-
voie à nous-mêmes : soit à notre huma-
nité déchue (thématique de la chute) ;
soit, au contraire à une part de nous-
mêmes que nous aurions perdue et qui
serait ce noyau originel et bon puisque
naturel, vierge de tous les artices et
les dégurations que nous impose la
vie en société (on aura reconnu un des
thèmes rousseauistes). Cette animalité
heureuse - que l’on se gure comme
telle - renvoie à l’ordre du besoin, facile-
ment contenté, à un bonheur confondu
avec la simple satisfaction organique.
Dans les deux cas, l’animalité est ce dé-
tour au moyen duquel l’humanité tente
de s’appréhender et de se comprendre ;
elle n’est jamais pensée en elle-même et
pour elle-même. Longtemps l’animal a
fait gure d’impensé de la philosophie
; son exclusion a été totale jusqu’à la
sourance qui lui a été déniée…
D
La dévalorisation de l’animal,
bibliquement établie, s’est trou-
vée confortée par le cartésia-
nisme qui marque pourtant l’entrée
dans la période moderne. En eet, on
doit au mécanisme cartésien l’élabora-
tion de la célèbre théorie de l’animal-
machine qui réduit l’animal à n’être
qu’un assemblage d’os, de nerfs et de
muscles, parcourus en tous sens par
«les esprits animaux» qui commandent
le mouvement et la sensation. Mais,
dépourvu de toute pensée, l’animal ne
sait pas ce qu’il sent ; conséquemment
on ne peut dire qu’il soure. Il a une
sensation douloureuse : c’est que la
douleur n’engage que la sensorialité là
où la sourance implique une dimen-
sion cognitive et réexive ; la douleur
«se sent» ; la sourance se «ressent».
La douleur n’aecte que telle ou telle
partie d’un corps, alors que dans la
sourance, c’est mon être tout entier
qui se trouve impliqué, engagé ; la
sourance se donne donc comme une
expérience existentielle , au travers de
laquelle c’est notre rapport au monde
qui se trouve modié, altéré. On voit
donc ici comment ce qui aurait pu être
le lieu d’une expérience commune,
se trouve au contraire l’instrument
permettant de redoubler la coupure
anthropo-zoologique, comme celui
permettant de disposer à sa guise de
l’animal, de le mutiler, le torturer sans
culpabilité aucune.
Dans le premier chapitre de Liber-
té et inquiétude de la vie animale,
F. Burgat montre par quelles voies l’on
peut tenter de sortir de cette surdité
philosophique. C’est à la phénomé-
nologie, particulièrement aux travaux
de Merleau-Ponty qu’elle emprunte sa
théorie de la corporéité, et avec elle,
les analyses portant sur l’organisme et
le comportement, le tout enrichi par
les données éthologiques.
Les animaux évolués semblent éprou-
ver cette cassure existentielle que
cause l’expérience de la douleur. Le re-
trait, la prostration, la recherche d’un
lieu où se cacher, ne sont-ils pas les
indices que pour eux aussi un rapport
au monde, aux congénères, s’altère ;
que le monde même s’abolit ? Le vécu
de ce type d’expérience ne les conduit-
il pas à éprouver de la détresse, voire
de l’angoisse - concept que l’on peut
«ouvrir» en le débarrassant de son
sens métaphysique qui veut que
l’angoisse gure ce moment où nous
rencontrons notre nitude et notre
contingence radicale que l’on peut
alors accorder à l’animal sourant, qui
sent la mort l’approcher, sans avoir à
sa disposition de quoi symboliser cette
expérience et qui la vit comme absolue
dissolution ? Rupture de tout lien, y
compris de celui qu’il entretenait avec
son propre corps ?
L’A -
Dépossédé de tout, l’animal se
voit refuser la notion d’exis-
tence même ! C’est qu’exister,
du latin ex-sistere qui signie littéra-
lement se tenir hors de soi, implique
l’idée d’une séparation de soi, réser-
vée à une conscience rééchie, seule
capable de produire ce retour sur soi
que l’on nomme traditionnellement
«réexivité». C’est sur cette idée d’une
séparation de soi, d’une distance
maintenue entre le Je et le Moi ; le soi
et le soi-même, que les diérents cou-
rants existentialistes, particulièrement
l’existentialisme sartrien, à la suite de
Heidegger, vont présenter la situation
de l’être humain comme étant celle
d’un être-jeté-dans-le-monde, ne
trouvant aucun sol originaire sur le-
quel se fonder - ce que Sartre appelle
notre «radicale contingence» - ni un
sens vers lequel s’orienter. Rien de
tel, évidemment chez l’animal, déni
comme «simple vivant». L’animal vit,
mais n’existe pas. Cette non-existence
le conduit à évoluer dans son milieu
auquel il adhère, dans une immanence
étale «comme de l’eau à l’intérieur de
l’eau» pour reprendre l’image emprun-
tée à Georges Bataille dans éorie de
la religion. Mais ce rejet de l’animal
dans la vie - la vie nue, réduite à un
ensemble de processus biochimiques -
de même que la scission que l’on veut
à tout prix instaurer et maintenir entre
vie et existence, apparaissent bien
plutôt, au terme de cette analyse
comme de simples postulats que
l’humanisme et la rationalité techni-
cienne triomphante ont imposés pour
disposer de ce «simple vivant» et s’en
servir à ses propres ns.
Car, enn, rien dans les sciences de
l’animal ne vient corroborer ces ar-
mations ! Bien au contraire, l’éthologie,
depuis les études de Konrad Lorenz et
celles de von Uexküll sur les mondes
humains et les mondes animaux, ont
précisément montré que l’animal dis-
posait d’un monde - entendu comme
espace dans lequel, pour chaque
espèce, se constituent des éléments de
signication, que l’animal décrypte, et
auxquels il adapte son comportement.
Ainsi donc l’animal - du moins pour
les espèces évoluées - peut être dit
«sujet» de ses propres expériences.
Et la notion même de comportement,
si magistralement analysée par
Merleau-ponty doit ici être invoquée,
si l’on veut mettre un terme à notre
misère anthropocentrique. Le com-
portement animal n’est pas réductible
à un schéma stimulus/réponse ; il n’est
pas cette réponse instinctuelle qui
Noé remerciant Dieu d’avoir sauvé la création - Roelandt Savery

4
n’engagerait qu’un plan physiologique.
Il laisse apparaître, au contraire, une
possibilité de choix, donc de liberté -
même restreinte - Il révèle par exemple
que l’objet susceptible de procurer de la
satisfaction peut conduire l’animal à la
trouver dans un leurre. Mais, précisé-
ment, cette possibilité de se leurrer, loin
d’être le signe d’une imbécillité, gure
au contraire la capacité à halluciner
l’objet, à le fantasmer. Or, ici, s’eectue
probablement un passage qui est celui
du pur instinct au symbolique, au tra-
vers duquel l’objet devient signe. Mais
si l’objet peut devenir signe, cela signi-
e que l’organisme lui-même entretient
une relation symbolique à l’objet. La
rupture ontologique majeure se situe-
rait donc non pas entre l’animal et l’hu-
main, mais bien plutôt entre le végétal
et l’animal !
L
’ ’
C’est donc à une véritable dé-
construction de notre édice
philosophique que la question
de l’animalité conduit. Ce sont les no-
tions de conscience, de sujet, de désir,
4
de représentation, pour ne citer que les
plus importantes qu’il faut reconsidé-
rer. Ainsi être conscient ne signie-t-il
que savoir et savoir que l’on sait ? N’y
a-t-il qu’un seul mode de conscience ?
Le sujet implique-t-il nécessairement
l’idée d’un sujet rationnel et raison-
nable avec pour corollaire celle d’une
maîtrise du monde ?
Le philosophe Jacques Derrida (dans
un texte déjà cité) voyait dans la raison
instrumentale dont nous nous enor-
gueillissons «la mise en place d’une
structure sacricielle, c’est à dire une
place laissée libre pour une mise à mort
non criminelle» ce qui revient à dire,
qu’ainsi entendu «le sujet est un dispo-
sitif mortifère».
Il faut réinventer le sujet, ne serait-ce
que pour donner des droits aux ani-
maux, et faire en sorte que désormais
l’on ne puisse plus rien trouver dans
l’arsenal conceptuel de la philosophie
qui nous permette de les massacrer
«tranquillement», comme si de rien
n’était, fût-ce au nom d’un «art» ou
d’une tradition. On le voit, la ques-
tion de l’animal, loin d’être une ques-
tion marginale, exotique, apparaît au
contraire comme une question cen-
trale, primordiale dont l’enjeu nous
semble double : changer notre regard
sur l’animal, ce lointain prochain…
Lui accorder notre respect et notre
protection avant que le désastre
écologique auquel nous assistons
sonne la n de notre espèce.
Empêcher que le discours philoso-
phique lui-même ne se fasse l’allié et
l’instrument de ce désastre.
Et se rappeler que, comme le dit
Jean-Christophe Bailly, dans un livre
magnique, Le versant animal (Bayard,
2007) «il n’y a pas de règne, ni de
l’homme, ni de la bête, mais seulement
des passages, des souverainetés fur-
tives, des fuites, des rencontres». Nous
ne serons jamais sûrs de pouvoir nous
comprendre, ni même nous rencontrer
tant, entre l’homme et l’animal deux
nuits se mêlent… Nous nous tenons
sur des seuils mouvants, fragiles, d’une
absolue et poignante beauté….
Mais nous savons, ou devons savoir,
maintenant, que l’animal, sauvé, res-
tauré dans son existence comme dans
sa dignité, est l’avenir de l’homme.
nnn
Surpris - Henri Rousseau dit Le Douanier 1891

5
L P
En 2009 à l’Université Ouverte, ierry Mauger consacrait un séminaire
à l’Arabie Saoudite traditionnelle (L’Arabie des origines). Un cours était
consacré à l’iconoclasme saoudien. On a souvent répété que l’islam inter-
disait la représentation gurée. Le Coran n’interdit nulle part l’image. Il rejette
seulement les ansab (pierres dressées, bétyles, stèles ou encore idoles). C’est
dans les hadiths (les paroles rapportées du Prophète) qu’on trouve des inter-
dictions de la représentation d’êtres animés. En Arabie Saoudite, tous ces pro-
blèmes liés à la représentation sont dus au wahhâbisme qui est un mouvement
sectaire né en Arabie au XVIIIème, une forme d’islam pur et dur dont se reven-
diquent les salastes et les talibans. Tout le monde garde à l’esprit les caricatures
danoises du Prophète reprises par Charlie Hebdo. C’est tout le problème de la
liberté d’expression qui fut alors l’objet d’un débat virulent.
En passant de l’Arabie Saoudite au Kirghizistan comme nouveau terrain de
recherches, objet d’un séminaire programmé pour l’année 2012-2013, ierry
Mauger a été frappé par la diérence d’attitude à l’égard des images entre les
deux pays. Bien qu’islamique et de rite sunnite (comme l’Arabie Saoudite) pour
la plupart de ses habitants, le Kirghizistan ne manifeste aucune hostilité à l’en-
droit des images et c’est cette première constatation dont il fait part à une amie
art-thérapeute, Chantal G…, qui accompagne des enfants retardés mentale-
ment dans la représentation de gures humaines par le dessin.
L K
Bonjour Chantal,
Ma première surprise, après l’Arabie Saoudite, c’est que le problème de l’image et
de la photographie ne se pose plus dans l’islam centrasiatique. Non seulement les
Kirghiz se laissent photographier, mais ils sont ravis d’être saisis sur de la pellicule.
Et les images pullulent sur les façades des tombes dans les cimetières musulmans,
au grand dam des imams formés à l’école wahhâbite des Saoudiens.
Une telle présence iconique remonte sans doute aux Mongols. Je me souviens de
mes recherches à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales sur “le problème
de l’image dans le monde islamique ”. Entre les séries des miniatures “ottomanes”
et des miniatures “mongoles” du Musée de Topkapi, on note que celles-ci repré-
sentent le Prophète et les femmes le visage découvert alors que celles-là les voilent.
Ces deux séries correspondent à des substrats culturels diérents. Dans les minia-
tures “mongoles”, les personnages ont le type mongol, notamment le Prophète,
mais les traits des visages sont indiérenciés, ce qu’André Papadopoulo appelle
une typologie esthétique. L’explication est simple ; les Mongols se sont ralliés rapi-
dement à l’islam, vers le XIIIème siècle, mais avec une forte tradition bouddhique
derrière eux où l’image occupe une place centrale, elle-même apportée par les
Grecs d’Alexandre Le Grand.
L’image nous détourne-t-elle du sacré ou nous y conduit-elle ? Pour les sunnites
orthodoxes, Mahomet est un homme ordinaire qui ne se diérencie des autres que
par le fait d’avoir été choisi par Allâh pour transmettre son message. On relève
du même coup la contradiction : si Mahomet est un homme ordinaire, pourquoi
s’interdirait-on de le représenter ? En voilant son visage, l’artiste l’incarne d’une
façon qui le distingue des autres mortels. Figure paradigmatique de l’anonymat, il
acquiert du même coup l’expression divine la plus radicale !
LETTRE KIRGHIZE
«Mon vrai visage est dans les livres»
disait Henri Michaud. «Qui veut voir le
prophète doit regarder le Coran». Une
telle armation vise à transformer le
corps physique du Livre Saint en texte.
En d’autres termes, le mystique rejoint
le Prophète dans le corps même de la
textualité du Coran qui est le miroir du
Prophète ; l’aspect physique de celui-
ci n’a plus aucune pertinence, il n’y a
plus lieu de chercher le type idéal de
l’homme, une façon de barrer l’accès à
toute représentation idolâtre. Et le tour
est joué.
Mais il y a plus fort puisque le fonda-
teur de la secte des Hurus reconnais-
sait sur le visage les lettres du nom
d’Allâh et voyait là une preuve de la
présence du divin dans l’homme. C’est
ainsi que l’artiste américaine Christina
Varga a créé en 2001 un portrait néo-
byzantin de Mahomet avec de la calli-
graphie arabe à la place du visage.
Avec mes amitiés.
ierry
Le problème est d’actualité en 2006 avec les
publications des caricatures du Prophète qui
provoquèrent une levée de boucliers dans le
monde islamique.
nnn
par Thierry Mauger
Professeur à L’Université Ouverte
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%