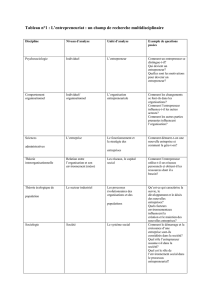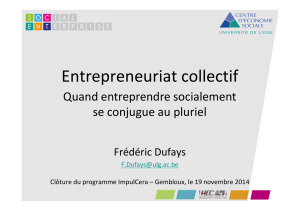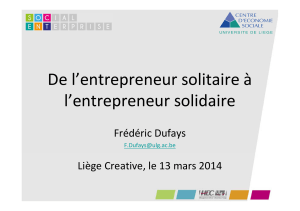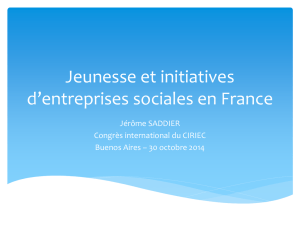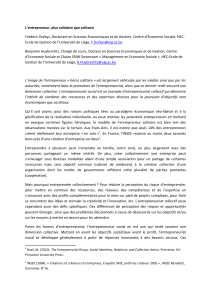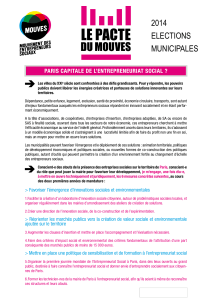Communication N°A16C51

La force du local et son entrepreneur
Jean-Jacques OBRECHT
Professeur émérite
Université Robert-Schuman
CESAG, École de Management de Strasbourg
Professeur honoraire de l’INSCAE, Antananarivo, Madagascar
RÉSUMÉ
L’objet de l’étude est double. Il s’agit d’abord d’élaborer un outil conceptuel dénommé « la
force du local » en étendant le paradigme fondateur de la « force des liens faibles » de M.
Granovetter aux questions du développement territorial et du développement durable. Ensuite
de montrer de quelle manière l’entrepreneur participe à la construction de la force du local à
l’aide du modèle de l’« entrepreneur effectuel » de S. Sarasvathy qui fait de l’entrepreneuriat
un processus collectif. Cette approche contextualisée de l’entrepreneuriat mobilise des outils
conceptuels multidisciplinaires.
Le but de cette démarche est de contribuer au renouvellement de la réflexion dans les
approches, en termes de territoire et d’entrepreneuriat, des problèmes du développement
global des pays du Sud. Pour apporter au thème émergent de l’« entrepreneuriat soutenable »
des éléments nouveaux, on met en avant le concept de « capabilités entrepreneuriales ». En
partie déterminées par les structures encastrantes de territoire, de réseau et de société, elles
composent la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus à agir en symbiose avec les
exigences du développement durable. En conclusion on suggère quelques pistes de recherches
pour les travaux empiriques qui valideraient le « modèle » proposé.
MOTS CLÉS
L’entrepreneur − Proximités et développement local − Développement durable

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
La force du local et son entrepreneur 2
Les références au « local » sont aujourd’hui incontournables quand on s’interroge sur les
conditions d’efficacité de l’action entrepreneuriale dans les petites entreprises ou sur les
conditions de réussite d’une politique de développement durable. Les deux problématiques,
de toute évidence, se croisent au niveau du local ce qui nous amène à proposer une réflexion
sur les facteurs qui, dans un espace territorial, permettent de construire les bases du
développement durable et sur ceux qui, au niveau de l’entrepreneur, entrent dans sa capacité
de participer à cette construction. La nécessité de cette réflexion nous semble particulièrement
avérée en considération des problèmes que rencontrent les pays de l’hémisphère Sud où
l’entrepreneuriat passe pour être le meilleur « vaccin contre la pauvreté » (Fortin, 2000) mais
où il peut aussi conduire à des « îlots de richesse dans des océans de misère ».
En Sciences de Gestion, de nombreux travaux ont déjà été consacrés à l’entrepreneur
appréhendé dans ses interactions avec son milieu local. Avec d’un côté des analyses portant
plus particulièrement sur les facteurs qui, dans un espace local donné, sont favorables à
l’épanouissement de l’esprit d’entreprise et à l’action entrepreneuriale (Johannisson, 1984;
Marchesnay et Fourcade, 1996; Gasse, 2003 entre beaucoup d’autres). D’un autre côté, des
représentations de l’entrepreneur qui, par exemple, montrent celui-ci intégrant
l’environnement à travers les mécanismes de la cognition : il est « un organisateur tendant à
forcer la congruence entre l’environnement et sa vision » (Verstraete, 1999) sachant que les
bases de la vision entrepreneuriale sont formées par « les multiples contextes qui entourent
l’entrepreneur et son organisation » dans lesquels il s’agit de se positionner (Verstraete et
Saporta, 2006). La variété des facteurs contextuels locaux et leur articulation se trouvent
particulièrement bien mises en lumière dans un ouvrage récent de Pierre-André Julien où
celui-ci montre comment l’ » entrepreneuriat local » participe, dans une aventure qui est
collective, au développement de l’économie du savoir (Julien, 2008).
En situant notre problématique dans le cadre des pays en développement, il convient
cependant de se poser la question de la validité des modèles de l’entrepreneuriat conçus pour
et élaborés dans un environnement économique, social et culturel bien différent. Le facteur
local garde certes toute son importance en termes d’espace critique et du développement
durable et de l’action entrepreneuriale dans les pays du Sud. Mais la spécificité de leurs
dynamiques territoriales devrait, d’après certains travaux récents, conduire à un
renouvellement de la réflexion dans les approches, en termes de territoire, de la question du
développement global (Ferguène, Ed. 2004). De même dans ces pays, les comportements
entrepreneuriaux ne peuvent pas toujours s'inscrire dans les cadres de référence occidentaux.
Dans la zone de l’Océan Indien, certains dirigeants développent des visions et des ambitions
complexes intégrant une multitude de buts non lucratifs; leur "vision métissée des affaires les
rapprocherait, à certains égards, des organisations sans but lucratif" (Valeau, 2001). En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de nombreuses petites entreprises s’établissent avant tout pour
faciliter l’échange de dons et pour mettre en valeur la position sociale de leurs propriétaires :
la motivation par le profit est subordonnée à ces objectifs (Curry, 2005). Dans les Andes du
Pérou, la dynamique entrepreneuriale se déploie au sein des communautés locales dont le but
principal sera de se prendre en charge pour mieux lutter contre la pauvreté (Peredo, 2006).
Ailleurs encore, dans les Hautes Terres de Madagascar, les structures associatives sont
devenues des acteurs de premier plan de mise en oeuvre des projets de développement et
s’inscrivent dans une culture de la solidarité chère à la société malgache, le « fihavanana »
(Sandron, 2007). En entrepreneuriat aussi, il convient de penser le phénomène entrepreneurial
en le replaçant dans ses contextes et de se donner les moyens conceptuels pour le faire.

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
Dans cet esprit, on rejoint la position indiquée par Chris Steyaert considérant
« l’entrepreneuriat comme un espace hétérogène de thèmes qui se prête à une variété de
réflexions, un espace qui peut être connecté à beaucoup de formes de la pensée théorique et
auquel beaucoup de théoriciens peuvent se rattacher… » (Steyaert, 2005). D’un point de vue
sociologique, on distinguerait ainsi l’approche par l’offre et l’approche par la demande en
entrepreneuriat (Thornton, 1999). La première porte sur « l’offre d’individus propres à
occuper des rôles entrepreneuriaux » c’est-à-dire des individus comme moteurs de la lutte
concurrentielle sur les marchés et pour cela toujours attentifs aux opportunités nouvelles
rentables. La seconde porte sur « le nombre et la nature des rôles entrepreneuriaux qui doivent
être remplis » lesquels dépendent du « push and pull » du contexte dans lequel se déroule le
processus entrepreneurial. La logique de la demande en entrepreneuriat, parce qu’elle admet
le pluralisme des rôles que l’entrepreneur peut jouer dans des environnements variés, nous
semble particulièrement indiquée pour étudier l’entrepreneuriat de l’hémisphère Sud dans des
pays souvent marqués par ailleurs par des fortes différences en termes de gouvernance locale
au niveau des territoires. Dans cette logique, rien ne nous interdit en outre d’adopter une
position qui s’éloigne dans une certaine mesure de la pensée dominante en entrepreneuriat :
on considère la connaissance du contexte dans lequel se déroule le processus entrepreneurial
comme au moins aussi importante que celle du processus lui-même pour comprendre
l’entrepreneuriat (Dana et Dana, 2005). C’est là une posture épistémologique adoptée par
beaucoup de chercheurs en entrepreneuriat international.
Dans une telle approche contextualisée de l’entrepreneuriat, il nous faut d’abord mobiliser les
concepts permettant de se donner une représentation structurée de l’environnement dans
lequel se déploie l’action entrepreneuriale. Quelques récents travaux en Sciences de Gestion
ont exploré dans ce sens les champs de la Nouvelle Sociologie Economique, de la Nouvelle
Géographie Economique et de l’Economie Régionale (Chollet, 2002; Plociniczak, 2002;
Ventolini, 2006; Trettin et Welter, 2008). Notre dessein est de faire une synthèse des facteurs
qui déterminent plus particulièrement le dynamisme territorial en partant du concept
fondateur de la « force des liens faibles » de Mark Granovetter (Granovetter, 1973 et 83) et en
les restituant en format compressé dans ce que nous appelons la « force du local ».
Il nous faut ensuite trouver une figure d’entrepreneur dont la logique de comportement soit
compatible avec la pluralité des rôles qu’il peut devoir jouer dans des contextes variés,
notamment comme ceux des pays du Sud. Nous pensons l’avoir rencontré, sur le plan
théorique, dans le modèle de « l’entrepreneur effectuel », encore largement ignoré dans la
littérature de langue française (Sarasvathy, 2000 et 2001). Dans le droit fil de la pensée
d’auteurs comme James March et Herbert Simon, Saras Sarasvathy part de l’hypothèse que
l’évolution de l’environnement entrepreneurial est imprévisible et que, de ce fait,
l’entrepreneur ne peut pas s’y positionner sur la base d’objectifs prédéterminés. Mais il peut
construire son futur à partir d’un ensemble de moyens existants selon une « logique
d’effectuation », distincte de la « logique de causation » qui est celle de l’entrepreneur auquel
l’abondante littérature en entrepreneuriat nous a habitués. Dans une perspective « resource-
based », Saras Sarasvathy formule cette question des moyens en termes de « capabilités » de
l’entrepreneur effectuel. Dans cette logique nous pouvons utiliser son modèle comme cadre
d’une réflexion sur l’« entrepreneuriat soutenable » c’est-à-dire un entrepreneuriat qui soit en
symbiose avec les exigences du développement durable.
La première partie est consacrée à repérer dans différents champs théoriques les éléments qui
constituent la force du local et à montrer comment celle-ci s’inscrit dans la problématique du
développement territorial durable. La deuxième partie introduit l’entrepreneur effectuel et, en
La force du local et son entrepreneur 3

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
établissant le lien avec cette problématique, esquisse un modèle d’ entrepreneuriat effectuel
soutenable qui mettra en avant le concept de « capabilités entrepreneuriales ». En guise de
conclusion sont formulées quelques pistes de recherche.
1. ESSENCE DE LA FORCE DU LOCAL ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le point de départ de notre réflexion est la fameuse proposition de Mark Granovetter
concernant la « force des liens faibles » que l’on retrouve sous diverses formulations chez
certains théoriciens du capital social. On se réfère ensuite aux « dynamiques de la proximité »
qui opèrent l’encastrement territorial du capital social et qui, de ce fait mais sous certaines
conditions, participent au processus du développement territorial durable.
1.1. De la « force des liens faibles » aux « trous structuraux » du capital social
L’hypothèse fondatrice de Mark Granovetter s’applique au niveau des réseaux de relations
sociales prises dans leur ensemble, donc celles qui constituent l’ » encastrement structural » et
dans lesquelles s’inscrit toute activité économique. Quant à la différence entre liens forts et
faibles, elle se comprend intuitivement par comparaison avec la différence qui existe en
termes de densité de relations dans nos rapports avec nos amis proches et nos connaissances
lointaines. Pour Mark Granovetter, il s’agit d’expliquer à partir du concept de « strength of
weak ties» les conditions de la cohésion globale des structures sociales (Granovetter, 1973,
1983 et 1985).
En l’absence de liens faibles entre des réseaux fondés sur des liens forts, les structures
sociales dans leur ensemble sont exposées à la fragmentation. Là où les réseaux à liens forts
sont prévalents, le phénomène de formation de « cliques » est susceptible de se produire.
« Les systèmes sociaux dépourvus de liens faibles, seront fragmentés et incohérents. Les
nouvelles idées se répandent lentement, les efforts scientifiques seront handicapés et des sous-
groupes séparés par la race, l’ethnie, la géographie ou d’autres caractéristiques auront des
difficultés pour trouver un modus vivendi ». La fonction des liens faibles est donc de servir de
pièces de liaison entre des réseaux à forte densité relationnelle.
Déjà dans l’œuvre de Mark Granovetter, le concept de « pouvoir cohésif des liens faibles »
avait été utilisé comme un moyen d’expliquer certaines questions cruciales comme celle de la
pauvreté dans le monde. « L’intense concentration d’énergie sociale dans des liens forts, dit-
il, a pour effet de fragmenter les communautés des pauvres en réseaux encapsulés avec des
connexions très médiocres entre ces unités; les individus ainsi encapsulés peuvent alors perdre
quelques uns des avantages associés aux effets des liens faibles. Ceci est peut être une raison
de plus qui fait que la pauvreté se perpétue d’elle-même » (Granovetter, 1983).
En tant que paradigme reconnu, l’hypothèse de Granovetter a laissé sa marque dans celles des
approches théoriques du capital social qui appréhendent celui-ci comme une ressource
collective auquel un ensemble d’acteurs peut accéder au niveau d’un groupe, d’un réseau ou
d’autres structures sociales. C’est dans ce sens qu’il faut entendre le « social capital » du
sociologue James Coleman ou du politologue Robert Putnam qui le perçoivent comme un
bien public dans une société fondamentalement consensuelle alors que pour le sociologue
engagé Pierre Bourdieu le « capital social », replacé dans l’ensemble de son œuvre, est un
instrument d’analyse des relations de pouvoir dans une société fondamentalement
conflictuelle (Ponthieux, 2004). Les extensions les plus significatives que le principe de la
La force du local et son entrepreneur 4

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
« force des liens faibles » a trouvées dans la littérature sur le « social capital » s’avèrent
particulièrement utiles à nos réflexions sur les conditions de construction de la force du local
au niveau d’un territoire.
La référence aux travaux récents de Ronald Burt s’impose d’emblée. Pour cet auteur le capital
social est une « structure faite de réseaux » ou, plus précisément, un ensemble comportant
d’une part des réseaux qui sont des « trous structuraux » et d’autre part des réseaux fermés
(Burt, 2001). La partie critique du capital social est celle des « structural holes » : elle est
formée par « des réseaux où les gens interviennent comme des intermédiaires entre des
segments qui autrement seraient déconnectés… Les trous dans la structure sociale qui
résultent de connexions plus faibles entre groupes, apportent un avantage compétitif pour un
individu dont les relations s’étendent par-dessus ces trous ». Cela est dû au fait que « les trous
structuraux séparent les sources d’information non redondantes » c'est-à-dire que de part et
d’autre de chaque trou structural circulent des flux d’information différents. « Les trous
structuraux représentent donc des opportunités pour échanger le flux d’informations entre les
gens et pour contrôler les projets qui réunissent des gens venant des côtés opposés du trou ».
Pour la partie du capital social formée par des réseaux denses, Ronald Burt reprend dans une
certaine mesure le point de vue de James Coleman (Coleman, 1988). D’une part, dans les
réseaux où les connexions sont très fortes, le potentiel d’information est élevé et l’accès à
l’information facile - on peut gagner du temps à s’informer auprès d’un ami -; d’autre part le
fait qu’un réseau soit fermé, « network closure », facilite le mécanisme des sanctions qui
réduisent le risque auquel s’exposent les gens quand ils se font mutuellement confiance; la
violation des normes de conduite qui se développent dans ces réseaux est plus difficile. Pour
Ronald Burt les opportunités que représentent les trous structuraux l’emportent en termes de
performances possibles sur celles que peut offrir une structure fermée de réseau. Il suggère
finalement une relation de complémentarité entre les deux : « alors que l’établissement d’une
relation par-dessus les trous structuraux est une source de valeur ajoutée, la fermeture d’un
réseau peut être décisive pour réaliser la valeur ensevelie dans les trous structuraux ».
Dans le même ordre d’idées que Coleman, Robert Putnam (Putnam, 1993 et 2000) considère
que le « capital social se réfère aux caractéristiques de l’organisation sociale comme la
confiance, les normes et les réseaux qui améliorent l’efficience de la société en facilitant
l’action coordonnée ». Dans le droit fil de la pensée de Granovetter, il considère que le capital
social prend toute sa signification en tant que « bridging capital » qui se fonde sur la
valorisation des relations sociales entre des groupes hétérogènes alors que le « bonding
capital » trouve sa valeur au sein des groupes homogènes. Le capital qui établit des ponts est
nécessaire à la formation du lien social. Le capital qui enchaîne peut à la limite conduire à des
formes de réseaux nuisibles à la société et c’est ce que Robert Putnam souligne plus
particulièrement. Dans une perspective similaire les experts de la Banque Mondiale ont repris
ces concepts à leur compte pour ajouter celui de « linking » : elle fait référence aux liens
verticaux qui couvrent les différences en termes de pouvoir ou de statut. On insiste aussi sur
le fait que le capital social du type « bonding » peut avoir des effets d’exclusion et se mettre
en travers de la coopération au niveau d’une société dans son ensemble
1.2. Des dynamiques de proximité aux structures encastrantes du développement local
Des travaux en « économie de la proximité » qui ont pour objet de mieux comprendre le rôle
de l’espace dans la coordination des activités économiques, il ressort que le local n’est pas
simplement une question de distance géographique. On va même jusqu’à suggérer que « les
La force du local et son entrepreneur 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%