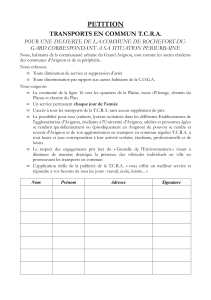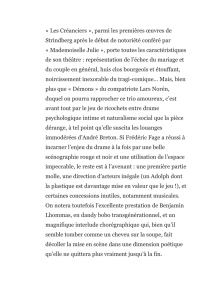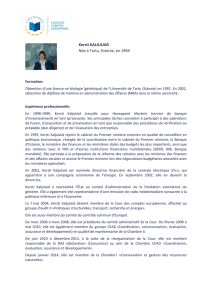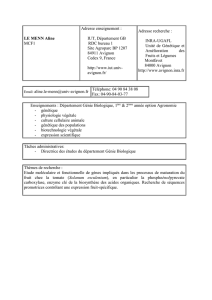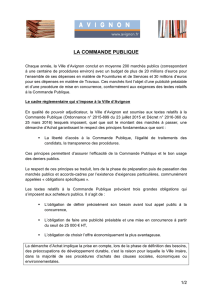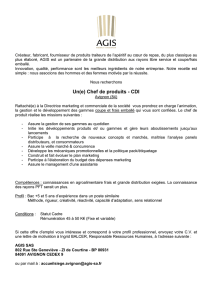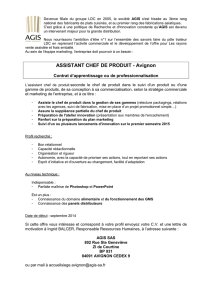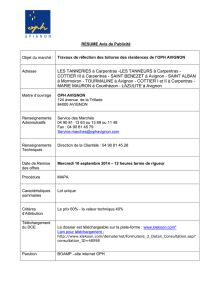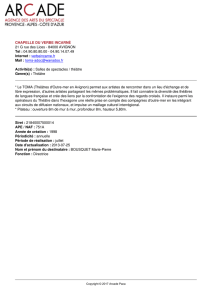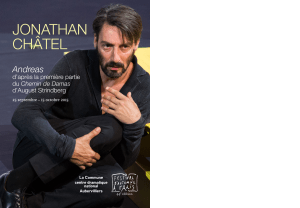La représentation du dimanche 18 juillet sera suivie d`un débat


La représentation du dimanche 18
juillet sera suivie d'un débat autour des
Droits de la femme animé par Martine
Benayoun, de la LICRA, en présence de
Sihem Habchi, Présidente du
Mouvement « Ni Putes Ni Soumises »
avec la participation exceptionnelle de
Marie-Christine Barrault - Paris dans
la Salle d'honneur de la Mairie
d'Avignon.
Site internet :
http://lamarieecouronnee.free.fr
Contact presse :
lamarieecouronnee@gmail.com

SYNOPSIS
Œuvre méconnue d’August Strindberg, cette pièce est une varia-
tion sur le thème de Roméo et Juliette en plein cœur de la Suède,
dans la province de Dalécarlie.
Deux familles se déchirent pour des histoires de partages de terres
et de rivalités de biens depuis de longues années lorsque Hans, fils
de la famille du Moulin tombe amoureux de Kersti, fille de la fa-
mille rivale. Les deux cachent leur amour lorsque survient la nais-
sance d’un enfant qui vient perturber la sérénité du jeune couple.
Que faire alors pour se marier dans des conditions respectables et
obtenir à tout prix la « couronne dorée », symbole de chasteté
d’une jeune mariée sauvant ainsi l’honneur de la famille ? Pour
cela, Kersti est prête à tout…
« Ecrire des drames, c'est tout de
même ce qu'il y a de plus intéressant.
Pareil à un petit dieu, on sonde les
coeurs et les reins..., on juge..., on
punit, on absout et on récompense. »
August Strindberg
ovince de Dalécarlie, au cœur de la Suède

AUTEUR
August Strindberg (1849-1912) appartient à la même génération de
dramaturges que le russe Tchekhov et le norvégien Ibsen. Moins connu que
Tchekhov, plus novateur qu’Ibsen, il contribue à fonder la modernité au
théâtre. On connaît Mademoiselle Julie, Père, Créanciers, La Danse de mort,
pièces souvent jouées en France. On ignore souvent l’énorme production
littéraire de Strindberg : pièces historiques, drames à stations ou jeux de rêve
pour qualifier des pièces inclassables comme Le chemin de Damas, pièces "
de chambre ", mais aussi récits, essais, articles, correspondance passionnante,
entre autres avec Zola ou Nietzsche, réflexions sur le théâtre partiellement
recueillies dans " Théâtre cruel, théâtre mystique " paru chez Gallimard en
1964. Strindberg, parcourant l’Europe sans trouver jamais de lieu qui apaise
ses angoisses, se révèle au carrefour d’influences aussi décisives que celles de
Schopenhauer, Schiller, Kierkegaard, Byron, ou des précurseurs de Freud
comme Bernheim .Il s’avère une formidable caisse de résonance de toutes les
tendances esthétiques de son temps, notamment dans ses prises de position sur
le naturalisme. Il est aussi un peintre étonnant, très lié à Edward Munch. Il se
passionne pour la chimie et se rêve alchimiste jusqu’à s’en brûler les mains. "
Ce qu’il me faut, c’est absolument savoir. Et pour cela je vais faire sur ma vie
une profonde, une discrète et scientifique enquête. Utilisant toutes les
ressources de la nouvelle science psychologique, en mettant à profit la
suggestion, la lecture de pensée, la torture mentale, […] je chercherai tout. "
La vie et l’œuvre de Strindberg se placent sous le signe de cette confession.
Tous ses écrits témoignent de sa vie et portent la trace de ses crises, de ses
combats, de ses révoltes contre une société au conformisme rigide qu’il
exècre et qui le décrètera scandaleux. Le moi de l’écrivain fonde l’unité de
cette énorme production littéraire, par delà les genres et par delà les diversités
formelles. Né en 1849, dans un milieu petit bourgeois, il perd sa mère à treize
ans et souffre du remariage d’un père trop autoritaire. Sa mère, fille
d’aubergiste, épousera son père après avoir été sa gouvernante puis sa
maîtresse. Ce roman familial est à l’origine du sentiment de déclassement,
d’entre deux, qui l’habite toute son existence. Il échoue dans la carrière de
comédien où il voulait s’engager, devenant, peut-être par dépit, auteur de
théâtre. Ses relations avec les femmes sont terriblement conflictuelles. Marié
et divorcé trois fois, il doit travailler beaucoup pour assurer la subsistance des
enfants qu’il a de chacun de ses mariages. La misogynie de Strindberg, son
antiféminisme bien connu, le diabolisent face à son rival Ibsen qui apparaît
depuis Maison de poupée comme un champion du féminisme. Strindberg
aime les femmes dans une recherche fusionnelle et de tels élans passionnés
qu’il ne peut qu’être déçu. C’est alors que l’ange adoré se transforme à ses
yeux en mégère prête à le vider de toute substance. Sa jalousie féroce envers
sa première épouse, la baronne Siri Von Essen est à l’origine de ses premiers
délires paranoïaques. Toute sa vie Strindberg traverse des crises délirantes
qu’il tente de décrire dans des textes autobiographiques, toute sa vie il lutte
contre ses fantômes pour extraire, in vivo, de son être, une œuvre noire qui
nous dit la détresse de l’homme d’aujourd’hui. Kafka, les expressionnistes,
Adamov dramaturge contemporain revendiquent fortement son héritage.
Comment ne pas penser qu’Artaud, qui monta Le Songe au théâtre Alfred
Jarry, n’ait pas puisé chez Strindberg le terme même de théâtre de la cruauté ?

METTEUR EN SCENE
Après l’obtention d’une médaille d’Or d’Art dramatique en tant que comédienne,
du diplôme d’état en tant qu’enseignante et d’un doctorat portant sur éthique et
esthétique en tant que chercheur, Guila Clara Kessous décide d’envisager l’art
dramatique comme espace-citoyen de façon combinatoire dans sa théorie et dans sa
pratique. Très vite confrontée à la réalité économique de l'entreprise, elle entreprend
un MBA spécialisé dans les affaires culturelles et le droit à l’ESSEC ; elle devient
ainsi productrice de ses spectacles et crée des partenariats avec l’UNESCO,
l’UNICEF, les Nations Unies, la LICRA, la Société Américaine de la Légion
d’Honneur, l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Ecole Internationale
des Nations Unies et la Fondation de France. C’est à l’Université de Boston qu’elle
rencontre Elie Wiesel qui accepte d’être le Mentor de sa thèse. Elle devient alors
élève du Prix Nobel pendant six années et produit et met en scène la pièce de
l’auteur "Le Procès de Shamgorod" en 2006 au 92Y Center de New York. Elle
traduit par la suite le texte dramatique d’Elie Wiesel "Il était une fois" et en crée la
première mondiale en 2007 à Boston en présence de l’auteur puis en Avignon à la
Chartreuse avec la complicité de comédiens de la Comédie Française et
d’intellectuels tels que Alexandre Adler. Tout au long de son travail de recherches
théoriques sur l’art dramatique, elle joue, produit, met en scène et enseigne en
France et à l’étranger notamment à l’Université de Boston, à l’Institut Universitaire
Elie Wiesel de Paris, Institut Universitaire d'Avignon et à l’Université de Harvard où
elle crée la première troupe de théâtre français au travers du spectacle « L'Echange »
de Paul Claudel. D’autres mises en scène suivront notamment la pièce
"Culture.com", réflexion sur les interrelations sociales du haut et du bas monde dont
elle est auteur et qui lui vaut la participation de John Malkovich en 2006 ; la pièce
"Hilda" de M. NDiaye sur l’esclavage moderne (soutien de l’UNESCO) qu’elle joue
en 2005 qui lui vaut le Dikalo (espoir interprétation) ainsi que de nombreuses autres
créations théâtrales toujours liées à des causes humanitaires qui la feront collaborer
avec des artistes tels que Daniel Mesguich, Theodore Bikel, Marissa Berenson,
James Taylor, Marie Christine Barrault, … Transposant ses techniques d’analyses
dramatiques au cinéma, elle réalise une série de court-métrages présentés au Festival
de Cannes 2006 (Sélection officielle du NY Film Festival) « En verre et contre
tout » travaillant sur la perspective de l’handicapé-objet dans la focalisation du
monde. Réalisatrice de nombreux documentaires, elle s’intéresse plus
particulièrement aux techniques du travail cinématographique (documentaire sur les
archives Marcel Carné) et théâtral (travail avec le dramaturge Jean Paul Wenzel).
Elle incarne également le premier rôle du film « Lyrics of my life» de P. Jérôme, qui
a fait l’ouverture du Festival international du film de Boston 2007 sur la
problématique de l’artiste et le bilinguisme. Après la pièce "Les Mains sales" de J.P.
Sartre montée à l’Université de Harvard en 2008, elle crée aux Nations Unies de
New York le spectacle « Si les droits de l’homme m’étaient contés » en hommage
au 60ème anniversaire de la Déclaration Internationale des Droits de l’Homme après
les évènements de Genève en 2009. On la retrouve en octobre 2009 au Festival
d’Automne à Paris mise en scène par Jean Pierre Vincent sur une adaptation de
textes de l’auteur Jean Charles Masséra portant sur une réflexion sociopolitique
contemporaine dans le cadre de l’opération ADAMI « Paroles d’acteurs 2009 ». Elle
est également sur scène en novembre 2009 à l’Odéon dans le cadre du spectacle « Je
meurs comme un pays » de l’auteur grec Dimitris Dimitriadis dans une mise en
scène Michael Marmarinos. En 2010, elle se voit proposer par Morena Campani le
titre de « cantastorie » pour la France la faisant collaborer directement avec de
nombreux pays francophones sur les trois continents européen, africain et américain
sous la direction envisagée des deux dramaturges Dario Fo et Peter Brook.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%