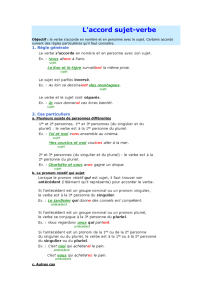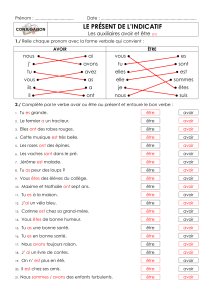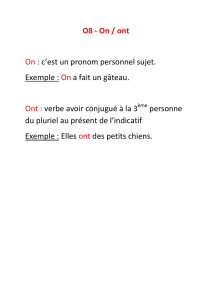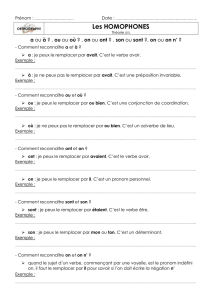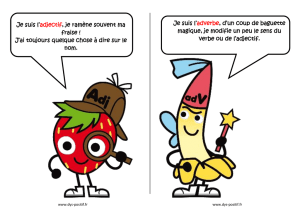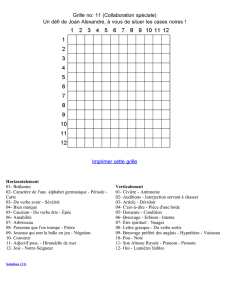(sujet/verbe) en CM1

UE3-EC1 M2 / EEME Université de Cergy Pontoise - Site d’Evry
1
PRÉPARATION À LA SECONDE ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION
Temps de préparation : 3 heures pour les deux parties de l’épreuve
Durée de l’épreuve : 1 heure
Première partie : préparation d’une séquence d’enseignement en français
Déroulement de l’épreuve de français :
1 – Exposé du candidat (20 minutes)
2 – Entretien avec le jury (20 minutes)
Domaine : Grammaire
Niveau : CM1
Documentation spécifique :
Document A : extraits de Carole Tisset, Enseigner la langue française à l’école, Hachette, 2010
Document B : extrait de Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? Catherine Brissaud et Danièle
Cogis, Hachette, 2011
Document C : extrait du manuel Interlignes, cycle 3, CM, SED, 2009. (La page d’exercices suivant l’extrait
n’a pas été donnée)
Document D : extrait du manuel Cléo CM1, Retz, 2010 et de l’aide-mémoire associé au manuel
Document E : « Cœur de lion », Robert Boudet, La petite bête, L'Ecole des loisirs, 1989
Dans un exposé de 20 minutes, le candidat préparera une séquence d'enseignement prenant en compte la
compétence tirée des progressions en grammaire pour le CM1 dans les programmes 2008 .
« - Dans une phrase simple où l'ordre sujet verbe est respecté, identifier le sujet (nom propre, groupe nominal,
pronom personnel, pronom relatif). »

UE3-EC1 M2 / EEME Université de Cergy Pontoise - Site d’Evry
2
Document A
Histoire d'un concept
Le sujet, chez les Grecs, est le sujet du discours, ce dont on
parie :
la mort est un sujet de méditation.
Ce mot avait également le sens de notre actuel « thème » : ce dont on parle, l'information connue ou donnée
comme telle en énonciation dans la phrase simple; on l'opposait à «prédicat », ce qu'on en dit. Génial, ce film! :
« génial» est le prédicat et « ce film » est le thème.
Comme dans la plupart des phrases simples, le thème est le plus souvent en position de sujet grammatical, et
référentiellement agentif (= individu de notre univers qui fait l'action), la grammaire scolaire a confondu les trois
notions:
«
Le sujet [ ... ] est le mot qui représente la personne ou la chose qui fait l'action du verbe, ou qui est dans
l'état exprimé par le verbe.
» […]
La grammaire générative transformationnelle, dans son analyse des constituants obligatoires, analyse la phrase
comme formée d'un syntagme nominal et d'un syntagme verbal, opérant une nouvelle confusion entre une
fonction, sujet grammatical, et une classe de mots, en l'occurrence celle des noms. On comprend pourquoi le plus
grand trouble règne dans les esprits des adultes et des enfants à propos du terme « sujet
»,
Niveau didactique
Le mot « sujet» étant polysémique, on doit comprendre le mot
comme
fonction syntaxique dans la phrase de
base. Le mot «thème », ce
dont on parle, sera analysé au niveau énonciatif et 1'« agent» au niveau
référentiel,
de ce qui est dit de notre monde.
Le
sujet grammatical est insupprimable : c'est un constituant indispensable
...
sauf pour les verbes à
l'impératif et les énoncés non phrastiques.
AU SUJET DU SUJET
A.
L'avion a percuté la montagne.
(S
+
V
+
COD.)
B. C'est mon père qui avait raison. (Phrase clivée […].)
C. La charrette est tirée par le lièvre. (Sujet non agentif dans une tournure passive qui permet de
thématiser un autre mot que l'agent.)
D. Alice voit arriver le chapelier. Il porte un drôle de chapeau. (1. Problème du « sujet» de l'infinitif et de
l'analyse référentielle des enfants: « le chapelier arrive. » 2. S
=
pronom représentant)
E. Alice a rencontré le lapin. (Verbe réversible.)
F. Pierre pense profondément
à
sa mère. (Verbe dont le procès n'est pas une action.)
G. Qui dort dîne
:
(Sujet propositionnel.)
H. Il est nécessaire d'enseigner autrement la grammaire. (S
=
pronom vide + sujet réel vs sujet apparent.)
I. Sur le toit flottent les drapeaux. /Quand viendras-tu ?
(Postposition du S + S
=
pronom déictique.)
J.
Me nourrir uniquement de langoustes me conviendrait bien. (S
=
infinitif.)
K. Que Pierre vienne
à
la kermesse m'étonnerait beaucoup. (S
=
proposition.)
L. Il faudrait arracher les mauvaises herbes du jardin. (S
=
forme vide.)
M. Pierre épouse Marie. (Verbe réversible.)
N.
Souviens-toi de Socrate
! /
Super, cette nouvelle cravate ! /
Bravo !
(Enoncés non phrastiques, sans
sujet.)
Sa place est devant le verbe ... s'il est également le thème
énoncia
tif. En cas de mise en exergue d'un
autre élément de la phrase et dans le type interrogatif, le sujet peut être placé derrière le verbe
(I).
L'antéposition peut être l'unique critère pour trouver le sujet quand le verbe est réversible
(E, M),
c'est-à-dire
quand l'objet peut
devenu
sujet, et vice versa.
• Le sujet est le donneur de marques morphologiques du nombre, de la personne et parfois du genre du verbe
conjugué (tous les exemples ; en N, la désinence « -s
»
peut être considérée comme la marque morphologique du
sujet […]. Il n'y a de sujet que pour les verbes conjugués. En D, dans l'univers décrit, le chapelier arrive, mais
syntaxiquement, en langue, « Alice» est le seul sujet du verbe « voir» qui, lui, possède deux objets : «le
chapelier » et
«
arriver »
,
unis par un lien prédicatif:
«
arriver» dit quelque chose sur
«
le chapelier ».
• Le sujet est un nom ou toute classe pouvant se substituer morphologiquement au nom: tout pronom
(D,
H,

UE3-EC1 M2 / EEME Université de Cergy Pontoise - Site d’Evry
3
L),
la proposition relative substantive
(G),
l'infinitif (J),
la proposition complétive (K). Les pronoms personnels et
les pronoms relatifs ont une forme particulière quand ils sont sujets, restes de déclinaison.
• Le sujet n'est pas obligatoirement agentif (C, F, G, H, J, K, L).
La
grammaire scolaire a inventé l'opposition
«
sujet réel» et
«
sujet grammatical » pour toutes les constructions impersonnelles, ce qui ne fonctionne pas en
L.
On ne considère cette opposition que dans les exemples du type H, quand le
«
sujet» sémantique peut réellement
devenir sujet grammatical: Enseigner autrement la grammaire est néces
saire.
• Le sujet n'est pas forcément clivable,
c'est-à-dire
mis en
relief par l'encadrement « c'est ... qui ...
»
(G, H, J, K,
L); les sujets qui ne sont pas clivables ne peuvent pas être trouvés par la question:
«
Qui est-ce qui ? », ou :
« Qu'est-ce qui?
»
• Le sujet peut être vide référentiellement
(H, J,
K,
L).
[…]
LE SUJET AU CM1
La reconnaissance installée au CE2 est essentiellement intuitive. Les enfants trouvent le sujet du verbe parce
qu’il a souvent un rôle d’actant. Autrefois, on disait qu’il « fait » l’action. Or nous avons expliqué dans la partie
historique pourquoi il fallait éviter cette explication.
A partir du CM1, on peut essayer de donner des moyens plus linguistiques de trouver le sujet du verbe.
Objectif
Le sujet ne fait pas toujours l’action
Situation-problème
« Comment reconnaître le sujet du verbe ? »
Corpus « type » :
A. L’avion a percuté la montagne. (S agentif + V + COD)
B. La souris est mangée par le chat. (S non agentif)
C. Sur le toit flottent des drapeaux. (S inversé)
D. Je vois arriver Emile. Il porte un drôle de chapeau. (Pronom déictique ; pronom représentant)
Ce corpus sera constitué de phrases simples tirées de lectures faites en classe. L’enseignant ne prendra
que des sujets nominaux pour le CM1. Les sujets ne seront pas tous des actants et ne seront pas tous à
gauche du verbe.
Hypothèses et manipulations
Après s’être mis d’accord sur le sujet de chaque verbe conjugué, les élèves proposent des moyens de
trouver le sujet. Voici quelques propositions.
Le sujet est toujours à gauche du verbe. L’ensemble de la classe réfléchit et cherche s’il n’y a pas de
contre-exemple. L’exemple C contredit la proposition.
Le sujet fait l’action. La classe réfléchit. L’exemple B infirme le moyen.
Le sujet ne peut être supprimé. C’est vrai dans tous les cas. Mais d’autres mots ne sont pas supprimables.
Seul « par le chat » est supprimable.
Le sujet n’est pas introduit par un « petit mot ». C’est vrai pour les exemples B et C, où « par » et « sur »
n’introduisent pas le sujet. Mais en A, « la montagne » n’est pas sujet et n’a pas de préposition. On évitera
« petit mot » qui peut être confondu avec « déterminant ».
L’enseignant peut proposer de transformer les phrases en employant « c’est… qui », ou en commutant
avec un pronom de conjugaison (les formes du pronom sujet). On remarque que ces différentes façons
permettent d’isoler les sujets nominaux et pronominaux. Mais les pronoms subissent une
transformation ; ils prennent les formes d’insistance :
je →c’est moi qui ; tu →c’est toi qui ; il →c’est lui qui ; ils →c’est eux qui.

UE3-EC1 M2 / EEME Université de Cergy Pontoise - Site d’Evry
4
Nous, vous, […] elle(s) ne changent pas.
Pour la dernière phrase, certains enfants peuvent proposer : « Emile », sujet d’ « arriver », car c’est Emile
qui arrive. Faire faire un changement avec un sujet au pluriel puisqu’on sait désormais qu’un sujet au
pluriel entraîne un verbe au pluriel : Je vois les enfants arriver.
Il n’y a aucun changement sur le verbe. Demander pourquoi. Quelques enfants proposeront l’explication
du verbe non conjugué que l’enseignant validera.
Validation et conclusion
Le sujet du verbe conjugué peut se trouver parce que :
il n’est pas supprimable ;
il n’est pas introduit par une préposition ;
on peut l’encadrer par : « c’est qui » ;
quand c’est un nom, on peut le remplacer par un pronom de conjugaison de 3° personne.
Comme d’habitude, les enfants rechercheront des exemples personnels dans leurs lectures. Ils
justifieront, toutes les fois que ce sera nécessaire, la manière dont ils ont trouvé le sujet.
L’enseignant rappellera qu’il est nécessaire de savoir trouver le sujet afin de bien orthographier le verbe
conjugué. L’accord devra être exigé en dictée et en production de textes. Le recours au résumé fabriqué
peut être utilisé comme aide lors de l’autocorrection.
La question « qui est-ce qui » est un faux moyen de trouver le sujet. En effet, pour l’employer
correctement, il faut l’utiliser avec le groupe verbal dans sa totalité, sans changement de temps ni de
personne. Dans ce cas, cela signifie que l’enfant a isolé le groupe sujet. C’est donc une tautologie : pour
employer correctement la question, il faut déjà connaître intuitivement le sujet.

UE3-EC1 M2 / EEME Université de Cergy Pontoise - Site d’Evry
5
Document B
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%