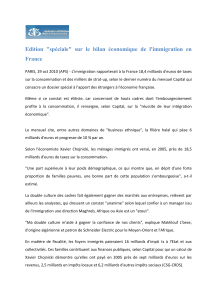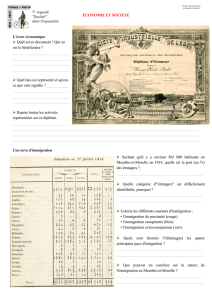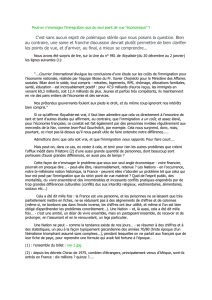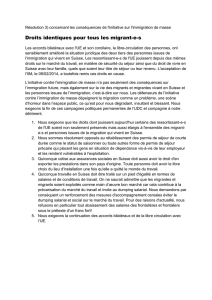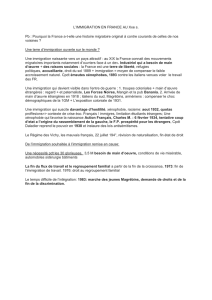The Pennsylvania State University The Graduate School

The Pennsylvania State University
The Graduate School
Department of French and Francophone Studies
LES DEFIS DE L’IMMIGRATION DANS LES ROMANS ÉCRITS PAR DES FEMMES
FRANCOPHONES DU MAGHREB ET DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
THE CHALLENGES OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WRITTEN BY
FRANCOPHONE WOMEN FROM NORTH AND SUB-SAHARA AFRICA
A Dissertation in
French
by
Patricia Siewe Seuchie
2012 Patricia Siewe Seuchie
Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philosophy
August 2012

The dissertation of Patricia Siewe Seuchie was reviewed and approved by the following
Thomas A. Hale
Professor of African, French and Comparative Literature:
Dissertation Advisor
Chair of Committee
Ambroise Kom
Professor of African Studies and Cultural Studies
Special Member
College of the Holy Cross
Bénédicte Monicat
Professor of French and Women’s Studies
Head, Department of French and Francophone studies
Thomas Beebee
Professor of Comparative Literature and German
Christine Clark-Evans
Associate Professor of French, Women’s Studies and African and African American Studies
Jennifer Boittin
Associate Professor of French, Francophone Studies and History
Jean-Claude Vuillemin
Professor of French
Acting Head of the Department of French
*Signatures are on file in the Graduate School

iii
Abstract
Since the emergence of African literature in European languages in the 20th century the
recurring theme of immigration has been based on the experience of the male author and
developed through the creation of a male protagonist. This is especially true in francophone
African literature. The experience of the female immigrant did not appear in African literature in
French until very recently, even though women are at the center of current debates in France on
the issue of immigration and there are more female immigrants than male, according to the
French national statistics agency. Today, French critics of immigration from Africa claim that
the women have too many children and their adolescents suffer from a high rate of delinquency.
Some authorities in France have demanded that the women undergo DNA testing in order to
determine the parentage of these children who are growing up in large families. Although female
writers from francophone Africa began to appear on the literary scene in the last two decades,
they are outnumbered by men and few focus on the theme of the immigrant woman. The contrast
between the very limited presence of female immigrant characters in contemporary literature by
francophone women writers and the centrality of women in the debate over immigration in
France today raises a series of questions. Why is there such silence on immigration by females in
African literature of French expression? In those works on the subject that have appeared in
recent years, how is the experience of women immigrant characters different from that of men?
How does the experience of women from North Africa differ from that of women from sub-
Saharan Africa? Have the handful of female writers who do focus on the female immigrant
experience created a distinct branch of literature on the theme of immigration? If so, what are the
devices, subthemes, and motifs that distinguish the portrayal of immigration by women writers?
Why is this emerging branch of literature so marginal not simply in the larger contexts of African
literature and African literature in French, but most importantly literature by francophone
African women writers? Drawing on postcolonial literary theory, I analyze five novels by
francophone female writers from both North and Sub-Saharan Africa: Fawzia Zouari’s La
deuxième épouse, Ferrudja Kessas’s Beur’s story, Calixthe Beyala’s L’homme qui m’offrait le
ciel, Nathalie Etoke’s Un amour sans papiers, and Bessora’s 53 cm. these works convey the
stories of different African women expatriate in France, in particular those of Beur or Harki
descent, as well as those who are migrants or descended from migrants. This study reveals that
the authors rely on a variety of devices to convey the sense of « otherness » that immigrants
experience in France. Through the choice of characters who destroy the negative stereotypes of
immigrants propagated by anti-immigrant segments of French society, through diverse styles
often heavily charged with irony, and through narration that links the form of the traditional
French novel and certain genres of African oral traditions, the authors attempt to portray the in-
between cultural position of African immigrants. The characters and situations these authors
create also suggest strategies for the integration into French society of immigrants coming from
diverse cultural backgrounds. In so doing, the authors attack the tendency in France to maintain
a hierarchy between “français de souche” and “français d’origine.”Finally, in my analysis I show
how and where this growing branch of literature of immigration fits into the larger picture of
literary and cultural relations between France and francophone Africa as well as francophone
literature in general.

iv
Résumé
Depuis l’émergence de la littérature africaine en langues européennes au vingtième siècle, le
thème de l’immigration a été produit par les hommes et exprimé à travers l’expérience du
protagoniste masculin. Ceci est particulièrement vrai dans la littérature francophone.
L’expérience de la femme immigrée n’a pas paru dans la littérature africaine en français jusqu’à
récemment, bien que la femme soit au centre du débat en France sur l’immigration et bien que,
selon les statistiques françaises, il y ait plus d’immigrés féminines que masculines. Aujourd’hui,
les critiques français de l’immigration africaines soutiennent que les femmes ont trop d’enfants
et ceux-ci constituent un taux élevé de la délinquance juvénile. Certaines autorités françaises ont
demandé que la femme soit soumise au test de l’ADN afin de déterminer la paternité de ces
enfants qui grandissent dans de larges familles. Les écrivaines féminines de l’Afrique
francophone ont fait leur apparition sur la scène littéraire au cours des trois dernières décennies,
cependant leur nombre reste restreint et bien peu d’entre elles s’intéressent au thème de la femme
immigrée. Le contraste entre le nombre limité des personnages immigrés féminins dans la
littérature contemporaine par les écrivaines francophones et la place centrale de la femme dans le
débat sur l’immigration en France suscite une série de questions. Entre autre, pourquoi y a-t-il un
tel silence sur l’immigration féminine dans la littérature africaine d’expression française ? Dans
les œuvres parues récemment à ce sujet, en quoi l’expérience du personnage féminin est-elle
différente de celle du personnage masculin ? En quoi l’expérience des immigrées de l’Afrique
sub-saharienne diffère-t-elle de celle des maghrébines ? Est-ce que la poignée d’écrivaines qui
s’intéressent à l’expérience de la femme immigrée créent une branche particulière de la
littérature de l’immigration ? Si oui, quels outils et quelles stratégies distinguent la
représentation de l’immigration par les auteurs féminins ? Pourquoi cette branche émergente de
la littérature est-elle si marginale non seulement dans la littérature africaine et celle en français
en général, mais surtout dans la littérature féminine francophone ? En partant de la théorie
postcoloniale, j’analyse cinq romans de femmes écrivaines francophones d’Afrique du nord et
d’Afrique sub-saharienne : La deuxième épouse de Fawzia Zouari, Beur’s story de Ferrudja
Kessas’s, L’homme qui m’offrait le ciel de Calixthe Beyala, Un amour sans papiers de Nathalie
Etoké et 53 centimètres de Bessora. Ces œuvres racontent l’histoire de différentes femmes
africaines descendantes de Beurs et de Harki, aussi bien que d’Africaines déplacées en France ou
filles de parents expatriés. Cette étude révèle que les auteures se basent sur une variété d’outils
pour traduire le statut de « Autre » auquel les immigrés sont confrontés en France. A travers des
personnages qui infirment les stéréotypes négatifs propagés par la frange « anti-immigrant » de
la société française, à travers une esthétique le plus souvent marquée par l’ironie et à travers une
narration qui allie les formes du roman traditionnel français et certains genres de la tradition
orale africaine, les auteures de notre corpus essayent de décrire la situation d’entre deux de
l’immigrée africaine. Les personnages et les situations créés par ces auteures suggèrent aussi des
stratégies d’intégration des immigrés d’origines culturelles diverses dans la société française. Les
écrivaines francophones analysées dans cette étude attaquent ainsi la tendance de la société
française d’entretenir une hiérarchie entre les « Français de souche » et les « Français
d’origine ». Finalement, cette analyse montre comment et en quoi l’émergente branche de la
littérature de l’immigration se positionne dans le tableau littéraire de la littérature francophone
aussi bien que dans celui des relations culturelles entre la France et l’Afrique francophone.

v
SOMMAIRE
Introduction 1
Chapitre 1 : Le chemin de l’ailleurs : Comment dire et signifier l’immigration 41
1- Identification des chronotopes : expression des lieux et des temps tels que soumis
à l’actuelle culture du déplacement 43
2- Une multiplicité des motivations de départ du pays d’origine 53
3- Une écriture éclatée, polyglotte et multiforme 65
4- Diversité culturelle des personnages immigrés 76
Chapitre 2 : Stratégies narratives de l’intégration : vivre en pays d’immigration 84
1- Représentation fictionnelle des immigrées 87
2- L’éducation et les professions en milieux immigrés féminins 99
3- La dynamique des relations homme/femme 114
Chapitre 3 : Immixtion fictionnelle dans le débat sur l’immigration 127
1- L’identité nationale en question 129
2- Culture de l’ambiguïté : alchimie labyrinthique des lois sur l’immigration 141
3- L’immigration clandestine 151
Chapitre 4 : Écriture du décentrage ou décentrage de l’écriture 170
1- Ecriture du décentrage 172
2- le décentrage d’une écriture 192
3- La deuxième épouse, Beur’s story, L’homme qui m’offrait le ciel, Un amour sans
papiers, 53 cm : littérature française, africaine, francophone,
et/ou de banlieue? 201
Conclusion 209
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
1
/
241
100%