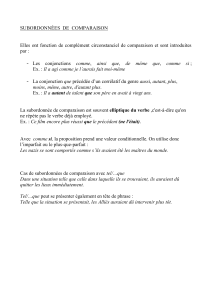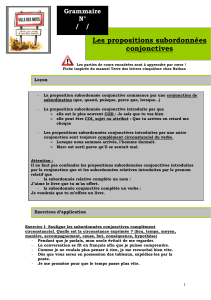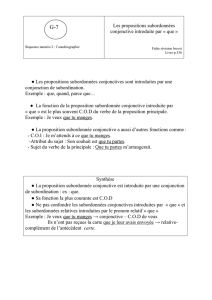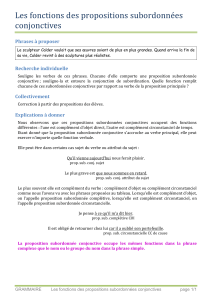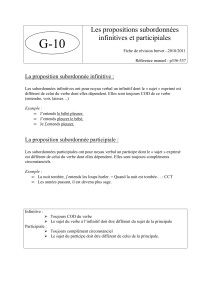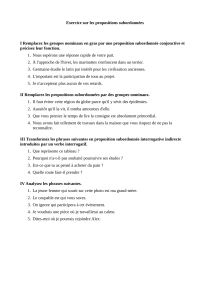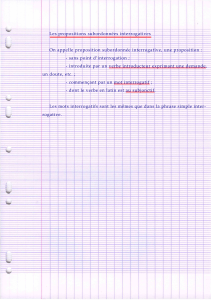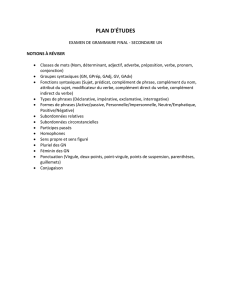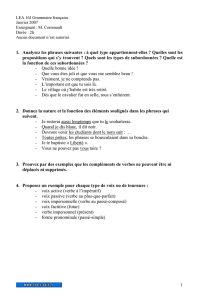Les propositions subordonnées

Les propositions subordonnées
Il y a deux grands types de propositions subordonnées :
Les propositions subordonnées relatives, qui complètent un nom
Les propositions subordonnées conjonctives, qui complètent un verbe
Les propositions subordonnées conjonctives se divisent elles-mêmes en deux groupes :
Les propositions subordonnées conjonctives complétives, qui sont des compléments
essentiels (sujet, COD)
Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles, qui sont des compléments non
essentiels.
I) Les propositions subordonnées relatives
Ce sont des expansions du nom.
Elles sont dites
Déterminatives, si on ne peut pas les supprimer (
Ex : J’ai peur des années qui arrivent
.)
Explicatives ou appositives, si on peut les supprimer (
Ex : L’enfant, qui commençait à se fatiguer, nageait
avec difficulté.
)
Les propositions subordonnées relatives sont introduites par des pronoms relatifs, qui ont une fonction dans la
proposition.
Ex :
Elle m’a présenté l’homme qui lui avait sauvé la vie. (qui = sujet dans la relative)
L’homme dont elle m’a parlé lui avait sauvé la vie. (dont = COI dans la relative)
On distingue
Les pronoms relatifs simples : qui, que, dont, où
Les pronoms relatifs composés : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ; qui peuvent être précédés de « à »
(auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles) ; de « de » (duquel, de laquelle, desquels, desquelles) ; ou de
« avec » (avec lequel, avec laquelle, avec lesquels, avec lesquelles)
II) Les propositions subordonnées conjonctives complétives
Elles sont introduites par la conjonction de subordination « que ».
Par rapport au verbe de la principale, elles peuvent avoir la fonction de
Sujet (
ex : Qu’il ne soit pas venu n’est pas vraiment une surprise)
COD (
ex : Je te dis qu’il n’est pas venu.)
ATTENTION : Certains groupes nominaux peuvent être suivis d’une complétive. Il s’agit de noms qui expriment une
action en cours et qui proviennent généralement d’un verbe. (
ex : La pensée qu’il allait être arrêté le terrorisait. /
J’ai la preuve qu’il est coupable. / Il a la conviction que je suis innocent. )
Dans ce cas, ce qui permet de distinguer la
complétive d’une relative est que la conjonction « que » n’est pas un pronom : elle ne remplace aucun groupe nominal
et n’a aucune fonction grammaticale dans la subordonnée.

III) Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles
Elles ont une fonction de compléments circonstanciels
De temps, introduites par : quand, alors que, tant que, dès que, aussitôt que, après que, avant que, pendant
que, depuis que, jusqu’à ce que, une fois que, chaque fois que…
De cause, introduites par : parce que, comme, du moment que, non pas que, étant donné que, sous prétexte
que, vu que, puisque…
De but, introduites par : pour que, afin que, de peur que, de sorte que…
D’opposition ou de concession, introduites par : quoique, bien que, alors que, même si, quand bien même, sans
que…
De condition, introduites par : si, pourvu que, pour peu que, à supposer que, selon que, suivant que, à moins
que, au cas où…
De comparaison, introduites par : comme, de même que, aussi…que, tel… que, moins…que, plus…que,
mieux…que …
IV) Les infinitives et les participiales
Le verbe de la proposition subordonnée peut se trouver à un mode non conjugué.
L’infinitif, le participe présent, le participe passé et le gérondif peuvent recevoir des compléments du verbe (COD,
COI, COS, CC, Complément d’agent) et constituer les noyaux d’une subordonnée.
Exemples :
proposition relative
proposition complétive
proposition
circonstancielle
proposition infinitive
Il regardait par la fenêtre
les enfants jouer dans la
cour.
(= les enfants qui
jouaient dans la cour)
Paul pense venir.
(= qu’il
viendra)
Avant de choisir, je dois
tout voir.
(= avant que je
ne choisisse)
proposition participiale
avec participe présent
Deux hommes hurlant dans
des porte-voix
(= qui
hurlaient dans des porte-
voix)
venaient vers nous.
....N’EXISTE PAS….
Les autres partant déjà,
(=
comme les autres partent
déjà)
je vais aller me
coucher.
proposition participiale
avec le gérondif
....N’EXISTE PAS….
....N’EXISTE PAS….
Il l’observait tout en
mangeant.
(= pendant qu’il
mangeait)
proposition participiale
avec participe passé
La décision prise par le
tribunal
(= qui avait été
prise par le tribunal)
ne
fut jamais mise an cause.
....N’EXISTE PAS….
Son repas à peine terminé,
(= dès qu’il eut terminé son
repas),
il sortit.
1
/
2
100%