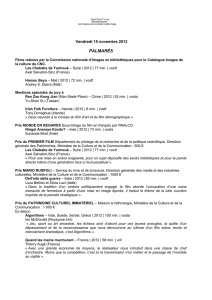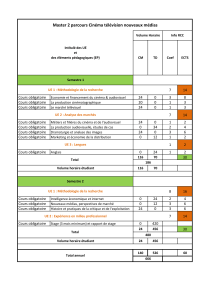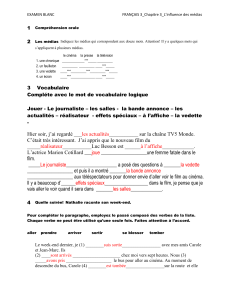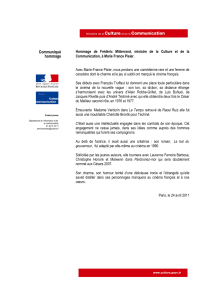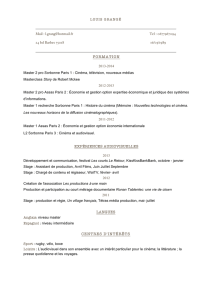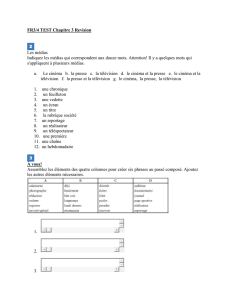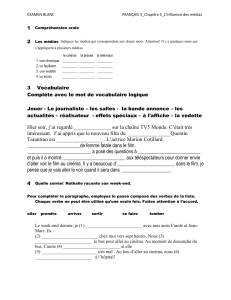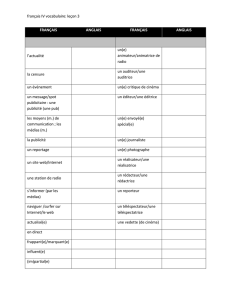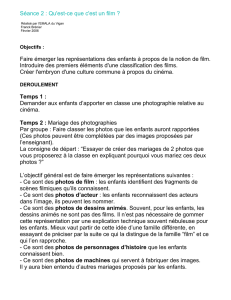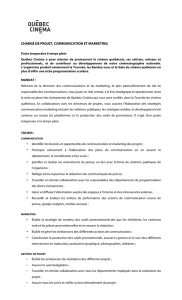salsa picante 4 - Reflets du cinéma ibérique et latino

Picante
Salsa
Salsa
I
l y a du Benjamin Button chez Tomás
Gutiérrez Alea, sinon dans sa vie, du
moins dans sa carrière de cinéaste.
En décembre 1993, à La Havane, sort
son film Fresa y Chocolate, au XVème
Festival International du Cinéma Latino-
américain. Puis, à partir de l’année sui-
vante, 1994, ce film va entamer une car-
rière internationale, recueillant ainsi une
moisson de plus d’une vingtaine de nomi-
nations, prix et récompenses diverses et
variées.
A partir de là, on va se rendre compte que
Tomás Gutiérrez Alea, dit Titón, né en
1926 à La Havane, a derrière lui toute
une carrière, presque entièrement
conduite dans le contexte de la Cuba cas-
triste, avec, ma foi, une production non
dépourvue d’intérêt et qui, éventuelle-
ment, pouvait intéresser un large public et
pas seulement un petit cercle de cinéphi-
les, latinophiles, postsoixantehuitards et
autres farfelus pas forcément politique-
ment corrects.
Peut-être la question était-elle :
« Comment peut-on être (cubain) ? »
Petite précision, Titón est mort en 1996, à
69 ans, à Cuba, soit deux ans après sa
« découverte ».
Nous n’allons pas suivre l’exemple de But-
ton et remonter le fil de sa carrière jusqu’à
son premier court métrage, mais
« bureaucratiquement » parcourir quelques
moments clefs de sa vie de cinéaste, car
c’est de vie dont il s’agit et non de carrière.
Il n’est pas aisé, en fait, d’évoquer la vie
et l’œuvre de Titón, et ceci parce que lui-
même, lors d’interviews, d’articles qu’il a
écrits ou d’ouvrages qu’il a publiés, s’ex-
primait sur ce sujet avec une telle lucidité,
une telle transparence et une telle fran-
chise, qui depuis les calendes grecques
sont le signe de la sagesse (« connais toi
toi-même »), qu’il n’est pas possible d’en
dire plus ni, bien évidemment, de le dire
mieux. Cette franchise lui a valu parfois,
reproches et rancunes, auxquels il a tou-
jours répondu sans détours et avec perti-
nence. Il pratiquait l’autocritique aussi
radicalement que la critique et si, parfois,
il s’est montré critique à l’égard de la tour-
nure que prenaient les événements en
regard de l’esprit de la révolution, dans
son pays, qu’il n’a jamais quitté, il s’en est
expliqué lui-même très clairement.
La critique a des visées constructives et
non agressives et destructrices : « …pour
que la révolution grandisse, pour que no-
tre pays se développe dans une direction
positive, la critique est nécessaire. Il faut
avoir une conscience critique de ce que
(Suite page 2)
Le journal des Reflets
Vendredi 13 mars 2009 / numéro 4
4
L’étrange histoire
L’étrange histoire
De tom
De tomÁ
Ás gutiérrez alea
s gutiérrez alea

(Suite de la page 1)
nous sommes et de ce que nous faisons.
Et ne jamais cesser de nous critiquer. …
Il faut défendre la nécessité de la critique
en tant que nécessité pour la survie de la
révolution. »
Les deux films qui ont provoqué le plus
de défiance quant à la fermeté de son
engagement révolutionnaire sont sans
doute Memorias del Subdesarrollo
(1968) et Fresa y Chocolate (1993). Il
défend, surtout dans Fresa y Chocolate,
le droit pour chaque individu à exprimer
ce qu’il est et à avoir, comme tout un
chacun, sa place au soleil, quels que
soient ses particularismes.
Que fait-il d’autre que ce que faisait, en
1964, Nicolás Guillén, par exemple, dans
son poème « Tengo » : revendiquer le
droit à vivre ce que l’on est dans la liber-
té retrouvée, grâce à la révolution cas-
triste de 1959.
Qui songerait à soupçonner de quoi que
ce soit Nicolás Guillén?
Le moyen d’expression est différent mais
le propos lui, l’est-il ? Célébration des
bienfaits de la révolution pour Guillén,
réflexion sur la révolution pour que du-
rent ses bienfaits et qu’elle n’aille pas se
heurter aux écueils qui pourraient faire
chavirer le navire pour Alea. Même atta-
chement à ce qui a été conquis.
Dans l’autocritique il se montrait tout
aussi radical, considérant sans doute
que, ne mettant en cause que lui-même
il avait les coudées franches. Un exem-
ple, à propos de son film Cumbite,
(1964 - adaptation d’un roman haïtien) :
« J’ai de la difficulté à revoir Cumbite
jusqu’au bout. Je ne parviens à regarder
que quelques passages… C’est un film
qui n’est pas abouti, je n’y retrouve pas
une expression personnelle ». Point /
barre, on passe à autre chose.
D’autres choses, il y en aura beaucoup,
parmi lesquelles on peut rappeler les
films qui ont rencontré une audience in-
ternationale plus particulièrement large.
En 1966, La Mort d’un Bureaucrate que
lui-même a qualifié de « comédie ».
Puis, en 1968, Mémoires du Sous-
développement, où le ton change tota-
lement. Un homme, Sergio, refuse de
suivre sa famille qui fuit la révolution et
s’exile, va, sans parvenir à s’intégrer à la
société telle qu’elle évolue autour de lui,
en faire une observation critique, du haut
il est vrai, de la tour d’ivoire dans laquelle
il s’est enfermé en solitaire.
Ce fut sans doute, au niveau internatio-
nal, son premier grand succès marquant.
La última cena, en 1976, peut, du point
de vue du genre, être classé historique
puisque le film s’inspire d’un épisode réel
du temps de l’esclavage. En ayant toute-
fois présent à l’esprit que l’abolition de
l’esclavage à Cuba ne remonte qu’à
1880, un peu moins d’un siècle. Fonda-
mentalement le film s’attaque à des pro-
blèmes de société intemporels : par delà
le questionnement sur l’utilisation de la
religion pour « …soumettre une classe
sociale et de toutes façons mettre un
frein au développement de la société… »
c’est l’hypocrisie des puissants prêts à
tout et n’importe quoi pour garder leurs
privilèges qui est dénoncée.
Suivirent des réalisations plus légères.
En 1978 Les Survivants, aventures et
mésaventures d’une famille bourgeoise,
recluse dans sa propriété, pour ne pas
être atteinte par le virus de la révolution.
En 1987, Lettres du Parc, une histoire
d’amour inspirée d’une nouvelle de Gar-
cía Márquez.
En 1993, Fresa y Chocolate, dont on a
déjà évoqué le retentissement internatio-
nal et qui incite à une réflexion sur la
différence, illustrée, ici, par l’homosexua-
lité et la violence du rejet et de la répres-
sion qu’elle provoque, dans le contexte
cubain.
Puis, enfin, le dernier mot de Titón,
Guantanamera, qui, entre rires et lar-
mes, revient au thème de la Mort d’un
Bureaucrate.
En définitive, c’est peut-être cela qui
pourrait définir le cinéma de Tomás Gu-
tiérrez Alea, le rire grave. Ce qu’il sou-
haitait c’était tout à la fois offrir aux spec-
tateurs un divertissement qui en même
temps et par le rire « …serve à mieux
comprendre le monde, à mieux compren-
dre la réalité et à aider le spectateur à
avancer dans cette direction. »
Annie Damidot
Note : Les citations de Tomás Gutiérrez
Alea sont extraites de l’ouvrage de J.A
Evora « Tomás Gutiérrez Alea » et tra-
duites.
TitÓn,
de la habana a guantanamera
Film inédit
Lundi 16 à 18h30 au Zola
La mort d’un bureaucrate
Lundi 16 à 20h45 au Zola
+ présentation du film par Alain Liatard
Mercredi 18 à 14h au Zola
Page 2
Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain
www.lesreflets-cinema.com
Sal
La Mort
d’un Bureaucrate
Il s’agit d’une comédie satirique qui met en
scène les faits et méfaits de la bureaucratie.
Un ouvrier modèle a été enterré, sur sa de-
mande, avec ses documents de travailleur,
mais sa veuve, pour toucher sa retraite, doit
présenter ces documents à l’administration.
Donc il faut les récupérer. Oui, mais com-
ment ? On ne visite pas les tombes impuné-
ment !
Le film part, en fait, de l’expérience person-
nelle de Tomás Gutiérrez Alea suite à ses
démêlés avec des administrations diverses
et variées. « Vint un moment où je me suis
senti si accablé que le désir m’est venu de
me faire la peau à un bureaucrate »
On ne peut pas être plus clair !
D’ailleurs il qualifie lui-même son film de
« psychothérapie ».
La mort n’est ici choisie qu’en tant que situa-
tion extrême. Les problèmes, quels qu’ils
soient, même bassement matériels, ne peu-
vent désormais pas être remis à plus tard. Il
faut les affronter, si absurdes soient-ils.
C’est ainsi que l’on entre dans des dédales
kafkaïens que Tomás Gutiérrez Alea a choisi
de traiter à la Laurel et Hardy, selon ses
propres dires, en accumulant des situations
« dans lesquelles tout se déchaîne à partir
d’un conflit insignifiant qui prend des propor-
tions progressivement. »
Mais en aucun cas le ridicule des situations
n’a pour unique bût le rire et l’amusement du
spectateur. « Le réalisateur assume une
façon de raconter proprement comique pour
aborder un sujet qui dans la vie quotidienne
est exaspérant (et pas seulement dans une
situation limite représentée par la mort), ceci
dans l’espoir de rendre l’absurde plus évi-
dent encore en le ridiculisant et que par
conséquent le spectateur sorte du cinéma
décidé à le bannir. »
Lorsque Titon va reprendre le thème du film
dans Guantanamera il ne parle plus de
« psychothérapie » mais affirme avoir fait un
« documentaire ». En effet Cuba vit le triste-
ment célèbre « periodo especial », l’île man-
que de tout et en particulier de carburant.
Pour ramener un cercueil de Guantanamo à
La Havane il va falloir se plier au système
mis en place par un zélé bureaucrate et
changer de voiture corbillard en même
temps que l’on passe d’une province à l’au-
tre. En prime, évidemment, toutes les situa-
tions de manques vécues à Cuba font partie
du voyage et sont évoquées.
Tout ceci est parfaitement en accord avec ce
que remarque José Antonio Evora « Le ciné-
ma de Tomás Gutiérrez Alea est davantage
un cinéma de synthèse et de dévoilement
que de fiction. », formule qui rend compte à
merveille de ce que sont Mort d’un Bureau-
crate et Guantanamera.
Annie Damidot

D
ans les années trente au cœur
du Mexique, Elias, chrétien
fanatique, a commis un péché
contre Dieu ; ainsi, il est
convaincu qu’il sera puni : il est per-
suadé que ses enfants vont mourir tôt ;
il tente alors de contrecarrer la volonté
divine en érigeant une église en plein
désert. Cette histoire de foi, de folie et
de fanatisme est racontée telle qu’elle
est vue et vécue par Aureliano, le plus
jeune et le plus fragile des enfants.
Aureliano est enfermé pendant de lon-
gues années et doit peindre l’histoire
sainte, nourri par ses frères et ses
sœurs. Mais le monde extérieur va peu
à peu se manifester…
L’argument de ce film, le premier long
métrage, en fait de Rodrigo Plá, n’est
pas sans rappeler un autre enferme-
ment, et une autre relation père-fils,
celui de La Zona (La zona : propriété
privée), situé lui dans un futur proche
et dans un lieu quelconque d’Amérique
latine. Ainsi, avec Desierto adentro,
Rodrigo Plá revient sur l’enfermement,
la frontière, les difficultés des relations
père-fils et l’intrusion de l’extérieur
dans un monde fermé.
Revenons à la carrière de Rodrigo
Plá : alors que le journaliste Cédric
Lépine (le 21 février 2008 à Paris) lui
demandait ce qui s’était passé avant
d’arriver à la Zona, sorti en 2008, le
cinéaste mexicain d’origine uru-
guayenne répondait :
« La grande difficulté était d’avoir un
budget. Après l’œil sur la nuque, j’a-
vais écrit un scénario, le désert inté-
rieur, qui n’a pu rencontrer assez vite
le budget nécessaire. Nous avons
commencé un autre scénario, celui de
La Zona. Une fois que ce scénario a
été terminé, nous avons reçu l’argent
pour les deux films. Alors nous avons
commencé aussi ce film que nous ve-
nons de terminer. Le désert intérieur
mêle film et animation ; lorsque nous
avons fini de filmer et que la partie ani-
mation plan par plan a débuté, nous
avons tourné La Zona. »
A propos de l’œil sur la nuque, court
métrage montré aux Reflets, il dé-
clare : « J’ai eu beaucoup de chance
de travailler avec Gael Garcia Bernal
et Daniel Hendler parce que ce sont de
très bons acteurs. J’ai contacté Gael
qui était alors dans une école en An-
gleterre. Il m’a envoyé une vidéo de
casting et on s’est revu ensuite à Mexi-
co. Pablo Stoll avait vu mon précédent
court métrage, Novia mia , et s’était
proposé pour m’aider à tourner en Uru-
guay. Il m’a également beaucoup aidé
dans mes recherches, m’accueillant
chez lui durant le tournage. Tout cela
avant même qu’il fasse lui-même 25
watts. »
Pour finir, nous rappellerons que Ro-
drigo Plá est né en Uruguay et que ses
parents ont dû s’exiler alors qu’il n’a-
vait que 9 ans. Il a suivi des études de
cinéma au CCC (Centro de Capacita-
ción Cinematografica) du Mexique
dont il est sorti diplômé. Ses courts
métrages ont été très vite remarqués
et primés : Novia mia a obtenu le Prix
du meilleur court métrage au festival
de Biarritz et au Festival international
du Cinéma de Guadalajara. El ojo en
la nuca, lui, a reçu l’Oscar étudiant du
meilleur court métrage étranger et l’A-
riel du meilleur court métrage de fic-
tion. La Zona, qui a fait l’effet d’une
déflagration, a reçu quant à lui divers
prix internationaux : le Lion de l’Avenir
pour le Meilleur Premier film au 64
ème
Festival International de Cinéma de
Venise et le prix de la Critique Interna-
tionale au Festi-
val International
de Cinéma de
Toronto. Desier-
to Adentro qui
débute, lui, sa
« carrière inter-
nationale » a dé-
jà obtenu 7 ré-
compenses au
Festival de Gua-
dalajara.
Pascale Amey
Filmographie
de Rodrigo Plá
2008 : Desierto adentro
(réalisateur, scénariste, monteur et
producteur)
2007 : La Zona
(réalisateur, scénariste)
2001 : El ojo en la nuca
(réalisateur, scénariste)
1996 : Novia mia
(réalisateur)
1996 : Libre de culpas
(premier assistant réalisateur)
1991 : La mujer de Benjamin
(second assistant réalisateur)
Rodrigo Plá est actuellement oc-
cupé au montage de son troisième
long métrage et au tournage de
son dernier court métrage. Il nous
a promis d’être parmi nous lors des
26
èmes
Reflets pour nous les pré-
senter en personne, en 2010. Ren-
dez-vous pris !
Pascale Amey
Desierto adentro
Film inédit
Dimanche 15 à 21h au Zola
Mardi 17 à 20h au Comoedia
Salsa Picante n° 4
Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain
Page 3
www.lesreflets-cinema.com
Rodrigo pl
Rodrigo plÁ
Á
Désert intérieur
Désert intérieur

L ’art cinématographique au Vene-
zuela est une longue histoire vieille
de cent douze ans, faite de hauts
comme le cinéma social des an-
nées soixante et soixante dix qui a
donné lieu à des œuvres remarquables
(Cuando quiero llorar no lloro de
Mauricio Wallerstein, El pez que fuma
de Román Chalbaud et Soy un delin-
cuente de Clemente de la Cerda), et
de bas consécutivement à la profonde
crise économique des années 1980 qui
a fait chuter la production cinématogra-
phique à deux films par an.
De récentes lois de financements et la
création de soutiens institutionnels
comme le Cnac (Centro Nacional Autó-
nomo de Cinematografía) ont donné
une nouvelle dynamique à une nou-
velle vague de jeunes cinéastes et a
permis de relancer d’autres réalisa-
teurs dont la carrière battait de l’aile
comme Luis Alberto Lamata (Jericó,
Desnudo con narajas) qui a réalisé le
premier film produit par le gouverne-
ment d’Hugo Chávez Miranda Regre-
sa (Le retour de Miranda, présenté
cette année aux Reflets).
L’inauguration de la Villa del Ciné le 3
juin 2006 a permis un nouvel essor de
l’activité cinématographique au Vene-
zuela. Avec quinze mini studios, deux
grandes salles complètement équi-
pées, un centre de haute technologie
pour la post-production et des forma-
tions permanentes, les cinéastes vé-
nézuéliens(ne)s peuvent enfin résister
à la dictature de Hollywood en réalisant
sur place les activités jusque-là sous-
traitées à l’étranger. Mais si la Villa del
Ciné a incontestablement dopé les pro-
ductions cinématographiques du Vene-
zuela, cela n’empêche pas certains
cinéastes et politiques d’y voir un outil
de propagande au service du régime.
Néanmoins, la majeure partie des pro-
fessionnels du cinéma estiment la
composition du centre cinématographi-
que équilibrée et applaudissent la vo-
lonté du gouvernement d’en finir avec
le diktat américain…
En dix ans, l’Etat vénézuélien a financé
73 films et depuis sa création la Villa
del Ciné a financé 25 films et a donné
l’occasion à de jeunes cinéastes de
réaliser leurs premiers films tels An-
drea Herrera et Anabel Rodríguez (1, 2
y 3 mujeres) Hernán Jabes (Macuro)
ou à des réalisateurs confirmés de
poursuivre leur œuvre tels Fina Torres
(Oriana) Luis Alberto Lamata, ou Ro-
mán Chalbaud (El Caracazo).
L’activité cinématographique au Vene-
zuela a été - et continue d’être liée - , à
la problématique des politiques culturel-
les et de la législation émanant de l’Etat.
Néanmoins, en dehors des circuits de
l’Etat se développe un cinéma indé-
pendant dont font partie de jeunes ci-
néastes talentueux tels Jonathan Jaku-
bowicz, dont son premier film Secues-
tro express a été l’un de plus gros
succès du cinéma vénézuélien, Eduar-
do Arias et son film en haute définition
Elipsis qui fut produit et distribué par
la 20th Century Fox, Franco de Peña
(Amor en Concreto) et Alejandro
Wieddeman (Plan B). Ces cinéastes
souhaitent montrer une autre image de
la réalité en décrivant le monde tel
qu’ils le ressentent. Ils représentent
une véritable bouffée d’oxygène au
sein d’une industrie cinématographique
instable qui souffre de l’interdépen-
dance entre situation politico-
économique et politique culturelle dans
un pays dont le statut d’exportateur de
pétrole l’expose inévitablement aux
aléas du marché international. Dans le
contexte actuel, le cinéma vénézuélien
a peu de chances d’échapper à cette
réalité incontournable.
Homero Vladimir Arellano
COMMENT SE PORTE
COMMENT SE PORTE
LE CINéma
LE CINéma
Vénézuélien ?
Vénézuélien ?
Page 4
Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain
www.lesreflets-cinema.com
Salsa Picante n° 4
La Villa del Cine
Asphyxié par le néolibéralisme des an-
nées 80, le cinéma latino-américain
avait vu ses écoles privatisées, ses stu-
dios bradés et ses remparts légaux dé-
montés. “Comment accepter que les
huit plus grands studios d’Hollywood se
répartissent 85 % du marché mondial
du cinéma et occupent 98 % de l’offre
en Amérique Latine ?” a demandé le
président Chávez en inaugurant le 3
juin 2006 une de ses promesses électo-
rales, la Villa del Cine, un complexe de
studios de cinéma bâti sur un terrain de
4 hectares à Guarenas, près de Cara-
cas. Cette inauguration a été suivie par
la création de La « Fundación Villa del
Cine ». Entité spécialisée dans la pro-
duction cinématographique et audiovi-
suelle, elle possède le statut de Fonda-
tion d’Etat et se retrouve inscrite au Mi-
nistère du Pouvoir Populaire pour la
Culture.
Miranda Regresa (Le Retour de Mi-
randa) est le premier film produit par le
gouvernement d'Hugo Chávez. Film de
commande, il a au moins contribué au
retour au premier plan de son réalisa-
teur, Luis Alberto Lamata, dont la car-
rière s’écrivait alors en pointillés. Sans
être révolutionnaire d’un point de vue
formel, Miranda Regresa témoigne dé-
(Suite page 5)

Salsa Picante n° 4
Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain
Page 5
www.lesreflets-cinema.com
(Suite de la page 4)
sormais de la possibilité de tourner des
films ambitieux 100% vénézuéliens.
Loin d’être une enclave (Lamata a par
la suite réalisé El Enemigo -présenté
lui aussi aux Reflets- un instantané d’un
Venezuela en perdition, puis est revenu
dans le giron de l’Etat pour son dernier
film, Boves), la Villa del Cine apparaît
comme un outil appréciable pour des
cinéastes dont la vision induit des bud-
gets plus importants.
Depuis sa création, la Villa del Cine a
participé à la production et au tournage
de 25 films, ouvrant ainsi une nouvelle
voie dans la création cinématographi-
que nationale. A travers la société de
Distribution Amazonia Films, ce ne sont
pas moins de quatre productions de la
Villa Del Cine qui ont été diffusées au
plan national et international en 2007.
C’est à la fois peu et beaucoup au sein
d’une production cinématographique qui
a toujours eu beaucoup de mal à s’ex-
porter, en comparaison de ses voisins
argentins et brésiliens.
Sa création et son action sont néan-
moins controversées. Certains lui repro-
chent de n’être qu’un instrument de
l’Etat pour contrôler et diriger la création
cinématographique du pays. D’autres
soutiennent son action de réhabilitation
des cultures traditionnelles à travers
des œuvres audiovisuelles de qualité.
Pour pallier aux critiques, la Villa del
Cine vient d’approuver une politique
d’appui aux organismes publics et pri-
vés en établissant des alliances de co-
production avec des producteurs indé-
pendants vénézuéliens pour mener à
bien des projets cinématographiques
d’envergure. Il est encore trop tôt pour
savoir si cette politique va porter ses
fruits mais au moins s’annonce t-elle
très intéressante et porteuse d’espoir
pour un pays qui ne peut se dispenser
d’un rayonnement culturel plus impor-
tant.
Homero Vladimir Arellano
Le comédien américain Danny Glover et le
président Chávez, lors de l’inauguration de la
Villa del Cine
J
e me suis posée et reposée la
question plusieurs fois après
avoir vu le film de Pablo Lar-
rain. Non que je doive absolu-
ment écrire un article pour Salsa
Picante mais surtout parce que je
ne cessais de voir passer devant
mes yeux le visage d’Alfredo Cas-
tro, et ce, plusieurs jours après l’a-
voir vu incarner Tony Manero…
J’avais également remarqué que
mes amis chiliens semblaient mal
à l’aise pour parler de ce film… Ils
soulignaient la performance de
l’acteur, l’accueil du film dans les
festivals internationaux, mais élu-
daient finalement le propos-même
du film, comme si cela leur ren-
voyait un Chili tellement peu pré-
sentable, celui qu’ils avaient été
obligés de quitter…
Plusieurs scènes revenaient me
hanter : l’assassinat brutal d’une
vieille femme pour lui prendre sa
télévision couleur, le dépouillage
d’un opposant à Pinochet, agoni-
sant près du fleuve, les chiens fé-
roces gardant les propriétés, les
corps allongés, après une tentative
de rapport sexuel, le visage inex-
pressif de Raúl, son corps vieillis-
sant, son obsession de la ressem-
blance au modèle...
Peu à peu la lumière s’est fait
jour… ce n’était pas simplement
l’histoire du psychopathe, du mina-
ble, du sex-symbol impuissant et
mutique, du piètre danseur et de
son amoralité qui me fascinaient
mais bien la parabole du pouvoir
des médiocres et de leurs efforts
pour le conserver dans une atmos-
phère délétère.
Ce qu’il en ressort est pourtant
clair : la peur et la terreur engen-
drent la médiocrité, la trahison
mais aussi parfois (plus rarement)
la lutte clandestine et l’héroïsme
de certains. La domination d’un
modèle culturel qui se veut celui de
l’élite (Pinochet-dictateur soutenu
par les USA, l’idolâtrie de Raúl
pour le personnage de La fièvre
du samedi soir, rêve de paillettes
contre plomb, gloire de la danse
contre misère même si c’est dans
un cabaret de troisième zone) en-
gendre l’aliénation et la folie, l’en-
vie de devenir un autre, d’être au-
tre.
Au-delà des immenses qualités
d’acteur d’Alfredo Castro (qui res-
semble plus au Pacino de Lumet
ou même de Brian de Palma qu’au
John Travolta de John Badham),
au-delà des qualités indéniables
de Pablo Larrain en tant que ci-
néaste (recréation de l’atmosphère
de l’époque par le montage, camé-
ra portée, la photographie, les ca-
drages et la direction d’acteur),
c’est tout le message qui sous-
tend ce film qui en fait une œuvre
éminemment politique : la médio-
crité du pouvoir de Pinochet, la
médiocrité de Pinochet tout court,
et pour finir l’aliénation à laquelle
conduit le modèle culturel améri-
cain… Un film essentiel !
Pascale Amey
Pourquoi
tony manero
est un
grand film ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%