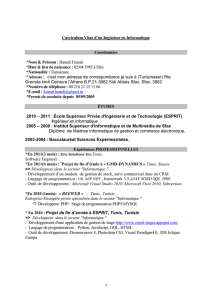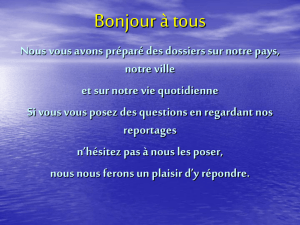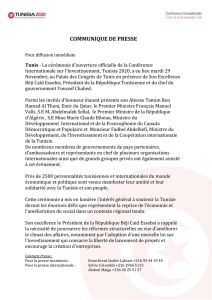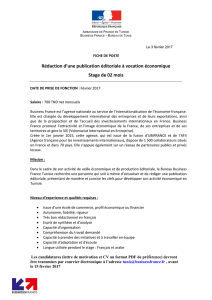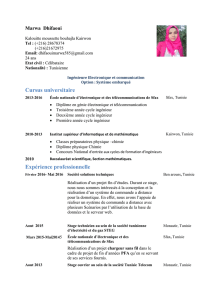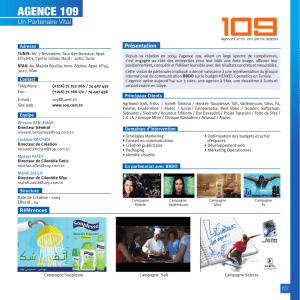La régionalisation en Tunisie

Jean Poncet
La régionalisation en Tunisie
In: Tiers-Monde. 1973, tome 14 n°55. pp. 597-614.
Citer ce document / Cite this document :
Poncet Jean. La régionalisation en Tunisie. In: Tiers-Monde. 1973, tome 14 n°55. pp. 597-614.
doi : 10.3406/tiers.1973.1948
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1973_num_14_55_1948

LA
RÉGIONALISATION
EN
TUNISIE
par
Jean
Poncet*
DIFFICULTÉS
DE
LA
RÉGIONALISATION
L'échec
des
politiques
de
régionalisation
est
patent,
jusqu'à
ce
jour,
dans
les
plus
grands
pays
«
développés
»
du
système
«
occidental
».
En
France
part
iculièrement,
de
grandes
régions
historiques
ou
géographiques
comme
la
Bretagne,
le
Centre
ou
le
Midi
entre
autres,
sont
le
thème
de
maintes
études
et
programmes,
sans
pour
autant
qu'ait
été
inversé
aucun
des
processus
majeurs
par
lesquels
se
traduit
l'inégalité
du
développement
national
en
leur
défaveur.
A
un
niveau
moins
général,
l'analyse
démographique
ou
économique
décèle
aussi
bien
le
poids
excessif
de
certaines
zones
urbaines
et
industrielles
que
l'ankylose
et
l'abandon
relatif
d'arrondissements
administratifs,
voire
de
départements
entiers...
Le
gouvernement
et
les
grands
partis
politiques
font
de
la
régionalisation
un
de
leurs
principaux
chevaux
de
bataille
parce
qu'il
n'est
plus
possible
de
nier
l'importance
ni
la
gravité
des
pressions
et
des
déséquil
ibres
engendrés,
dans
tous
les
domaines,
beaucoup
moins
par
l'inégale
répar
tition
des
ressources
naturelles
ou
des
chances
historiques
mal
dominées
que
par
l'essor
d'un
mode
de
production
qui
concentre
au
maximum
les
moyens
et
les
forces
productives
accaparés
par
de
puissants
monopoles.
Le
système
s'avère
incapable
de
redistribuer
et
de
répartir
produits
et
richesses
créés
à
l'intérieur
d'un
espace
rationnellement
aménagé,
au
profit
de
toutes
les
populations
qui
y
vivent.
On
pourra
évoquer
aussi
l'exemple
de
l'Italie,
qui
a
poussé
beaucoup
plus
loin
et
jusqu'à
un
certain
point
rendu
effective
une
politique
de
régionalisation,
jusque
sur
le
plan
de
la
gestion
politique,
administrative
et
financière.
Malgré
un
effort
exceptionnel
de
l'Etat,
le
Mezzogiorno
n'a
pas
cessé
d'être
un
ensemble
régional
peu
industrialisé,
relativement
aux
régions
septentrionales
du
pays,
et
les
zones
pauvres
des
montagnes
et
des
collines
méridionales
surtout,
un
foyer
d'émigration,
de
sous-emploi
et
de
basse
productivité...
Sans
aller
plus
loin
dans
cette
évocation
des
problèmes
posés
par
l'inégal
développement
régional,
dans
tels
pays
dits
«
développés
»,
où
existent
du
*
Chargé
de
Recherche
au
C.N.R.S.,
docteur
es
lettres.
597

TIERS
MONDE
moins
de
larges
aires
urbanisées
et
industrialisées
capables
d'absorber
les
populations
qui
proviennent
des
régions
en
voie
de
déclin,
nous
ne
pouvons
que
constater
le
caractère
bien
plus
aigu
de
la
même
crise
dans
les
pays
dits
«
sous-développés
».
Le
propre
de
ces
derniers
n'est-il
pas
de
constituer
globalement
d'ailleurs
une
vaste
zone
incomplètement
industriaHsée
et
urba
nisée,
dans
la
dépendance
des
véritables
maîtres
du
système
où
ils
sont
intégrés
?
Il
ne
faut
pourtant
pas
s'y
tromper
:
les
pays
«
sous-développés
»,
en
réalité
pays
ex-coloniaux
ou
dépendants,
sont
eux-mêmes,
et
au
plus
haut
point,
le
théâtre
d'une
désintégration
régionale
et
interrégionale,
qui
est
l'un
des
plus
sûrs
indices
de
la
crise
générale
du
développement
de
ce
type
de
société.
C'est
une
telle
destruction
de
l'unité
économique
ou
plus
exactement
des
rapports
et
des
échanges
plus
ou
moins
équilibrés
d'une
part,
de
la
cohérence
sociale
d'autre
part,
qui
est
la
principale
caractéristique
des
pays
«
sous-
développés
».
Bien
que
cette
définition
du
pays
«
sous-développé
»
reste
confuse
et
sujette
à
grandes
variations,
comme
toutes
les
définitions
du
sous-
développement
qui
ne
se
réfèrent
qu'à
des
critères
propres
aux
pays
considérés
et
omettent
l'essentiel,
c'est-à-dire
la
dépendance
et
l'exploitation
dont
ils
sont
l'objet
du
fait
des
puissances
monopolistes,
elle
permet
de
reconnaître
la
situation
de
sous-développement.
Elle
souligne,
en
effet,
cette
dislocation
et
cette
ruine
des
activités
productives
traditionnelles,
qui
ne
peuvent
plus
alimenter
ni
soutenir
un
ordre
social
et
politique
satisfaisant
tant
bien
que
mal
les
besoins
ressentis.
LE
PROBLÈME
EN
TUNISIE
La
Tunisie
est
un
de
ces
pays
qui
ont
cessé
de
constituer
des
formations
sociales,
économiques
et
politiques
assez
équilibrées
et
cohérentes
pour
occuper
leurs
forces
productives
et
répondre
aux
besoins
éprouvés
par
leur
population.
Celles-ci
ne
ressentent
pas
seulement
des
«
manques
»
traditionnels
—
la
faim,
le
désarroi
devant
des
calamités
exceptionnelles,
etc.
—
qui
entraient,
si
l'on
peut
dire,
dans
la
«
normale
»
de
sociétés
insuffisamment
évoluées
techniquement
pour
dominer
tout
à
fait
leur
milieu
physique
en
particulier.
Le
propre
des
peuples
sous-développés
n'est
pas
de
se
trouver
aux
prises
avec
des
difficultés
connues,
qui
ont
toujours
été
à
la
base
du
progrès,
de
la
format
ion
des
liens
sociaux,
de
la
structuration
collective
des
cités
et
des
Etats
—
et
qui
peuvent
être
mieux
résolues
dans
une
société
ou
un
Etat
plus
évolué.
Il
est
de
ne
plus
pouvoir
y
faire
face
avec
leurs
propres
ressources,
avec
leur
force
de
travail,
leur
organisation
sociale,
de
se
trouver
au
contraire
empêchés
de
prendre
part
à
cette
tâche
commune
de
la
société
et
de
la
civilisation
nouv
elles
dans
lesquelles
ils
ont
été
intégrés
malgré
eux
ou
sans
eux.
Ainsi
le
peuple
tunisien,
qui
était
resté
un
peuple
de
petits
paysans,
jardiniers,
arbori-
598

DOCUMENTATION
culteurs,
céréaliculteurs,
éleveurs,
de
familles
indivises,
de
communautés
vill
ageoises
ou
semi-nomades,
sécrétant
ses
petites
villes
artisanales
et
commerç
antes,
son
aristocratie
et
son
Etat,
depuis
des
siècles
innombrables,
au
travers
de
toutes
les
péripéties
d'une
longue
histoire,
s'est
trouvé
relié,
puis
subor
donné
à
une
sphère
économique,
financière,
industrielle
et
moderne,
qui
a
concurrencé
et
ruiné
ses
activités,
annexé
son
Etat,
exploité
enfin
ses
ressources.
Ses
forces
productives
ont
cessé
d'évoluer
dans
leur
sphère
propre
et
n'ont
pu
tirer
le
profit
des
progrès
techniques
réalisés
en
dehors
d'elles.
Le
problème
fondamental
apparu
et
ressenti
dès
lors
est
celui
de
la
réadap
tation
de
tout
l'ensemble
national
à
un
nouveau
stade
historique,
dont
les
conditions
d'apparition
n'ont
pas
été
réunies
par
un
processus
évolutif
normal.
Il
y
a
bien
eu
sans
doute
apparition
d'un
secteur
moderne,
importé
et
initial
ement
commandé,
si
ce
n'est
entièrement
constitué
par
un
élément
étranger,
colons,
techniciens,
cadres,
fournisseurs
de
biens
d'équipement
et
de
consomm
ation,
entrepreneurs
et
investisseurs.
Ce
mouvement,
localisé
essentiellement
dans
les
zones
littorales,
urbaines
et
portuaires,
les
plus
favorables,
lançant
seulement
vers
l'intérieur
du
pays
quelques
antennes
destinées
à
en
drainer
les
matières
premières
et
les
productions
agricoles
les
plus
importantes,
ne
suscitait
qu'une
modernisation
restreinte
et
localisée
de
l'équipement
productif;
il
n'entraînait
qu'une
amélioration
plus
lente
et
limitée
encore
du
niveau
social
et
culturel
—
quand
il
ne
provoquait
pas,
au
contraire,
par
sa
seule
présence,
la
ruine
ou
la
disparition
des
anciennes
structures.
L'aménagement
du
terri
toire
était
orienté
en
fonction
d'intérêts
et
d'optiques
étrangers
à
la
population
«
traditionnelle
»,
considérée
comme
frappée
d'incapacité
permanente...
De
ce
fait,
toute
croissance,
toute
«
modernisation
»
des
infrastructures
et
des
moyens
de
production,
tout
«
progrès
»
social
et
culturel,
toute
accumulation
de
richesse
se
réalisaient
non
point
à
partir
des
niveaux
antérieurement
exis
tants
dans
le
pays,
mais
aux
dépens
de
ceux-ci.
Non
seulement
cette
croissance
excluait,
en
effet,
par
la
force
des
choses,
une
proportion
constamment
accrue
de
petits
producteurs
«
traditionnels
»
ruinés
par
une
concurrence
écrasante
et
laissés
sans
aide
ni
moyens
de
défense
contre
celle-ci,
mais
ses
origines
et
son
orientation
étrangères,
son
caractère
«
extraverti
»
expliquent
la
désarticula
tion
et
le
déséquilibre
généralisés
dans
tous
les
domaines,
en
particulier
dans
le
domaine
de
la
répartition
spatiale
des
populations
et
des
activités
majeures.
l'évolution
régionale
du
pays
tunisien
Le
caractère
colonial
de
la
croissance
tunisienne
sous
le
protectorat
a
été
suffisamment
analysé,
qu'on
en
veuille
faire
l'éloge
ou
la
critique,
pour
qu'il
ne
soit
pas
besoin
d'y
revenir
très
longuement.
Après
le
retour
à
l'indépen
dance,
lorsque
les
promoteurs
des
premiers
programmes
nationaux
de
dévelop-
599

TIERS
MONDE
pement
ont
voulu
justifier
ceux-ci
et
les
demandes
d'aide
internationale
qu'ils
présentaient
aux
organismes
spécialisés
et
aux
gouvernements
«
amis
»,
ils
ont
vigoureusement
souligné
les
anomalies
et
les
conséquences
néfastes
du
mode
de
croissance
introduit
à
l'époque
coloniale
:
la
paupérisation
et
la
prolétarisation
des
masses
rurales,
l'industrialisation
insuffisante
ou
absente,
les
besoins
élémentaires
non
satisfaits
dans
le
cadre
d'une
forte
natalité
et
d'une
pénétration
accentuée
des
influences
nouvelles,
le
sous-emploi
général
isé,
l'inégalité
criante
des
équipements
régionaux
de
base
eux-mêmes...
Pratiquement,
le
secteur
économique
et
social
modernisé
et
influencé
par
l'étranger
se
situait
dans
les
villes
du
littoral,
Tunis
en
premier
lieu,
Bizerte,
Sousse
et
Sfax,
ainsi
que
dans
les
bassins
et
plaines
colonisés
du
Tell
surtout;
le
Haut-Tell
et
la
Dorsale
restaient
en
grande
partie
«
traditionnels
»,
le
centre
et
le
sud
du
pays
renfermaient
de
vastes
espaces
peu
équipés,
sans
activités
ni
villes
modernes;
dans
l'intérieur
du
pays,
les
voies
de
communication
étaient
axées
sur
quelques
centres
administratifs
ou
miniers
isolés
au
milieu
de
régions
appauvries
ou
repliées
sur
elles-mêmes
et
dépourvues
de
tout
dynamisme.
Les
grandes
lignes
du
tableau
esquissé
sont
donc
bien
connues.
Pour
autant,
une
première
question
se
pose
:
le
système
colonial
est-il
seul
respon
sable
de
cette
situation
ou,
plus
exactement,
quels
changements
sont-ils
sur
venus,
à
l'époque
du
protectorat
en
particulier,
et
du
point
de
vue
qui
nous
intéresse,
dans
les
structures
régionales
tunisiennes
?
Il
ne
fait
pas
de
doute
que,
bien
avant
1881,
la
Tunisie
présentait
déjà
de
grandes
disparités
régionales,
du
point
de
vue
économique,
social,
poli
tique
ou
démographique,
comme
on
peut
s'y
attendre
de
tout
pays
marqué
par
de
grandes
différences
morphologiques
et
climatiques,
d'une
part,
ayant
déjà
traversé
de
longues
séries
de
mutations
historiques,
d'autre
part.
Deux
points
essentiels
doivent
être
soulignés
:
1)
Le
fait
qu'à
certaines
époques
anciennes,
le
pays
—
1'
Africa
«
punique
»,
puis
«
romaine
»
ou
«
arabe
»
(musul
mane)
—
avait
connu
des
développements
urbains
et
régionaux
considérables,
donnant
au
pays
une
physionomie
très
différente
et
vraisemblablement
mieux
structurée
qu'au
xixe
siècle
;
2)
Cet
autre
fait,
constaté
par
tous
les
voyageurs
des
xvine-xixe
siècles,
que
la
ruine
et
le
dépeuplement
du
pays,
sa
«
désurba-
nisation
»
si
l'on
peut
dire,
s'étaient
généralisés
à
un
rythme
presque
catastr
ophique
depuis
une
date
très
récente
—
second
tiers
du
xixe
siècle
approxi
mativement.
La
prospérité
démographique
et
économique
de
l'ancienne
Afrique,
relativement
au
moins
à
ce
qu'étaient
le
niveau
des
forces
productives
et
les
antiques
civilisations
méditerranéennes,
se
mesure
aisément
au
rôle
politique
et
à
la
dimension
des
grandes
cités-capitales
qui
la
commandaient.
Les deux
Carthages,
la
«
punique
»
et
la
«
romaine
»,
puis
Kairouan
dirigèrent
de
puis-
600
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%