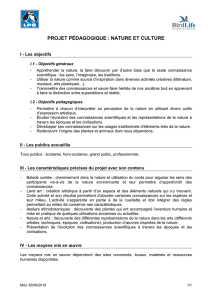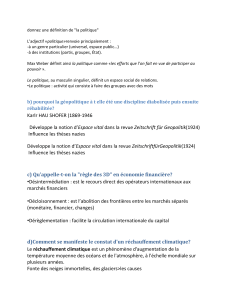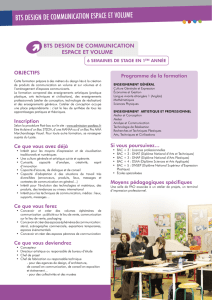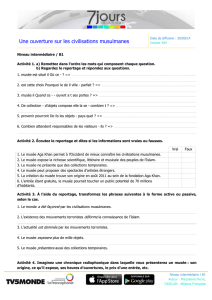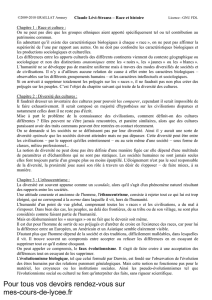Arnason-La compatibilité des civilisations

LA COMPATIBILITÉ DES CIVILISATIONS
Johann P. Arnason
Université de la Trobe
« La comparaison implique toujours un contexte commun. »
(Marshall Hodgson, Rethinking World History)
INTRODUCTION
’idée que je développerai ici pourrait être illustrée à partir d’un des livres de
Fernand Braudel. Sur la foi de son titre, Grammaire des civilisations, on
s’attendrait à une analyse de structures fondamentales sous-jacentes et de leurs
diverses variantes. Mais dans la partie introductive de son livre, Braudel tourne le
dos à la métaphore et au programme qu’elle implique, et préfère parler d’un
« nouveau vocabulaire ». Il argue qu’avant de se pencher sur le détail des
complexes civilisationnels et de leurs histoires, il nous faut inventorier les termes
pouvant servir à les décrire. À ses yeux, le vocabulaire doit rendre justice au
caractère multidimensionnel des civilisations : depuis les frontières géopolitiques
(les civilisations, remarque-t-il, peuvent toujours être situées sur une carte) et les
réseaux économiques jusqu’aux modes de pensée et aux croyances religieuses.
Nulle part Braudel n’aborde systématiquement les facteurs définitoires ou les
principes à l’œuvre dans chacune de ces dimensions, ni les divers types de
rapports entre elles. Le gros du livre est donc un exposé historique des principaux
complexes civilisationnels. On comprend aisément que le traducteur anglais ait
préféré intituler le livre A History of Civilizations.
L
Si, revenant au titre original, nous tentons de prendre la métaphore d’une
« grammaire des civilisations » plus au sérieux que Braudel ne l’a fait, la
perspective comparative implicite doit être énoncée plus clairement. Ce qui irait
dans le sens de la métaphore linguistique : l’étude comparative moderne des
langues a été parallèle au développement de la grammaire. Mais dans le champ
des études civilisationnelles, cette approche bute sur certaines difficultés
spécifiques. Nous pouvons aujourd’hui admettre, je crois, que les unités macro-
EUROSTUDIA — REVUE TRANSATLANTIQUE DE RECHERCHE SUR L’EUROPE
vol. 4; n°2 (dec. 2008) : Comparatisme européen et au-delà

EUROSTUDIA 4:2
2
sociales et macro-historiques communément désignées sous le nom de
« civilisations » figurent désormais sur la carte des sciences sociales et n’en seront
pas rayées de sitôt. Après un tournant civilisationnel peu concluant de la sociologie
classique (où, dans le cas le plus instructif, le concept de civilisation apparaît
comme un complément et un correctif au concept de société), puis une longue
phase post-classique d’oubli presque total, la sociologie historique, à la fin du XXe
siècle, a redécouvert les civilisations et conceptualisé de façon plus systématique
cette partie de son champ. En d’autres termes, elle a commencé à explorer la
« dimension civilisationnelle de l’enquête sociale », pour citer Shmuel Eisenstadt,
qui a contribué plus que quiconque à baliser ce chemin. Les problèmes qu’elle a
rencontrés ne tiennent pas seulement à la complexité des questions en débat ni à
l’absence d’un travail préparatoire soutenu. Plus spécifiquement, l’idée de
« civilisations » au pluriel, quasiment abandonnée depuis longtemps dans les
sciences sociales, a survécu ailleurs et pris des connotations qui tendent à entraver
l’analyse comparative. Je pense à une tradition peu structurée, qui fut illustrée le
plus mémorablement par Oswald Spengler et Arnold Toynbee, mais le plus
récemment par Samuel Huntington. Je ne dis pas que cette tradition n’a aucun
intérêt : les écrits de Toynbee et dans une moindre mesure ceux de Spengler
contiennent des aperçus qui restent précieux, même s’il faut les traduire dans un
autre langage ; et il y a même certaines choses à retirer de Huntington. Mais – dans
les œuvres de ces auteurs et d’autres qui ont suivi une ligne similaire – il y a une
tendance omniprésente (quoique parfois combattue) à convertir une intuition saine
en une théorie erronée. L’intuition, c’est que les civilisations sont en quelque sorte
des mondes différents et relativement autonomes ; la théorie fait un pas de plus et
les interprète comme des mondes clos. Huntington en fournit l’exemple le plus
notoire quand il fait des civilisations « les tribus ultimes ». La comparaison tend
donc à se réduire à des parallèles externes entre modèles d’essor, d’apogée et de
déclin. Dans le même esprit, il devient plus facile d’envisager des « chocs de
civilisations » que des rencontres mutuellement enrichissantes (quoiqu’il faille
s’efforcer de ne pas confondre les opinions de Huntington avec les caricatures
qu’en ont données certains de ses détracteurs).
Débattre de la comparabilité des civilisations, c’est donc aussi soulever la question
des réajustements conceptuels nécessaires pour surmonter les obstacles que je
viens de mentionner. Mais avant d’avancer sur cette voie, penchons-nous
brièvement sur une question préliminaire. L’idée de civilisations au pluriel a
toujours coexisté difficilement avec le concept de civilisation au singulier, et les
diverses conceptions des rapports entre les deux se reflètent dans les différentes
façons de comprendre la pluralité des civilisations. Il faudrait donc dire quelques
mots de cet arrière-plan, notamment en ce qui concerne la tradition sociologique.
Le concept de civilisation au singulier – ou d’un processus civilisateur universel –

Arnason — La compatibilité des civilisations 3
joue un rôle significatif, quoique parfois invisible, dans la sociologie classique. Il
désigne, en gros, le développement de tout un complexe de capacités humaines et
de rapports de l’homme au monde. C’est particulièrement évident dans les
références de Marx et de Durkheim à la civilisation ou aux forces civilisatrices
(c’est entre autres ce à quoi pense Marx quand il parle de la « grande influence
civilisatrice du capital »). Max Weber n’employait pas le même langage, mais sa
problématique de la rationalisation recoupe, pour une part non négligeable, les
thèmes que d’autres auteurs classiques avaient traités comme des aspects de la
civilisation. Norbert Elias a plus tard essayé de réintégrer le programme wébérien
dans une théorie explicite et systématique de la civilisation. Si l’on considère
l’héritage classique dans son ensemble, il paraît légitime de dire que le concept de
civilisation au singulier a une portée anti-réductionniste : il nous rappelle la
complexité de la condition humaine et son histoire. Cela reste vrai même dans les
cas où – comme chez Marx et Elias – il se heurte manifestement à des tendances
réductionnistes inhérentes, sous d’autres aspects, au cadre conceptuel.
Si nous pouvons retirer de la tradition sociologique un concept de civilisation au
singulier qui soit complexe et non réductionniste, le lien avec l’idée de civilisations
au pluriel devient plus facile à faire : le singulier prévoit la possibilité de
variations, voire de formes de vie variées. En même temps, cette approche
exclurait la conception des civilisations comme mondes séparés ou comme
identités étrangères les unes aux autres. Ce qui irait dans le sens d’affirmations
programmatiques formulées par certains chercheurs représentatifs de ce champ. Je
n’en citerai ici que deux. L’une est due à l’auteur de la plus ambitieuse tentative
occidentale pour comprendre le monde islamique, et un des rares spécialistes de
cette aire à avoir développé ses propres variations sur des thèmes civilisationnels :
« Ce qui différencie les principales traditions, ce ne sont pas tant les éléments
particuliers présents en elles que le poids respectif qui leur est accordé, et la
structuration de leur interaction dans le contexte d’ensemble1. » L’autre est d’un
historien qui a fait œuvre de pionnier dans l’analyse comparative des traditions
historiographiques : il faut, estime-t-il, « comprendre la spécificité d’une culture
comme combinaison d’éléments partagés par toutes les autres cultures, mais
articulés différemment. La particularité des cultures consiste ainsi dans
l’articulation différente des mêmes éléments2. » Les formules citées renvoient à des
traditions et à des cultures, mais elles peuvent s’appliquer (et, dans le cas de
Hodgson, avec l’approbation explicite de l’auteur) aux formations
civilisationnelles. L’idée centrale – selon laquelle les civilisations seraient des
combinaisons ou des articulations de thèmes ou de composants communs –
devrait, pour l’instant, être vue comme une hypothèse de travail. À l’évidence, il
reste encore beaucoup à faire pour la développer concrètement. Mais il importe de
noter que le modèle d’analyse comparative le plus avancé à l’heure actuelle, la

EUROSTUDIA 4:2
4
théorie des civilisations axiales d’Eisenstadt, reprend ces grandes lignes. Le
commun dénominateur de l’« axialité » est – selon Eisenstadt – un ensemble
d’innovations culturelles qui affectent l’interprétation du monde non moins que
l’organisation institutionnelle de la vie sociale ; ce cadre de référence commun
(mais non reconnu mutuellement) est ensuite structuré différemment selon les
traditions, et les variantes se muent en modèles civilisationnels divergents.
QUELQUES ÉLÉMENTS DE BASE
L’analyse suivante se concentrera sur quelques postulats de base qui sont centraux
dans l’idée de civilisations au pluriel (le mieux serait de les comprendre dans une
optique herméneutique, c’est-à-dire comme les prémisses reconstruites d’une
tradition théorique), en essayant de rattacher chacune à la conception de l’unité et
de la diversité dont il vient d’être question. Autrement dit, les caractéristiques
définitoires générales des civilisations seront analysées comme cadres de
variations. Je commencerai par les aspects les plus visibles extérieurement, qui ont
également été le point de départ empirique d’une réflexion sur les civilisations
dans la tradition sociologique, puis je passerai à des dimensions plus internes.
1. La première thèse à examiner est celle qu’ont posée Durkheim et Mauss en
suggérant d’introduire le concept pluriel de civilisation dans le discours
sociologique : les civilisations sont des « familles de sociétés », des unités macro-
sociales dont la taille et la nature ne peuvent être appréhendées à l’aide du
concept, plus familier, de société. Telle était aussi la perspective d’Arnold Toynbee
qui, en concevant les civilisations comme des macro-sociétés (ou comme des
« unités intelligibles » d’interaction sociale et historique), présageait les arguments
des sociologues qui, plus tard, critiqueraient l’ancrage national de leur discipline.
Mais je m’en tiendrai plus étroitement ici à la ligne adoptée par Durkheim et
Mauss. Quand ils définissent les civilisations comme un groupement de sociétés, il
est clair d’après le contexte qu’ils se réfèrent – en premier lieu – à des sociétés
constituées politiquement. L’État-nation (ou du moins les formations répondant
approximativement à ses critères) est le paradigme d’une société unifiée. Quant à
l’unité qui définit une famille de civilisations, sa nature est plus insaisissable.
Durkheim et Mauss pensaient manifestement à des traits culturels, compris dans
un sens très large, et ils suggéraient – sans la développer – une typologie de ces
traits, à comparer selon leur potentiel de diffusion ou d’unification à l’échelle
civilisationnelle. Cette description très sommaire peut être prise comme point de
départ de l’analyse. Pour commencer, il conviendrait de définir plus
spécifiquement la dimension culturelle comme un domaine de significations
constitutives, c’est-à-dire reliant l’articulation du monde à la régulation de la vie

Arnason — La compatibilité des civilisations 5
sociale. Dès lors, nous pouvons distinguer différentes façons de combiner unité
culturelle et division politique : pour prendre deux exemples familiers, il y a un net
contraste entre la civilisation grecque antique et la chrétienté médiévale
d’Occident. Mais il sera également nécessaire de comparer les civilisations selon
l’intensité et le succès de leurs efforts pour imposer l’unité politique – c’est-à-dire
leurs projets impériaux. Certaines ont donné naissance à des formations impériales
plus durables et plus unifiées que d’autres. Ici, les exemples par excellence sont la
Chine d’une part, l’Inde et la chrétienté d’Occident de l’autre – même si
l’opposition n’est pas aussi tranchée que le laisseraient croire les visions
traditionnelles de la continuité chinoise. Il faut prendre en compte un spectre de
variations plus large. Les aléas des projets impériaux dans le monde islamique
(« islamicate », chez Hodgson) ne sont qu’un aspect important d’une trajectoire
civilisationnelle plus large. Et pour en revenir au cas chinois, on considère de plus
en plus le conflit avec les contre-empires périphériques comme une clé de l’histoire
chinoise. Ces contre-empires étaient trans-civilisationnels, bâtis sur des
fondements centrasiatiques mais adaptés aux traditions chinoises, et l’évolution de
ces schémas combinatoires a eu une longue histoire. C’est le dernier de ces contre-
empires (l’empire mandchou) qui a finalement élaboré une synthèse durable des
composants chinois et centrasiatiques. Une autre configuration a pris forme dans la
chrétienté d’Orient. Si je ne me trompe, les historiens tendent maintenant à voir la
longue rivalité entre Byzance et la Bulgarie comme une lutte entre un empire et un
contre-empire, mais dans ce cas, la conversion religieuse et l’assimilation culturelle
ont coupé le contre-empire de ses racines centrasiatiques. Au même moment se
constituait un État périphérique aux aspirations impériales (la Rus de Kiev),
indépendamment du front principal et dans un cadre géopolitique qui prévenait
tout conflit direct avec le centre impérial d’origine.
Pour conclure ces remarques sur les empires et les civilisations, citons le cas d’un
empire – probablement sans égal ni équivalent sous ce rapport – qui a d’abord créé
la charpente d’une civilisation composite, puis subi une transformation qui a mis
une religion périphérique dans une position de domination culturelle, avant de se
perpétuer dans trois civilisations différentes. Je pense, bien sûr, à l’empire romain.
Une étude comparative de l’unité et de la diversité civilisationnelles devrait aussi
s’élargir à la sphère économique. Ici, le point de départ le plus commode est le
concept braudélien d’« économie-monde ». Une économie-monde est une
constellation de réseaux entre des unités économiques de moindre échelle. Les
civilisations varient selon l’ampleur et la nature des économies-mondes qu’elles
créent et entretiennent, tant en deçà qu’au-delà de leurs frontières. Les relations
intra- et intercivilisationnelles de ce type ont leur dynamique propre, parfois
propice à une unification plus poussée que les facteurs culturels ou politiques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%