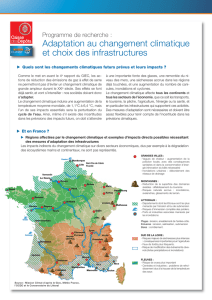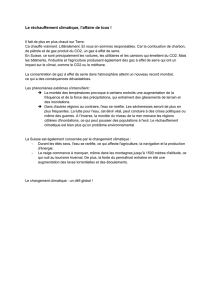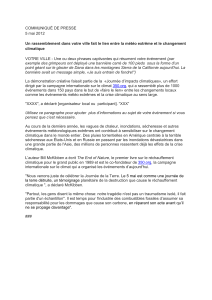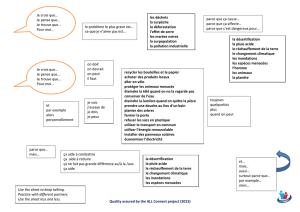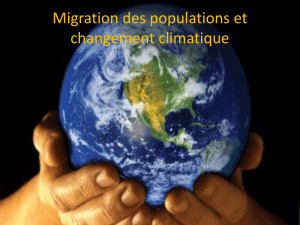compte rendu - Université Rennes 2

1
RÉUNION DU GDR 2663 CNRS RICLIM
Université de Haute-Alsace (COLMAR),
CERDACC - EA 3992,
24 et 25 novembre 2009
COMPTE RENDU
La loi Barnier, 15 ans après.
La loi Barnier, 15 ans après.La loi Barnier, 15 ans après.
La loi Barnier, 15 ans après.
Ap
ApAp
Approches interdisciplinaires sur la
proches interdisciplinaires sur la proches interdisciplinaires sur la
proches interdisciplinaires sur la
gestion des risques naturels
gestion des risques naturelsgestion des risques naturels
gestion des risques naturels

2
Conformément à la décision prise lors de la réunion de Grenoble en mai 2009, la deuxième
réunion semestrielle du groupe RICLIM pour l’année 2009 s’est tenue les 24 et 25 novembre
dans les locaux de l’IUT de Colmar (Université de Haute-Alsace) à l’invitation de l’équipe du
CERDACC – EA 3992 (Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs
et des Catastrophes), sur le thème de la Loi Barnier, et les approches interdisciplinaires
sur la gestion des risques naturels. Comme il est d’usage lors des réunions semestrielles
« RICLIM », la première journée (mardi 24 novembre) a été consacrée à des communications
scientifiques, permettant de dresser un état des lieux des recherches menées dans le cadre des
travaux du GDR, mais aussi d’organiser d’éventuelles collaborations nouvelles. La deuxième
journée (mercredi 25), ou plutôt demi-journée (matinée) a quant à elle été consacrée aux
activités et fonctionnement du GDR. L’ensemble des participants remercie tout
particulièrement Marie-France Steinle-Feuerbach, Hervé Arbousset, Françoise Geismar et
Christine Gangloff pour leur accueil dans les locaux de l’IUT de Colmar.
1. Bilan de la journée du mardi 24 novembre
Durant la journée consacrée à la présentation des travaux de recherche du GDR, 18
personnes au total étaient présentes (cf. liste des participants), dont 11 en tant qu’intervenants.
Tous les intervenants prévus étaient présents. La séance a été ouverte par Christine
GANGLOFF, directrice de l’IUT de Colmar.
- Les quatre premières interventions orales (matinée) ont été consacrées à la loi Barnier
proprement dite, à ses applications et implications, essentiellement au niveau juridique.
- Les quatre interventions suivantes (après-midi) ont abordé et développé les problèmes de
gestion des risques hydro-climatiques en croisant les approches juridiques, géographiques
et historiques.
- Enfin, la dernière intervention, présentée par Roland Nussbaum, a développé plus
spécialement le point de vue du secteur de l’assurance sur les politiques de prévention des
risques liés au climat.
1.1. La loi Barnier 15 ans après : bilan et perspectives
Hervé Arbousset et Marie-France Steinlé-Feuerbach (CERDACC–UHA, Colmar)
Le risque inondation concerne une commune sur trois en France (16113 communes, une
réponse ministérielle du 8 mars 2005 indique que les inondations concernent 16386
communes), alors que les inondations représentent 70% des catastrophes naturelles (soit les ¾
des remboursements au titre de ce régime législatif consacré en 1982). Les inondations
concernent 90% des communes couvertes par un P.P.R.N.P.
Le risque inondation comme tous les risques concerne le droit puisque ce dernier a
pour fonction de permettre une vie harmonieuse en société, ce qui passe, notamment, par la
consécration d’un haut degré de sécurité, d’autant plus élevé que nos sociétés industrialisées
considèrent les risques comme inacceptables. Le droit a donc dû intervenir dès lors que des
risques naturels existaient par la prévention et par la réparation.
Ainsi, dans le domaine des inondations et plus largement dans celui des risques naturels,
le législateur a d’abord opté pour la mise en œuvre de mécanisme de réparation pour en venir
dans la période contemporaine à une logique de prévention devenue une préoccupation
centrale.

3
En France, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement dite loi Barnier a eu pour ambition d’améliorer la prévention des risques
naturels. Cet objectif de prévention a été poursuivi par le législateur et les pouvoirs publics.
Elle a cherché à asseoir un peu plus la démocratie participative. Depuis, des précisions ont été
apportées par le législateur (notamment par la loi du 30 juillet 2003), le pouvoir exécutif et le
juge afin de développer l’information des populations, la concertation dans l’élaboration des
PPRNP. Du côté de l’indemnisation, si des progrès vers davantage de transparence dans les
arrêtés constatant l’état de catastrophe naturelle ont été réalisés, une réforme en profondeur de
la loi du 13 juillet 1982 est toujours attendue. L’actualité du sujet est mise en lumière par un
rapport récent du Sénat ainsi que par la transposition de la directive communautaire du 23
octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
1.2. Considérations sur l’esprit des lois environnementales, sur la place qu’y
tiennent les risques liés au climat, sur l’évolution de ceux-ci en matière de
recherche, de représentation, de modes d’action
Denis Lamarre, avec l’aide de Jean-Pierre Besancenot, Dominique Bourg,
Roland Nussbaum
Le premier principe qui inspire la loi n° 95-101 dite Barnier est le principe de
précaution (PP). Dominique Bourg a montré que le PP était dans l’esprit du temps depuis le
début des années 80. La loi Barnier compte quatre titres, dont seul le titre II concerne « les
dispositions relatives à la prévention des risques naturels ». L’objet principal de ce titre réside
dans la mise en place de plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), en
particulier à propos des inondations, qui représentent environ les ¾ du coût des catastrophes
naturelles dans notre pays. D’autres phénomènes climatiques, tels les cyclones tempêtes et
avalanches, sont également concernés par les PPRN. Cependant, la gestion des déchets et la
prévention des pollutions étaient les préoccupations majeures (titre IV).
La mise en œuvre des PPRN pose des problèmes d’échelles, tant dans la délimitation
des zones exposées aux risques qu’à propos des découpages territoriaux, autrement dit de la
pertinence des cadres administratifs. Serge Antoine avait raison de dire : « l’important est la
relation que l’on peut mettre entre les échelles » (in Autrement, 2002). Plusieurs exemples de
malfaçons à cet égard ont été évoqués : le DICRIM de Dijon, le plan climat de la région de
Bourgogne, le plan français pour le climat (titre du JDD du 1
er
novembre 2009), ainsi que le
récent rapport de l’ONERC sur les coûts de l’adaptation aux effets du réchauffement
climatique, présenté le 2 octobre dernier.
Depuis une dizaine d’années, la recherche en climatologie a été happée par la question
du changement climatique, comme elle l’avait été précédemment par le Niño et par la
sécheresse au Sahel. Le rôle de l’IPCC-Giec a été prépondérant dans cette réorientation.
Dépendant de l’ONU, le Giec a ainsi conduit à la mainmise du politique sur les questions
climatiques, sur fond de « société du risque ».
Il y a lieu également d’être circonspect vis-à-vis des aspects économiques et financiers
liés au climat. La grave crise économique et sociale en cours serait « une chance de sauver la
planète » du point de vue écologique selon Lord Nicholas Stern, qui cependant souhaite la
création d’une agence mondiale de l’environnement, indépendante de l’ONU (contrairement
au Giec-IPCC). Qu’en est-il du récent rapport (22/10/09) rédigé par les grands assureurs
mondiaux, intitulé « the global state of sustainable insurance » ? Rappelons, entre autres, que
70% des Indiens ignorent ce qu’est la globalisation ; quant au développement durable…

4
Koffi Annan réclame un accord ambitieux à la prochaine conférence de Copenhague : « le
climat nous lance un ultimatum. Ensemble nous pouvons agir ». Pour opiner, cliquez donc sur
www.timeforclimatejustice.org
On voit se multiplier des formulations un peu courtes, par conséquent oiseuses ou
douteuses. Pour Paul Virilio, « la déportation, c’est aussi bien la délocalisation d’entreprises
que les réfugiés climatiques ». La manchette du Monde daté du 19/11/09 donne le vertige :
« le poids de la natalité menacerait le climat ».
Le potentiel climatique des sociétés humaines, c’est-à-dire l’ensemble des ressources
et des risques liés au climat, est une notion complexe. Il est indispensable de poursuivre
inlassablement la recherche interdisciplinaire, dans un cadre indépendant et transparent,
comme le GDR Riclim a tenté de le faire modestement. Tel est l’esprit qui doit nous animer,
chercheurs jeunes et moins jeunes réunis, avec l’espoir de résister aux difficultés :
« weathering the storm ».
1.3. Loi Barnier et action civile des associations de défense de l’environnement
Benoit Steinmetz, Université de Haute Alsace (CERDACC – UHA, Colmar)
L’introduction d’une action par une association de protection de l’environnement
répond à des conditions spécifiques qui résultent en grande partie de la loi du 2 février 1995,
appelée aussi loi Barnier.
L’article L. 142-1 du Code de l’environnement dispose que toute association de
protection de l'environnement, qui est agréée conformément à l'article L. 141-1, justifie d'un
intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et
ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout
ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. Ce texte reprend en grande
partie le texte de la loi Barnier, la principale modification résultant de la loi n°2006-872 du 13
juillet 2006, laquelle a limité l’intérêt à agir aux seules associations agréées avant que la
décision attaquée ne soit rendue.
Devant les juridictions judiciaires, les associations peuvent à l’inverse agir en se
fondant sur l’article L. 142-2 du Code de l’environnement qui prévoit que les associations
agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de
la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de
l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les
pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ce texte est quasiment
identique à celui de la loi Barnier, excepté l’inclusion par la loi du 13 juin 2006 de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection dans le champ des domaines couverts.
L’action civile devant les juridictions judiciaires est également ouverte aux
associations qui, sans être agrées, sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la
date des faits et qui ont pour objet statutaire la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même Code, en l’occurrence une atteinte à l’eau ou le
respect de la législation concernant les installations classées. Ce texte, repris par la loi Barnier
d’une loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, n’a pas été modifié depuis.

5
Les conditions pour agir des associations n’ont été que peu modifiées depuis la loi
Barnier, si ce n’est sur quelques points mineurs qui ne remettent pas en cause l’essence de la
loi. D’autres textes en revanche ont et auront une incidence directe sur le sujet. La
problématique n’est plus de savoir si l’association peut agir en justice, mais de savoir avec qui
et dans quel but.
Les régions bénéficient depuis la loi du 1er août 2008 (article L. 142-4 du Code de
l’environnement) de la faculté qui était ouverte aux communes et aux départements d’exercer
les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect au
territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux
dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement. Ces derniers doivent
justifier d’une « atteinte effective d’un espace naturel sensible » et préciser avec exactitude la
zone naturelle touchée par la pollution et le degré de pollution.
Le simple constat d’un changement climatique ne permet pas l’action en justice, au
contraire d’une pollution ou d’un événement naturel qui serait causé en partie ou totalement
par une action ou par une omission d’une personne physique ou morale déterminée. Le cœur
de la question réside en effet dans l’exigence d’un intérêt à agir.
Il est admis qu’une association peut agir en remboursement des sommes dépensées par
elle pour limiter une pollution, remettre en état un site ou du fait d’une intervention sur la
faune ou la flore. Il s’agit alors de demander réparation du préjudice matériel subi par la
personne morale. La difficulté est alors de chiffrer et de prouver la réalité des sommes
engagées et exclusivement consacrées à réparer les conséquences de la pollution. A défaut, la
demande ne pourra qu’être rejetée.
De même, il est admis qu’une association puisse agir en réparation du préjudice moral
consistant soit en la détérioration de l’image ou de la réputation d’une collectivité locale, soit
en l’atteinte à un intérêt collectif défendu par une association.
Cette faculté pour l’association à agir en justice résulte principalement de la loi Barnier et n’a
pas été remise en cause depuis, mais il est vrai que financièrement là ne réside pas le principal
danger pour la société à l’origine d’une pollution.
Plusieurs décisions de justice ont admis la réparation d’un préjudice de nature
différente, à savoir le préjudice environnemental. Les enjeux financiers sont alors tout autres.
Les sommes dues correspondent « au prix de l’atteinte à l’environnement ». Que cette
restauration soit impossible, par exemple du fait de la disparition définitive d’une espèce, ou
qu’elle nécessite un temps très long, conduit ainsi à une sanction plus importante, non pas sur
le fondement du préjudice matériel, mais sur le fondement de l’atteinte au patrimoine
écologique commun.
La loi du 1 juillet 2008 conduit à s’interroger sur la possibilité pour une association
d’agir en réparation du préjudice environnemental.
Le texte prévoit que les associations peuvent informer le Préfet d’un dommage ou
d’une menace imminente de dommage si des indices sérieux existent et lui demander de
prendre les mesures nécessaires. Elles peuvent également prendre les premières mesures
préventives dans l’attente que les responsabilités soient identifiées.
De même, si un dommage est causé, l’exploitant doit proposer au Préfet les mesures
de réparation envisagées. Celles-ci sont communiquées aux différentes associations qui
émettent à leur tour un avis au Préfet, avant que celui-ci ne valide ou non les mesures
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%