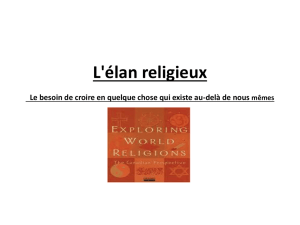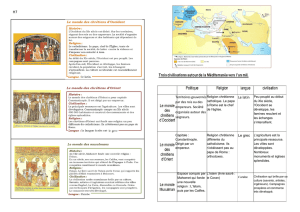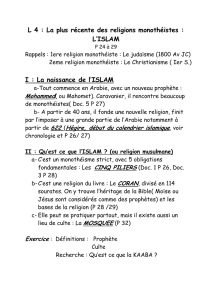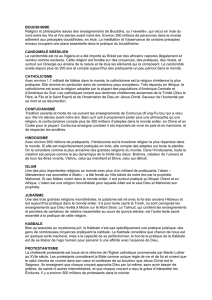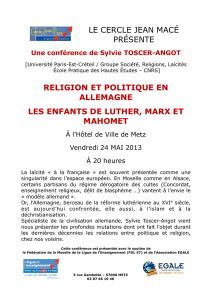Guo Qiyong La réligiosité des nouveaux

- 1 / 32 -
郭齐勇 :当代新儒家对儒学宗教性问题的反思
Guo Qiyong :
Réflexions des néo-confucianistes contemporains
sur la question de la religiosité du confucianisme
《中国哲学史》 1999 年第 1期
Face au défi lancé par la culture occidentale et à l’erreur des intellectuels occidentaux, des
missionnaires à Hegel, de considérer le confucianisme comme une éthique profane banale, il
n’est pas de représentant notable des néo-confucianistes contemporains qui n’ait attaché de
l’importance à exhumer l’esprit religieux du confucianisme. En un certain sens, ces
discussions sur la question de la religiosité du confucianisme présentent deux enjeux
importants, celui de se familiariser et de dialoguer avec les sources psycho-spirituelles de
l’Occident et, à partir de là, celui d’approfondir notre connaissance des traditions des Cinq
Classiques1 et des Quatre Livres2 de la Chine ancienne3 et des dynasties Song et Ming4 afin de
sortir par le haut des « études Han »5 de l’époque des Qing. Après le bouleversement du
Quatre mai, les néo-confucianistes contemporains ont commencé à revisiter la civilisation
psycho-spirituelle de l’Asie orientale et son noyau de valeurs. Le confucianisme est une forme
particulière de sagesse de l’existence humaine, c’est un savoir de la vie.
La question de savoir si le confucianisme est ou non une religion ou s’il a ou non un caractère
religieux est liée à la définition de la « religion » et au jugement de valeur porté sur elle, mais
elle est aussi liée à la définition de l’esprit humaniste de la tradition chinoise et au jugement
porté sur lui. Ce n’est qu’en dépassant la définition de la religion comme religion monothéiste
1 Wujing *(五经) Les Cinq Classiques
-
--
-
Ce terme se réfère à cinq ouvrages auquel le nom de
Confucius est attaché, car il les cite dans ses Entretiens : le Classique des Poèmes (Shijing 诗经),
le Classique des Documents ou Classique de l'Histoire (Shujing 书经), le Traité des Rites (Liji 礼记),
le Classique des Mutations (Yijing 易经), les Printemps et Automnes ou Annales de la Principauté de
Lu entre 722 et 481 avant notre ère (Chunqiu 春秋). Voir détails dans Anne Cheng,
Histoire de la
pensée chinoise
, Seuil, Paris, 1997, pp.80 et sq. [ci-dessous A.Cheng,
Histoire …
]. Les versions les
plus anciennes de ces documents à nous être parvenues remontent aux dynasties des Han (entre –
221 – 220).
2 Sishu (四书) - Les Quatre Livres.
. .
. Ce terme désigne une compilation réalisée par Zhu Xi (1130-1200)
de quatre documents remontant à la Chine ancienne (221 av.notre ère), qui a servi de base aux
examens impériaux de 1313 à 1905 comprenant: la Grande Etude (Da Xue 大学), les Entretiens de
Confucius (Lunyu 论语), le Mencius ( Mengzi 孟子), l'Invariable Milieu (Zhongyong 中庸) ; le premier
et le dernier de ces documents sont des chapitres d’un des cinq Classiques, le Traité des Rites (Liji
礼记). L'ordre ci-dessus, établi par Zhu Xi, a été contesté, parce qu'il sous-entend l'ordre dans lequel
ces œuvres doivent être étudiées et est donc déjà une interprétation de l'ensemble de l'enseignement.
On a comparé ces deux compilations à l’Ancien et au Nouveau Testament (B.Vermander, MZS). La
grande différence est que le « canon » des Quatre Livres a été fixé environ quinze siècles après leur
écriture.
3 La « Chine ancienne » désigne la Chine d’avant la formation du premier empire par la dynastie Qin
秦(221-207 av notre ère).
4 Les dynasties Song 宋 et Ming 明 sont les dynasties des Song du Nord 北宋 (960-1127), des Song
du Sud 南宋 (1127-1279) et des Ming (1368-1644).
5 Etudes d’érudition sur les textes en opposition aux spéculations morales. Voir A.Cheng,
Histoire …
,
pp.560 sq.

- 2 / 32 -
de l’« Autre absolu », qu’en dépassant “l’état d’esprit des Lumières ” de l’humanisme d’une
minorité qui procède par exclusion et division, que l’on peut correctement comprendre la
question de la nature du confucianisme, de sa particularité, de son essence et de son sens
profond. Quant à la discussion sur la fonction religieuse de la morale des Confucéens, elle est
limitée à la Chine ancienne et encore d’une manière superficielle, alors que ce qui a vraiment
du sens c’est l’exhumation et le déploiement du fondement rationnel transcendant qui est
derrière la pratique morale des Confucianistes et la voie de leur ‘se poser et accomplir son
Destin’6.
Aussi, la discussion qui se développe à partir des questions sur ‘la Nature humaine7 et la Voie
du Ciel’8, ‘l’unité du Ciel et de l’Homme’, la ‘transcendance immanente’, ‘le principe des
deux perspectives’, la ‘ transformation du Moi ’ est devenue le centre géométrique et le centre
de gravité du confucianisme contemporain. Cet article, en étudiant le sens religieux et moral
de l’œuvre de quatre penseurs, Tang Junyi, Mou Zongsan, Du Weiming, Liu Shuxian, vise à
exposer l’importante contribution des néo-confucianistes contemporains à cet égard et les
révélations de diverses formes dans la réception de l’héritage de l’inspiration chinoise et son
renouveau pour le siècle prochain.
1. Généralités
Ce siècle a continuellement connu des questions et des discussions pour savoir si le
confucianisme est finalement une philosophie ou une religion, la raison en est que les gens
prennent fréquemment la philosophie spéculative occidentale ou les religions monothéistes
comme la référence unique pour interpréter d’une manière critique la pensée confucianiste
orientale.
Au début du siècle le scientisme était en vogue, le mot ‘ religion ’ était devenu en Chine un
mot presque péjoratif, équivalent de ‘ superstition ’ ; Hu Shi9 remplaça la religion par la foi en
la théorie de l’évolution et de la lutte pour la vie ; Zhang Taiyan, Liang Qichao, Wang
Guowei10 tenaient en grande estime la Loi bouddhique et n’admettaient pas que la Loi
bouddhique et la religion soient mises sur le même plan ; Ouyang Jingwu11 affirmait encore
que la Loi bouddhique n’était ni une philosophie ni une religion. Il n’y a que dans la zone de
contact entre les cultures chinoise et occidentale à Guangzhou et Hongkong que Kang Nanhai
6 anshen liming (安身立命) « se poser et accomplir son Destin ». Cette expression qui apparaît une
dizaine de fois dans le présent texte, est fréquente chez les Néo-confucianistes contemporains et
évoque la religiosité de l’attitude du confucianiste, non pas dans l’acceptation passive de son sort,
mais dans la possibilité d’accomplir là où il est (en poste) son destin, c’est-à-dire l’injonction céleste
d’un agir moral.
7 « Nature »
xing
性, ou encore « Nature humaine », « Nature foncière », c’est ce qui est inné et
distingue l’homme de l’animal ; pour Mencius et la tradition confucianiste à sa suite, c’est la
« connaissance innée du bien » (
liangzhi
良知), la « capacité innée de faire le bien » (
liangneng
良能) :
voir Mencius VII A 15/1 ;voir aussi A.Cheng,
Histoire …
, p.161 sq. La « Nature » est bonne.
Elle est encore la « part céleste » en l’homme, elle est issue du Ciel : cette inclination innée vers le
bien est injonction céleste.
8 Dao « Voie » (道), les Confucianistes distinguent la Voie de l’homme, qui est suivre sa nature
foncière, et la Voie du Ciel qui est succession incessante de yin et de yang, qui alternent avec mesure
pour conserver les potentialités de tous les êtres ainsi que les promesses de leurs transformations ;
elle est fondement constitutif de l’univers et son mode de fonctionnement ; la Voie du Ciel est le
modèle de la Voie de l’homme, qui en l’imitant accomplit sa part céleste. Anne Cheng,
Histoire de la
pensée chinoise
, Seuil, Paris, 1997, pp.171-175. [ci-dessous A.Cheng,
Histoire …
]
9 Hu Shi (1891-1962), écrivain, historien, philosophe, fervent partisan de l’occidentalisation à outrance.
10 Zhang Taiyan (1869-1936), Liang Qichao (1873-1929), Wang Guowei (1877-1927).
11 Ouyang Jingwu (1871-1943).

- 3 / 32 -
et son disciple Chen Huanzhang12, confrontés à l’expansion de l’influence du christianisme
pour désirer transformer le confucianisme en « religion de Confucius »13, mais ils étaient trop
impliqués politiquement et n’avaient pas compris en profondeur la valeur psycho-spirituelle
de la religion.
La fleur de l’intelligentsia chinoise, obsédés par le salut de la patrie et la recherche de la
prospérité, a presque entièrement accepté la Raison des Lumières, et en a fait l’idéologie
dominante dans la Chine du XXème siècle. Et ceci comprenait une dépréciation de la religion,
une exaltation de l’homme et de la science mis sur un piédestal, quand ce n’était pas faire
appel une science et une démocratie superficielles pour évaluer les religions, les mythologies,
les arts, la philosophie, les coutumes, etc., de civilisations pré-modernes qui leur étaient
incomparablement plus riches.
Leur explication était entravée par une théorie linéaire de l’évolution, qu’Auguste Comte a
exprimé dans le triptyque « théologie, métaphysique, science », avant de se transformer en
une dichotomie « progrès – régression » que plusieurs de nos générations ont subie. Les
“préjugés” et les “prémices” de ces explications sont l’humanisme d’une minorité qui se
caractérise par l’« exclusion » (exclusion de la religion, de la nature, etc.)
Les représentants de la première génération des néo-confucianistes contemporains, Liang
Shuming, Xiong Shili14, s’ils ont reconnu la religion, et notamment la valeur assez élevée de
la Loi bouddhique, ont aussi subi l’influence dominante d’un environnement scientiste. C’est
pourquoi Liang Shuming, tout en reconnaissant que la Loi bouddhique satisfait aux deux
critères de la religion – le mystère et l’extraordinaire -, qu’elle est une vraie religion, pense
aussi que la religion est une direction de l’existence de l’humanité à venir, quoique l’époque
s’efforçait de la rejeter. Liang Shuming soutient que la science et la religion ont une affinité
inexplicable, il s’efforce de discuter les raisons pour lesquelles la culture chinoise n’a ni
science ni démocratie. Xiong Shili s’applique à montrer que le confucianisme n’est pas une
religion, définit avec rigueur la frontière entre science et religion, entre études confucianistes
et études bouddhiques, il critique l’idée que la religion bouddhique s’oppose à la science,
insiste sur le fait que le confucianisme contient la science, la démocratie, etc. Et ce,
probablement, parce que la question qu’ils rencontrent, celle à laquelle ils doivent répondre
est la suivante : ce que les Occidentaux ont de plus précieux, la science et la démocratie, la
culture chinoise et le confucianisme en sont dépourvus.
12 Kang Nanhai ou Kang Youwei (1858-1927) et Chen Huanzhuang (1880-1933) qui ont développé
beaucoup d’efforts pour établir et développer « l’Association de la religion confucéenne »
(Kongjiaohui).
13 Le terme
rujiao
( 儒教)
jusqu’à la
fin du XIXème siècle s’oppose d’abord à
daojiao
(道教),
‘enseignement taoïste’ et
fojiao
(佛教) ‘enseignement bouddhiste’ et signifie ‘enseignement des lettrés’,
c’est-à-dire ‘enseignement confucianiste’. Vers la fin du XIXème siècle, les Chinois ont adopté un
néologisme japonais,
zongjiao
(宗教) mot à mot ‘enseignement du temple des ancêtres’, pour traduire
le mot occidental « religion ».
daojiao
a acquis le sens de ‘religion taoïste’,
fojiao
celui de ‘religion
bouddhiste’ et Kang Youwei a forgé le terme de
kongjiao
(孔教) pour désigner la ‘religion de
Confucius’. A partir des années 1970, dans un contexte où revient la question de savoir si le
confucianisme est une religion, le terme
rujiao
commence à être utilisé dans le sens de ‘religion
confucianiste’.
14 Liang Shuming (1893-1988), Xiong Shili (1885-1968). Deux penseurs qui, dès les années 1920,
sont allés a contre-courant de leur temps en s’efforçant de reformuler la philosophie et la foi
confucianistes.
On trouvera des monographies sur ces deux penseurs et sur les quatre qui sont étudiés dans cet
article dans Umberto Bresciani,
Reinventing Confucianism
, Taipei Ricci Institute for Chinese Studies,
Taipei, Taiwan, 2001.

- 4 / 32 -
La deuxième génération de néo-confucianistes contemporains, Tang Junyi, Mou Zongsan15,
etc., n’ont commencé à affirmer la valeur de la religion qu’à la fin des années 40 - début des
années 50. Après s’être installés à Hong-Kong, ils ont encore mieux réalisé que ce qui est
vraiment le fond de la culture occidentale et ce qu’elle a de plus profond, n’est précisément
rien d’autre que la religion. Tant tout à la fois stimulés par la conscience religieuse
occidentale et la valeur de la religion, s’ancrant dans une obsession à résister à la culture
occidentale et à conserver l’esprit de la culture chinoise, ils ont commencé à connaître, à
exhumer et interpréter à frais nouveaux l’esprit religieux que contient l’école confucianiste et
le confucianisme. Le Manifeste « La Culture chinoise et le Monde »16 de quatre maîtres, Tang
Junyi, Mou Zongsan, Xu Fuguan, Zhang Junmai publié le jour de l’an 1958 est un exemple
d’une approche de la religiosité du confucianisme qui a déjà trouvé sa forme accomplie. Ils
pensent que la Chine n’a rien connu du système occidental, ni Eglise, ni guerres de religion,
ni séparation de la politique d’avec la religion, que le sentiment transcendant à caractère
religieux du peuple chinois ainsi que son esprit religieux sont liés d’une manière inséparable à
la morale éthique à laquelle il est très attaché ainsi qu’à la politique.
La conception du ‘ Ciel ’ de l’antiquité désignait le Souverain suprême doté d’une
personnalité17 ; la foi religieuse des anciens à l’égard du Ciel s’est infiltrée dans la manière
dont les penseurs ultérieurs ont pensé l’homme et a conduit à des conceptions comme : ‘ le
Ciel et l’Homme unissent leurs vertus ’, ‘ le Ciel et l’Homme s’unissent ’, ‘ le Ciel et
l’Homme ne font pas nombre ’, ‘ le Ciel et l’Homme ont même constitution ’. La pensée des
confucianistes d’une interpénétration du Ciel et de l’Homme fait que le Ciel devient intérieur
à l’Homme dans un mouvement de haut en bas et que l’Homme s’élève pour atteindre le Ciel
dans un mouvement de bas en haut. Que le lettré doté de force d’âme se sacrifie pour
pratiquer le ‘sens de l’Humain’, perd sa vie pour la justice18, voilà qui contient une foi
transcendante empreinte de religiosité. L’étude de la Moralité et du Principe’ et l’étude de
l’Esprit19 et de la Nature humaine’ des confucianistes sont des clés pour pénétrer l’intérieur et
l’extérieur de l’homme, ce qui est au-dessus et en dessous, le Ciel et l’Homme.
En un certain sens, le fait que Tang Junyi et Mou Zongsan appellent le confucianisme
‘religion morale’, ‘religion humaniste’ ou ‘religion de la réalisation de la vertu’, montre
pleinement sa caractéristique d’être à la fois transcendant et immanent, sacré et profane. En
15 Tang Junyi (1909-1978) et Mou Zongsan (1909-1995) : voir ci-dessous.
16 Le Manifeste « La Culture chinoise et le monde » de 1958 est notamment une protestation contre
les diverses mésinterprétations occidentales de cette culture, une affirmation qu’elle a une religiosité,
que son joyau est l’interprétation idéaliste du confucianisme (doctrine xin-xing 心性, ‘Esprit-Nature
humaine’) et que les sciences et la démocratie doivent être assimilés par les Chinois.
17 Le texte propose « personal God ». Nous le traduisons par « dieu personnel », mais non sans
réserves. L’expression chinoise (人格神
rengeshen
) doit se comprendre comme « divinité dotée d’une
personnalité », c’est-à-dire réputée pouvant voir, entendre, parler, juger, récompenser et punir, etc.,
une divinité que l’on peut prier, à laquelle on peut demander le salut, ce qui détourne l’homme de
rechercher en lui son accomplissement. Elle peut s’appliquer aussi bien au Ciel chinois de l’Antiquité
qu’au Dieu de la Bible. Nos réserves viennent de ce que l’expression « dieu personnel » a une
signification différente dans la perspective biblique, où le caractère « personnel » de Dieu tient à ce
que la relation entre Dieu et l’homme est concçue d’une manière analogue à celle existant entre des
personnes humaines. Nous évitons aussi l’expression « dieu/divinité anthropomorphe » qui sont des
dieux représentés avec des formes et des mœurs humaines.
18 Mencius VI A 10.
19 « Esprit »
xin
心 désigne à la fois l’esprit et le cœur, l’organe des affects et de l’intellect, sans
distinction d’un siège de la pensée (le cerveau) et d’un siège des émotions et des passions. Voir
A.Cheng,
Histoire ..
p.164. Il sera rendu par ‘Esprit’ ou encore par ‘conscience’ (par exemple
‘conscience de l’humain’, ‘conscience sapientielle’).

- 5 / 32 -
bref, le contexte implicite (ou le sous-entendu) des néo-confucianistes contemporains est le
suivant : ce que l’Occident tient pour plus précieux est la religion et pourtant la Chine n’a pas
de tradition religieuse. Aussi ils s’écartent de l’état d’esprit dominant des Lumières qui
procède par distinction et exclusion pour exhumer les ressources confucianistes en valeurs
spirituelles religieuses, ils analysent les ressemblances et différences entre le confucianisme et
les autres grandes religions mondiales et commencent à s’efforcer de dialoguer avec chacune
des religions.
Les représentants de la troisième génération des néo-confucianistes contemporains, Du
Weiming, Liu Shuxian20, etc. ont un état d’esprit ouvert et tolérant et une compréhension
beaucoup plus complète de la religion occidentale. Sur la base des travaux de Tang Junyi,
Mou Zongsan, Xu Fuguan, ils font leurs les définitions et interprétations nouvelles des
spécialistes occidentaux de l’existentialisme religieux ou d’autres religions ; rencontrant
activement lecteurs et auditoires occidentaux, ils clarifient la valeur et le sens du
confucianisme, ils s’engagent activement dans le dialogue avec le christianisme, le
catholicisme et l’islam. Ils ont fait avancer le recherche sur les questions de la nature de la
divinité et de l’humanité, sur l’esprit moral et l’esprit religieux, sur la préoccupation ultime et
la préoccupation présente, sur la transcendance immanente et la pure transcendance ;
notamment, ils clarifient la particularité du contenu ontologique et de la religion éthique des
idées des Confucéens Song de l’“étude du Corps et de l’Esprit ” de l’idée de “Moi” dans le
processus de la pratique du Moi. Face à deux modèles occidentaux, le modèle scientiste et le
modèle d’un dieu suprême extérieur transcendant, ils répondent d’une manière créative, en
s’efforçant d’échanger avec les théologiens occidentaux et à cette fin ils proposent une
compréhension sapientielle qui lie la Voie du Ciel transcendante extérieure des sources
confucianistes avec la vie profane et la réflexion sur le Moi.
De ce qui est décrit ci-dessus, il n’est pas difficile de réaliser que le choix des valeurs psycho-
spirituelles du confucianisme et leur interprétation à chaque niveau sont étroitement liés au
niveau de la compréhension des valeurs spirituelles occidentales par les herméneutes. La
réaction des néo-confucianistes contemporains de la troisième génération a progressivement
évolué d’une attitude antagoniste à un dialogue dans la compréhension et à des
développements qui autorisent des emprunts. Ils entrent désormais activement dans le
dialogue. Quant à la question de savoir si le confucianisme est ou non la religion
confucianiste, ou encore s’il a une religiosité, c’était au début une attitude de questionnement
venant de la culture occidentale. La deuxième génération des néo-confucianistes
contemporains s’en sont servi pour élucider la particularité de la culture chinoise et de l’esprit
confucianiste --- la question de la ‘ transcendance immanente ’. La troisième génération est
encore plus active. D’une manière générale, les néo-confucianistes contemporains refusent de
transplanter la ‘ transcendance extérieure ’ du monothéisme, mais ils portent une grande
attention aux particularités par lesquelles les Confucianistes manifestent le sacré dans le
monde profane et déploient complètement de nombreuses ressources confucianistes de grande
valeur encore inconnues.
20 Du Weiming (né en 1940), Liu Shuxian (né en 1934).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%