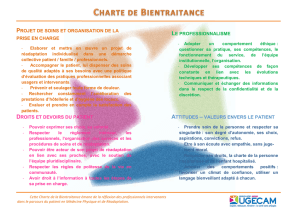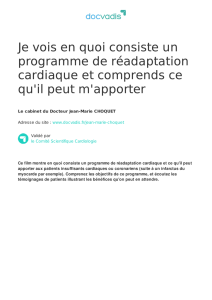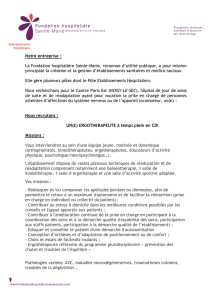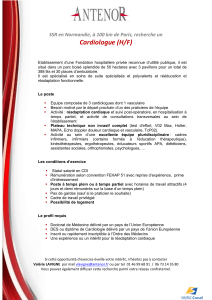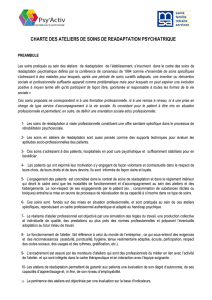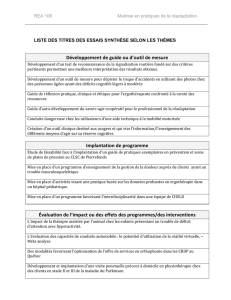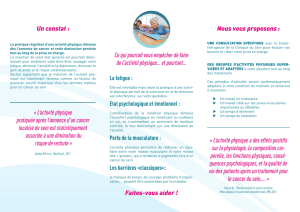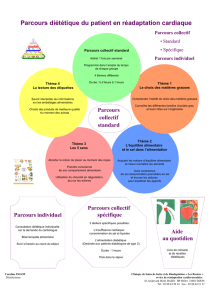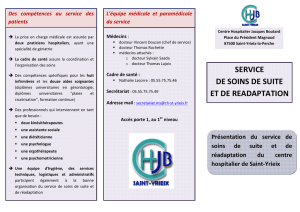gestion_hosp_mars-20.. - Fondation Arc-en-Ciel

Dans la pensée sociologique
La séparation de la science en disciplines distinctes s’ac-
célère au cours de la même période. Le mouvement touche
les sciences humaines, comme si, là aussi, intervenait un
principe d’organisation par segmentation (parcellisation?).
Mars 2005
…
gestions
hospitalières
207
Analyse
organisation du travail
et qualité des soins
Victor SCHWACH
Directeur du centre Bretegnier, Héricourt
Docteur en psychologie, docteur en sociologie
Principes et méthodes
de l’interdisciplinarité en
réadaptation fonctionnelle(1)
L’ interdisciplinarité est un concept à la
fois galvaudé, mal défini et problématique.
Il appartient à un champ sémantique où
les termes foisonnent sans qu’aucun texte
de référence éclaircisse de façon convain-
cante la différence entre «inter », «pluri »
ou «transdisciplinarité ». Le concept, au
départ bien accueilli, devient rapidement
litigieux; loin de recueillir le consensus,
son utilisation révèle que chacun donne au
terme une définition différente, volontiers
intéressée, par exemple en y associant
des attentes à l’égard des autres aux-
quelles ils ne sont pas prêts à souscrire.
Selon ce fonctionnement idéologique,
chacun se décrit comme plus interdisci-
plinaire que les autres, ce qui laisse à pen-
ser qu’un important non-dit vient obscur-
cir cette idée que l’on avait cru lumineuse.
L’auteur apporte ici sa contribution à une
explicitation théorique et pratique.
Mots clés
La division
et la spécialisation du travail
L’organisation du travail dans le système de santé est
héritière de l’histoire et ne saurait être séparée du
contexte de son émergence, à savoir le double mou-
vement intervenu au cours du
XIX
esiècle, la division
du travail et l’évolution médicale.
La division du travail
Machinisme industriel et organisation sociale
Au moment où Marx décrit les effets de la machine
à vapeur et ses conséquences néfastes sur l’emploi
des tisserands, son contemporain Frederick Taylor,
ingénieur autodidacte, pose les bases d’une nouvelle
organisation du travail. Il formalise la méthode fon-
dée sur l’analyse des gestes, le principe du the one
best way et le chronométrage. Quelques expériences
datent de 1880 : une première mise en œuvre indus-
trielle est attribuée à Ford en 1913 pour la fabrica-
tion de la T4 ; elle sera systématisée en 1924 au sein
de la même entreprise. La critique du taylorisme est
connue. Il s’agit néanmoins d’un « progrès » dans la
mesure où il passe des connaissances diffuses et
empiriques détenues par les ouvriers à leur explici-
tation, enregistrement, classement jusqu’à l’énoncé
de lois scientifiques. L’ensemble de cette démarche
conduira à la réussite du projet industriel, dont il
tirera sa légitimité.
L’attention portée à la classe ouvrière laisse dans
l’ombre que ce mode d’organisation a également
concerné la gestion et le travail administratif jusqu’au
contrôle social de l’entreprise. L’organisation scien-
tifique du travail (OST) se traduira par l’apparition de
catégories supplémentaires : les cols blancs, chargés
de l’analyse, du chronométrage…, avec pour effet de
complexifier l’organisation au moment même où s’ap-
pauvrit la tâche de celui qui l’exécute. Retenons que
le principe de la division touche à la fois l’organisa-
tion technique et l’organisation sociale, la production
et la pensée. En définitive, le taylorisme n’est pas que
d’ordre technique, il est également d’ordre psycho-
logique, social, politique et moral.
Hôpital
Organisation du travail
Histoire
Sociologie
Sociologie du travail
Sociologie des
organisations
Pluridisciplinarité
Équipe pluridisciplinaire
Infirmière
Masseur
kinésithérapeute
Personnel paramédical
Réadaptation
Mots clés
note
(1)
Article paru dans la revue
Perspective soignante, n° 20,
septembre 2004, Seli Arslan.

gestions
hospitalières
…
Mars 2005
208
La jeune sociologie accompagne le mouvement et déve-
loppe très tôt une branche consacrée au travail.
Dans sa thèse «De la division du travail social», Durkheim
décrit la société qu’il appelle «organique »: une solida-
rité fondée sur la différenciation des individus par analo-
gie avec les organes de l’être vivant. Remplissant chacun
une fonction et ne se ressemblant pas, ils sont tous indis-
pensables à la vie. Dans sa pensée, la différenciation
sociale est la solution pacifique à la lutte pour la vie: cha-
cun cesse d’être en compétition avec tous
les autres et chacun contribue par un
apport qui lui est propre à la vie de tous. La
différenciation sociale est la condition créa-
trice de la liberté individuelle. La structure
de la société impose à chacun une respon-
sabilité propre. La division implique la com-
plémentarité, voire l’interdépendance.
Depuis Marx est posée la question de la relation entre
la technique et l’organisation sociale. Marx lui-même
apparaît comme modéré ; il propose de distinguer la
machine de son emploi capitalistique ; Aron se pro-
nonce pour la prééminence de l’idéologie dans la for-
mation des structures sociales ; Friedmann professe
l’opinion inverse et condamne cette organisation qui
«donne congé à l’homme ». Ces trois auteurs balisent
l’évaluation du système.
L’hôpital, un système régi
par la division du travail
Le monde hospitalier est traversé par les mêmes lignes
de force, car elles structurent la société tout entière. C’est
la primauté du social, chère à Durkheim.
La médicalisation tardive de l’hôpital
Cette institution est d’abord orientée vers l’accueil des
exclus, des pèlerins, des indigents, des malades, des
infirmes, des orphelins… dans le but de leur apporter le
secours de la religion et d’assurer le salut de leur âme.
Ce n’est qu’accessoirement que la population accueillie
sera logée, nourrie et (modestement) soignée. Dans ce
premier temps qui durera de nombreux siècles, le per-
sonnel est congréganiste (religieuses). Les laïcs sont
absents, de même que les médecins. De toute façon, le
savoir médical était si réduit que cela n’aurait pas changé
fondamentalement le sort de ces malheureux.
La Révolution se confronte au problème de la qualifica-
tion des médecins et cherche à lutter contre le charlata-
nisme des médecins autoproclamés. Après plusieurs ten-
tatives et hésitations, la loi du 19 ventôse an XI vient
mettre de l’ordre dans le système. Elle instaure une hié-
rarchie à deux niveaux, les docteurs en médecine et chi-
rurgie, dont la loi précise la formation, et les officiers de
santé, qui seront autorisés à donner des soins ordinaires
après une formation accélérée de trois ans, qui, au
demeurant, n’est pas obligatoire pour celui qui peut attes-
ter une expérience pratique.
Il faudra attendre le milieu du
XIX
esiècle pour que l’hô-
pital devienne l’un des lieux majeurs de l’exercice de la
médecine et que des infirmières complètent et supplan-
tent les religieuses insuffisantes en nombre. Le savoir
médical se met progressivement en place au cours du
XIX
esiècle avec la méthode anatomo-clinique qui amé-
liore d’abord le diagnostic plutôt que le traitement et les
grandes découvertes de l’ère pasteurienne (bactérie, vac-
cin, hygiène…) qui débouchent sur de nouvelles pra-
tiques et une réorganisation technique, sociale et même
architecturale de l’institution hospitalière.
Ce survol historique atteste que la notion de compétence
médicale est longtemps aléatoire et l’idée même d’une
qualification des personnels impossible jusqu’à une
époque historiquement récente, laquelle coïncide avec l’in-
dustrialisation de l’Europe. Ce rapprochement permet de
saisir comment l’idée de division du travail qui s’impose
dans la société d’alors organisera également l’hôpital.
L’infirmière, premier des nouveaux métiers
La définition du métier d’infirmière au cours de la seconde
moitié du
XIX
esiècle est marquée par la figure de Florence
Nightingale. Sa biographie atteste de la rupture et de la
continuité avec le personnel congréganiste dont elle par-
tage la motivation religieuse. Malgré sa réticence à l’égard
des théories pasteuriennes, elle fait prospérer la propreté
(une valeur anglaise) et l’hygiène de l’air, ce qui a pour
conséquence de faire chuter, à Constantinople, le taux de
mortalité des blessés de la guerre de Crimée soignés dans
le service où elle est affectée; ce résultat spectaculaire lui
vaut de s’imposer aux militaires qui dirigent l’hôpital. De
retour en Angleterre, elle développera la formation des
nurses malgré l’opposition de certains médecins jugeant
cette compétence inutile.
Dans sa conception, l’infirmière doit seconder efficace-
ment le médecin; elle est une auxiliaire médicale (2). Sa
contribution concerne l’idée de compétences nécessaires
à l’exercice de ce métier, lesquelles ne peuvent s’ac-
quérir que par la formation. En conséquence, le métier
acquiert une certaine spécificité, voire une évidente
noblesse. «Une infirmière, disait Florence Nightingale,
ne devrait rien faire d’autre que soigner. Si vous voulez
des femmes de ménage engagez-en. Les soins infirmiers
sont une spécialité.»
Dès la fin du
XIX
esiècle, le mouvement diffuse en Europe,
des écoles sont créées en France. En 1922, le titre d’in-
firmier diplômé de l’État français est créé. Il sanctionne
une formation de deux ans axée sur le soin somatique (3).
Au cours de la première moitié du
XX
esiècle, l’infirmière
reste une auxiliaire médicale, missionnée pour soigner le
notes
(2)
Selon certains
commentateurs, Florence
Nightingale aurait parlé de
«soumission» aux médecins.
(3)
La psychiatrie restera
provisoirement à l’écart
de la recherche de
compétences, se limitant
àrecruter des gardiens,
souvent sans discernement
et sans leur reconnaître
de fonction soignante.
Pour Durkheim,
la différenciation
sociale est la condition
créatrice de la liberté
individuelle.

malade selon les indications du médecin. Ce n’est qu’en
1961 que le programme de formation inclut des connais-
sances sur l’homme sain, permettant l’idée de «globalité
de la personne ». Dans les années 1970 intervient la
notion de «besoins» de la personne. Ce n’est qu’en 1978
que la législation entérine l’idée de rôle propre de l’infir-
mière. Plus tard, la notion de «diagnostic infirmier» vien-
dra confirmer la relative autonomie de l’infirmière par rap-
port au médecin, non sans susciter quelque réticence de
la part de ces derniers.
Le masseur-kinésithérapeute
Cette autre profession émerge elle aussi dans la seconde
moitié du
XIX
esiècle, mais elle mettra plus de temps
pour s’organiser et s’imposer dans sa dimension cor-
porative. L’une de ses origines est la tradition populaire
des manipulations, du rebouteux, du magnétiseur…
Une autre est l’antique gymnastique remise au goût du
jour par l’orthopédie des enfants malades, qui devien-
dra une gymnastique médicale destinée à soigner les
déviations vertébrales et autres difformités grâce à
Napoléon Laisné. La société de kinésithérapie est fon-
dée en 1889. La Première Guerre mondiale donne un
élan supplémentaire insufflé par l’État, qui crée des
centres en vue de la prise en charge des blessés.
Il faut cependant attendre la loi du 30 avril 1946 pour
une organisation et une réglementation du métier. La rela-
tion, voire la subordination, au médecin est manifeste
puisque le texte spécifieque «lorsqu’ils agissent dans un
but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance ». Au
«Conseil supérieur de la kinésithérapie » créé par le
même texte siègent neuf médecins, c’est dire leur rôle
déterminant à la fois dans la formation et la pratique de
la profession. Cette nouvelle profession peut également
être qualifiée d’«auxiliaire médical ».
L’évolution se poursuit là aussi vers une relative autono-
mie. Le décret de 1996 valide la notion de diagnostic en
kinésithérapie, si bien que le médecin se limite à indi-
quer la pathologie du patient confiée au kinésithérapeute
et à fixer l’objectif à atteindre ; celui-ci examine son
patient, réalise des bilans et des évaluations et décide de
la technique mise en œuvre. Néanmoins, à bien des
égards, cette autonomie reste relative.
Généralisation: le foisonnement paramédical
Après guerre, le monde de la santé connaît un déve-
loppement considérable, en termes non seulement de
progrès des techniques, mais également d’éclosion de
métiers nouveaux – psychologues, ergothérapeutes (4),
orthophonistes, etc. – voire de subdivisions ou spé-
cialisations – infirmières de bloc, infirmières en anes-
thésie, etc.
Schématiquement, chacune des professions a traversé
trois étapes:
•l’émergence d’une compétence, donnant naissance au
nouveau métier et à une formation assurée par une
école ad hoc ;
•les décrets professionnels qui entérinent et figent
l’exercice de la profession, désormais confié aux seuls
qualifiés ;
•l’extension récente vers une certaine autonomie des
métiers paramédicaux et l’introduction de la notion
de diagnostic professionnel, qui peut s’interpréter
comme un affaiblissement de la subordination au
médecin : les paramédicaux sont de moins en moins
des auxiliaires médicaux.
Dans le secteur sanitaire, cette organisation n’a pas toujours
été rigide. Il y a quelques décennies, la fonction d’instru-
mentiste de bloc pouvait être tenue par la femme du chi-
rurgien, l’aide-soignante pouvait suppléer à l’absence d’in-
firmière ou de puéricultrice sans que cela choque ni affecte
significativement l’efficacité du système – du moins dans
l’esprit de l’époque. Ce n’est que récemment que le posi-
tionnement est devenu plus rigoureux, voire rigide, délimi-
tant à chacun un rôle propre correspondant à sa formation,
sa compétence et sa rémunération.
Il en résulte que, sous prétexte d’améliorer la compé-
tence des acteurs, l’hôpital s’est organisé sur le modèle
de la division du travail. Comme dans l’industrie, ce
schéma a encore concerné les sphères techniques,
administratives et gestionnaires, et c’est pourquoi l’hô-
pital est devenu un système complexe, morcelé, où
chaque intervenant réalise une tâche parcellaire. Tout
cela illustre les principes de l’analyse de Durkheim : la
différenciation implique la responsabilité de chacun, la
complémentarité et l’interdépendance. Les questions
posées plus haut à propos de l’évaluation restent
valables; doit être particulièrement examinée la critique
de Friedman à propos d’une organisation susceptible
de donner congé à l’homme.
De la pluridisciplinarité
à l’interdisciplinarité en réadaptation
Le modèle pluridisciplinaire de la réadaptation
La réadaptation, une discipline pluridisciplinaire
Comme chaque secteur d’activité, la réadaptation fonc-
tionnelle se singularise par un champ de compétence et
des métiers spécifiques. En l’occurrence sont à identifier
l’émergence d’une spécialité médicale (la médecine phy-
sique) et un métier emblématique de la première période,
celle de la rééducation: les masseurs-kinésithérapeutes(5).
Au fil du temps, la rééducation s’enrichit et évolue en
réadaptation, en s’attachant les compétences d’un
Analyse
organisation du travail
et qualité des soins
Mars 2005
…
gestions
hospitalières
209
notes
(4)
La première école date
de 1955, le diplôme d’État
de 1970.
(5)
Au centre Bretegnier,
ancien hôpital MCO reconverti
en CRF, cette organisation
est flagrante. La reconversion
s’est traduite par l’éviction
des anciens métiers liés
à la chirurgie, l’obstétrique:
sage-femme, chirurgien,
infirmière de bloc,
puéricultrice…, le recalage
des rescapés dans leur rôle
propre et surtout l’apparition
de nouveaux métiers: médecin
spécialisé en médecine
physique et de réadaptation,
kinésithérapeute,
ergothérapeute, etc.

gestions
hospitalières
…
Mars 2005
210
nombre croissant d’autres professionnels: ergothérapeute,
orthophoniste, professeur d’éducation physique et spor-
tive adaptée, psychologue, psychomotricien, neuropsy-
chologue, orthoptiste, assistante sociale, animateur…, jus-
qu’aux bénévoles et, le cas échéant, l’aumônier.
Cet enrichissement est ressenti comme pertinent et utile à
la prise en charge: le patient en situation de handicap acquis
(paraplégie) déprime, il doit accepter la perte irrémédiable
de son autonomie, reconstruire une nouvelle image de soi
et un projet de vie… L’intervention d’un psychologue s’im-
pose. Dans le même temps, le retour à domicile pose pro-
blème, si bien qu’est ressentie la nécessité de faire interve-
nir l’ergothérapeute qui organisera avec l’assistante sociale
les conditions matérielles, sociales et financières de la vie
future: aménagement du logement, ressources, etc.
Analyse spectrale des besoins du patient
Le concept de la réadaptation est, en quelque sorte par
définition, pluridisciplinaire. Il repose sur l’idée générale et
au départ un peu vague de prendre en charge le patient
dans sa globalité; cela amène à identifier chez le patient
des besoins supplémentaires qui conduisent à envisager
comme souhaitable, voire nécessaire, de s’adjoindre des
compétences nouvelles. Au fil du temps se
constitue le «bouquet de ressources», selon
l’heureuse formulation de Hesbeen.
Exemple: Jacqueline est atteinte d’un loc-
ked in syndrom, qui se traduit par le fait de
jouir de sa conscience tout en étant enfer-
mée dans son propre corps dépourvu de
motricité. L’un des objectifs est de renouer
le fil de la communication, puisque cette
personne a perdu sa capacité de parler.
L’ergothérapeute et le kinésithérapeute
recherchent un petit mouvement volontaire qui possède
suffisamment de stabilité pour être utilisable. Le cli-
gnement des yeux habituellement utilisé n’est pas pos-
sible; en revanche, un mouvement de faible amplitude
du doigt est repéré. Le kinésithérapeute s’attache à
rééduquer ce mouvement tandis que l’ergothérapeute
se met en quête d’un dispositif technique permettant
d’utiliser ce geste, lorsqu’il aura été fiabilisé. Il découvre
une synthèse vocale qui fait défiler sur un écran et un
haut-parleur des lettres de l’alphabet jusqu’à ce que le
clic du doigt indique qu’il s’agit de la lettre voulue.
L’orthophoniste intervient ensuite pour l’apprentissage
de cette technique jusqu’à sa maîtrise: les lettres s’as-
semblent en mots qui constituent une phrase. Tout cela
nécessite que les intervenants se concertent, se consul-
tent et agissent de façon coordonnée pour atteindre cet
objectif si difficile car dépassant les compétences de
chacun pris isolément. La première phrase librement
produite par la patiente fut : « Je veux mourir. » Cette
déclaration ouvrira l’espace à d’autres intervenants: psy-
chologue, famille, aumônier…
L’extension des compétences et des métiers permet de
résoudre des problèmes de plus en plus nombreux; le
spectre de la prise en charge s’élargit et vise désormais la
personne toute entière. Cependant, des questions nouvelles
surgissent, par exemple : jusqu’où aller dans l’enrichisse-
ment de la prise en charge? Partant du désir d’améliorer
l’aide au patient, le système peut dériver et devenir totali-
taire: on s’occupera alors d’«améliorer » sa vie privée ou
familiale. Toutefois, dans cet élan, le mouvement est freiné
par la question économique, car les interventions s’ajou-
tant les unes aux autres, le coût de la prise en charge
s’élève rapidement. Les Canadiens ont posé une limite:
ramener le patient dans l’état antérieur, sans chercher à
améliorer cet état. S’il a été renversé par une voiture alors
que sans domicile fixe il déambulait en état d’ivresse, l’on
ne s’occupera ni d’améliorer son insertion sociale, ni de son
alcoolisme. Cette limite paraît sévère; néanmoins, elle rap-
pelle judicieusement que la réadaptation doit rester à sa
place et ne pas se poser comme chargée de la mission
impossible qui consisterait à «tout réparer», ce qui expri-
merait un désir latent de toute-puissance.
La notion d’équipe pluridisciplinaire
L’équipe, une notion ambiguë
L’organisation des soins en centre de réadaptation repose
sur plusieurs pôles : le médical, les soignants et les
réadaptateurs, chacun étant installé dans un espace par-
ticulier. Même si la notion d’équipe est très présente dans
le discours, le concept est ambigu. Il décrit autant
l’équipe professionnelle, par exemple l’équipe des kiné-
sithérapeutes, que le collectif des intervenants de toutes
les disciplines prenant en charge les patients. Ce qui
manque, dans l’organisation traditionnelle, c’est la volonté
de constituer l’équipe rassemblant l’ensemble des inter-
venants et, surtout, le moment concret et symbolique qui
confère à cette équipe une visibilité, une conscience et
une identité. Autrement dit, l’équipe reste virtuelle.
Le schéma du tapis roulant
Ce type d’organisation entérine une segmentation, qui s’ap-
parente à un morcellement de la prise en charge et n’est
pas sans rappeler la division du travail dans le milieu indus-
triel. Chaque intervenant accomplit une parcelle du travail
global selon un modèle séquentiel. Le modèle du tapis rou-
lant décrit de façon sans doute «idéale typique» ou carica-
turale que le patient reste morcelé entre les dimensions
prises en charge par les compétences multiples qui se
relaient. Concrètement, à défaut de tapis, c’est en fauteuil
roulant qu’il se déplace entre les secteurs allant de sa
chambre au plateau technique, de la kiné à l’ergo en pas-
note
(1)
Article paru dans la revue
Perspective soignante, n° 20,
septembre 2004, Seli Arslan.
L’organisation
des soins en centre
de réadaptation
repose sur plusieurs
pôles : le médical,
les soignants
et les réadaptateurs…

sant par la balnéo et la psychologue… Est absent le moment
de la synthèse, de la vision globale, où chacun des actes
pratiqués s’intègre dans une totalité et trouve son sens.
Autrement dit, le patient demeure «objet de soin», confor-
mément à l’organisation sanitaire traditionnelle où le patient
n’est pas sujet, encore moins acteur de sa prise en charge.
L’effet fédérateur du modèle de Wood
Tous ces professionnels ont pourtant un référentiel com-
mun par lequel ils sont amenés à penser leur intervention:
le modèle de Wood, du nom de ce médecin qui organisa
pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la première
classification internationale sur le triptyque: déficience/inca-
pacité/handicap. Ce modèle a eu un succès considérable
et est devenu l’outil de pensée, d’analyse et d’organisation
de l’ensemble des professionnels de la réadaptation.
Pendant longtemps, l’idée même de réunions de syn-
thèse des patients rassemblant l’ensemble des interve-
nants de leur prise en charge est restée une vue de l’es-
prit plus qu’une réalité – comme si chacun pensait savoir
ce qu’il avait à faire et n’avait pas besoin de confronter la
progression de sa partie avec les autres, et surtout pas
besoin d’eux pour savoir ce qu’il avait à faire.
Le rôle central du médecin
Cette organisation corporatiste a conforté le spécialiste
en médecine physique dans sa position de chef d’or-
chestre. Médecin à la formation réellement transdisci-
plinaire, il dispose des compétences permettant de pres-
crire, coordonner, voire d’évaluer, les multiples inter-
ventions. C’est donc logiquement à lui qu’incombe le
pilotage, car lui seul peut – s’il le veut – considérer le
patient dans sa globalité. Ce rôle de pilotage dépasse
ainsi les questions habituelles du pouvoir et de la place
du médecin dans le système sanitaire.
En définitive, malgré d’évidentes lacunes – rétrospective-
ment visibles à la lumière de l’interdisciplinarité –, ce sys-
tème ne fonctionne pas trop mal et donne même d’assez
bons résultats, y compris du point de vue de la satisfac-
tion des patients. Il correspond à une époque et un point
de vue, que l’on peut définir comme un « humanisme
fonctionnaliste». Dans l’histoire de la réadaptation, il s’agit
d’une étape nécessaire correspondant au développement
d’un corpus de savoirs et de savoir-faire. Replacer cette
conception dans son histoire évite de la dénigrer trop rapi-
dement, sans lui rendre justice de ses qualités.
Le modèle interdisciplinaire de La Source
Depuis une décennie, plusieurs contributions sont venues
non pas remettre en question mais ajouter une dimen-
sion nouvelle à la réadaptation. La plus remarquable est
documentée dans les écrits de Walter Hesbeen(6), et les
formations de l’institut La Source qu’il dirige.
Prendre soin: la démarche soignante
Le modèle La Source se fonde sur la distinction séman-
tique entre «les soins» et «prendre soin». «Être soignant
nous apparaît comme l’expression de notre humanité
dans l’humanité, c’est-à-dire le souci de notre présence
au monde en vue de contribuer, modestement, de la
place occupée, à un univers plus soignant, à une atmo-
sphère plus riche et plus répandue. (7) »
Cette compréhension du soin est déclinée
en différentes formes: prendre soin de soi,
prendre soin des autres, prendre soin des
choses et de la technique, prendre soin de
la beauté, prendre soin du débat. Voici une
charte, véritable profession de foi de cette
orientation, qui s’apparente à un huma-
nisme interpersonnel, comme dépassement
de l’humanisme fonctionnel décrit plus haut.
Cette philosophie abstraite se concrétise
dans la démarche soignante : « La
démarche désigne cette capacité de se
mouvoir, de se porter vers autrui en vue de
marcher avec lui. Le fondement même de
la démarche soignante repose sur ces
deux mots: une rencontre et un accompagnement. (8) »
Au centre du modèle est ainsi la question de la rencontre
interpersonnelle faite de simplicité, de dépassement du
savoir, au profit d’une notion de confiance, d’une écoute
personnelle de la souffrance du patient. L’accompagnement
du patient par le soignant se redéfinit en conséquence: «Le
soignant a pour mission de tenter d’aider une personne à
se créer un mode de vie porteur de sens pour elle et com-
patible avec sa situation, et ce quels que soient l’état de son
corps ou la nature de son affection.(9) »
L’équipe soignante interdisciplinaire
Hesbeen note que le travail en équipe n’est pas facile, qu’il
exige une maturité professionnelle importante. C’est pour-
quoi cette notion relève très souvent de la «bienséance rhé-
torique» et cache trop souvent une simple prestation plu-
ridisciplinaire. Le travail en équipe interdisciplinaire est autre
chose. C’est l’application des principes évoqués plus haut,
déclinant l’idée de prendre soin, aux relations en vue d’une
coopération. En effet, seule l’interdisciplinarité permet de
faire face à la complexité des relations humaines «en
dépassant les approches simplificatrices qui morcellent et
où chacun a déterminé son domaine d’intervention».
Étant donné que c’est la recherche d’humanité qui fonde
cette conception, on n’est pas étonné que le souci d’être
à l’écoute concerne certes d’abord le patient, mais
n’ignore pas les soignants et leurs difficultés. C’est là à
la fois l’objet d’une gestion humaine des ressources (plu-
tôt que la gestion des ressources humaines) et l’objet
d’un dialogue au sein de l’équipe.
Analyse
organisation du travail
et qualité des soins
Mars 2005
…
gestions
hospitalières
211
notes
(6) W. Hesbeen
,
La Réadaptation, du concept
au soin, Lamarre, 1994;
W. Hesbeen,
La Réadaptation,
aider à créer de nouveaux
chemins, Seli Arslan, 2001.
(7) W. Hesbeen
,
La Réadaptation, aider
à créer de nouveaux chemins,
op. cit., p. 71.
(8)
Idem, p. 83.
(9)
Idem, p. 85.
L’interdisciplinarité
permet de faire face
à la complexité
des relations
humaines
«en dépassant
les approches
simplificatrices
qui morcellent et
où chacun a déterminé
son domaine
d’intervention ».
 6
6
 7
7
1
/
7
100%