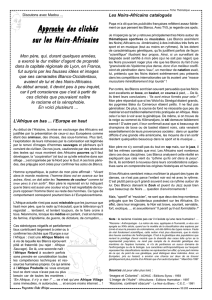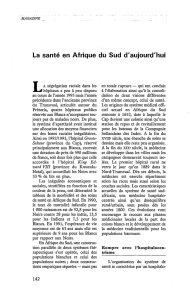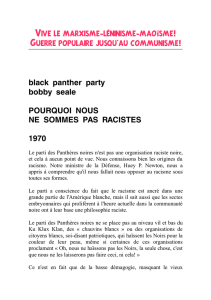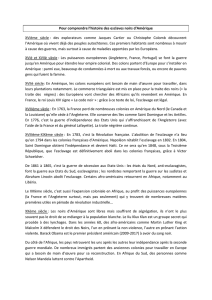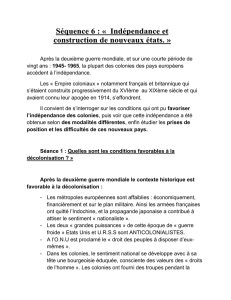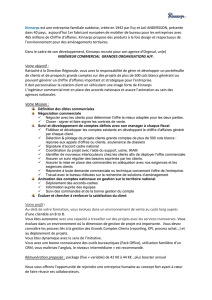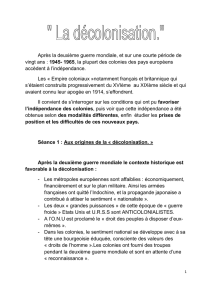« Le Nègre n`est pas. Pas plus que le Blanc » Frantz Fanon, 1952

« Le Nègre n’est pas. Pas plus que le Blanc »
Frantz Fanon, 1952.
Réflexions sur l’expression « racisme anti-Blanc »
Françoise Vergès
Depuis quelques années, des responsables politiques et des d’intellectuels interviennent pour
dénoncer un « racisme anti-Blanc » en France.1 Selon leurs déclarations, il ne ferait pas bon d’y être
« blanc », cette couleur de peau incitant des insultes, des formes d’exclusion et même des coups de
la part de « jeunes » dans certains quartiers. Les anecdotes s’accumulent sur la crainte, la peur, et le
sentiment de ne plus être « chez soi », un « chez soi » menacé par des personnes qui ne
partageraient par « nos valeurs ». Dans cette réorganisation du champ des victimes de
discriminations, les « Blancs » seraient devenus des cibles mais sans recours parce que le racisme
ayant été construit par les « anti-racistes professionnels » comme concernant exclusivement des
personnes non-Blanches, ces nouvelles victimes du racisme ne seraient pas écoutées. D’où des
protestations, des pétitions.2 Au-delà de ces perceptions, le retour dans l’Hexagone d’une taxinomie
qui prit forme dans les colonies est intéressant à plus d’un titre. D’abord, qu’est ce que c’est un
« Blanc » ? Qui est « Blanc » aujourd’hui ? Qu’est ce qui les construit comme « Blancs » ? Qu’est ce
qui se passe à cette particulière conjoncture –processus de décolonisation de la société française,
demandes de plus en plus fortes de réviser l’histoire de la France à l’aune de la longue histoire
coloniale, crise économique, multipolarité du monde, affaiblissement de l’hégémonie politique
occidentale, présence en France de citoyens dont les parents sont venus des anciennes colonies
françaises ou d’autres pays non-européens—pour que cette inquiétude s’exprime ? Qu’est ce qui
s’exprime dans cette construction des « Blancs » comme victimes ?
Nous vivons le temps de la décolonisation de la société française. La longue histoire de la colonisation
(cinq siècles) fait finalement retour. Mais cette décolonisation se heurte à plusieurs obstacles. L’un est
ce que l’historien Todd Shepard a appelé « L’invention de la décolonisation » qui a fait croire à la
société française que l’empire colonial français s’étant évanoui en 1962, elle était définitivement
débarrassée de ses scories, traces, ombres. Shepard a rappelé cependant « l’immense travail de
mobilisation et de construction qui aurait permis « aux Français d’oublier que l’Algérie a fait partie à
part entière de la France à compter de 1830 et d’échapper à la plupart des implications importantes
de ce passé partagé».3 Et comme Shepard le démontre (ainsi que d’autres historiens), la
décolonisation est devenue alors une question française. Pour que cette décolonisation, qui a tout
juste commencé, se poursuive, il faut étudier comment une partie de la société s’est construite comme
« blanche ». J’insiste ici sur le temps long de la construction du « Blanc » pour éviter les facilités qui
en font un phénomène exclusivement lié à l’immigration postcoloniale. La situation actuelle renvoie à
la fois à des formes nouvelles et à des réactivations de clichés, peurs, et fantasmes du moment
colonial, qui toutes deux se traduisent de manière très concrète pour des individus. Ces perceptions
multiples constituent une réalité sociale aux conséquences concrètes qu’il serait ridicule d’ignorer ou
de renvoyer à de la « fausse conscience ». Pour mieux comprendre pourquoi en 2012 des « Blancs »
se vivent comme victimes de racisme alors qu’une étude toute récente de l’INED signale encore une
fois que « l'origine et la couleur de peau sont les principaux facteurs de discrimination déclarés en
France aujourd'hui »,4 il est indéniable qu’il faut intégrer la colonie comme acteur.
1 D'après le sociologue Sylvain Crépon, l'expression de "racisme anti-blanc" « a été conceptualisée en 1978 par François
Duprat, alors l'un des responsables du Front national, juste avant sa mort dans un attentat non expliqué. Il est à l'origine des
principales thématiques du FN qui sont toujours présentes à l'heure actuelle. » Interview avec Sylvain Crépon, Journal du
Dimanche, septembre 2012
2 « Appel contre les ratonnades anti-Blancs » 25 mars 2005. À la suite de cet appel Pascal Bruckner déclarait dans le
Nouvel Observateur (31 mars 2005) qu’il avait déjà dénoncé dans Le Sanglot de l’homme blanc « la culpabilisation de
l’Occident, accusé de tous les maux de la terre parce que lui et lui seul pratique l’autocritique et le repentir. J’y évoquais
déjà, à l’époque, le racisme anti-Blancs dont je demandais qu’il soit dénoncé au même titre que les autres. Je fus, pour cet
essai, mis au ban de la gauche pendant des années, y compris dans ce journal » (Le Nel Obs).
3 Todd Shepard The Invention of Decolonization : The Algerian War and the Remaking of France, Ithaca, Cornell University
Press, 2006, p.2.
4 Yael Brinbaum, Mirna Safi, Patrick Simon « Les discriminations en France : entre perception et expérience » Documents de
1

C’est au moment de la décolonisation que le vocabulaire racialisé qui fabrique le « Blanc » a fortement
fait retour en France. Ce vocabulaire pourtant archaïque et colonial fut invoqué pour appréhender une
situation nouvelle : l’arrivée d’immigrés venus en grande partie des anciennes colonies qui avaient
conquis leur indépendance en attaquant notamment l’idée d’une supériorité blanche. Se sont joués
alors toute une série de phénomènes qu’il faudrait mieux développer : discriminations racialisées
contre les immigrés, perte d’un empire colonial qui avait compté dans l’image que la France s’était
faite d’elle-même…
L’État français ne s’est jamais dit « blanc », mais la société française a été au long de son histoire
moderne pénétrée par un discours racialisé. Blanche, elle l’est devenue, par paliers, par glissements,
et blanches sont devenues la liberté, l’égalité et la fraternité. Il est difficile en quelques pages de
retracer l’histoire de la ligne de couleur dans la société française—j’emprunte l’expression « la ligne
de couleur » à W.E.B. Dubois, je la préfère à « préjugé de couleur », notion française, car elle indique
des pratiques tracées par des frontières entre groupes, frontières qui se configurent et se
reconfigurent à travers l’histoire alors que « préjugé » garde un aspect moral, on se débarrasse d’un
préjugé, et masque des réalités pratiques. Elle n’a pas d’histoire linéaire, elle est constituée de
glissements, de reculs, de réinterprétations mais elle existe, elle « colore » l’histoire nationale. La
couleur « blanche » ne s’est jamais distribuée équitablement, elle a été (et reste) dépendante du
genre et de la classe. Au cours de l’histoire, selon les circonstances, certains groupes ou individus ont
eu accès à ce statut. Ce processus à été décrit dans des études de « Whiteness Studies » qui ont
étudié comment en Australie, aux Etats-Unis, en Nouvelle Zélande…, des Italiens, Irlandais, ou
émigrants des pays de l’est de l’Europe, qui étaient méprisés et racialisés par des « Blancs » (Au
18ème siècle, une Europe « civilisée » se construit autour de la France, de l’Angleterre et de
l’Allemagne excisant de sa cartographie son est (barbare), son sud (arriéré) et même son nord) ont pu
acquérir le statut social et économique de « Blancs » en assimilant les « valeurs racialisées de la
civilisation blanche » tout en se distinguant des Noirs, des Asiatiques, ou des peuples autochtones.5
Nier la racialisation de la société française, ou insister sur le fait que les discriminations auraient aussi
touché des groupes dit « blancs » (émigrés italiens, polonais, espagnols…) contribue à marginaliser le
rôle de la colonie dans la fabrication de l’identité française et l’existence de sa couleur fantasmée6 et
le processus d’assimilation auquel ces groupes durent se plier pour obtenir le statut de « Blanc ». La
solidarité entre opprimés de différentes origines s’est souvent brisée sur l’écueil de ces divisions
racialisées et d’une solidarité trans-classe entre hommes « blancs ». Cela explique aussi pourquoi
reconstruire des solidarités qui dépassaient ces divisions fut toujours au centre des efforts des
mouvements de résistance à des idéologies xénophobes7 ou des mouvements de décolonisation. En
retraçant la longue histoire de la racialisation de la société française, ce n’est donc pas de « favoriser
le communautarisme » qu’il s’agit mais d’analyser quel « Blanc » fut fabriqué, le pourquoi des
occasions perdues et des défaites, comme de comprendre le caractère des conflits que nous
observons aujourd’hui et de s’inspirer des efforts passés pour construire de nouvelles solidarités. Il
faut cependant, et c’est important, souligner que de tout temps, il y eut des écrivains, des artistes, des
philosophes, des activistes, qui défendirent l’unité du genre humain, signalant que les différences de
couleur de peau, de culture, d’organisation sociale, n’entraînaient en rien une hiérarchie, qu’aucun
groupe ne pouvait se dire supérieur à un autre. Cette tradition est essentielle, elle a construit une
bibliothèque des idées où des genres très divers de textes (poésie, philosophie, droit, sciences de la
nature et de la vie) et d’images, qui s’attachent à comprendre comment se fabrique du commun. Mais
cette tradition se heurte à des discours qui se sont répandus dans les sociétés, l’un totalement
constructiviste, l’autre essentialiste, chacun faisant fi de l’évolution, de la psychanalyse, de
travail, N°183, 2012, 33 p
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1613/
5 Le développement des recherches sur ce thème a donné lieu à de nombreux ouvrages où le rôle et la place de l’empire
colonial, de la colonie, est vu comme centraux, sans oublier cependant les configurations d’une ligne de couleur dans les
métropoles coloniales elles-mêmes. Des travaux remarquables sont régulièrement publiés, notamment ceux de Catherine
Hall. Voir à ce sujet deux publications récentes : Marylin Lake et Henry Reynolds, Drawing the Global Colour Line. White
Men’s Countries and the International Challenge of Racial Equality. Cambridge University Press, 2008 et Bill Schwarz, The
White Man’s World, vol. 1, Oxford University Press, 2011. Sur la ligne de couleur, je me permets de renvoyer à mon ouvrage,
L’Homme prédateur. Ce que nous enseigne l’esclavage sur notre temps, Albin Michel, 2011.
6 Je rejoins ici les arguments de Bill Schwartz développés dans l’ouvrage op.cit.
7 Parmi de nombreux exemples, ceux des fraternités pendant la Première guerre mondiale, des mouvements ouvriers
solidaires des colonisés…
2

l’anthropologie, de la psychologie sociale… Dans cette tension entre idéologies où les certitudes
rivalisent avec les fantasmes, et analyses dynamiques qui laissent place à l’étude des processus, du
singulier et de l’universel, le rôle joué par la colonie n’est pas négligeable.
Les historiens ont tendance à dater l’organisation racialisée des sociétés à partir de la colonisation
post-esclavagiste et du développement massif des justifications idéologiques d’une hiérarchie des
races.8 Cette approche de l’histoire en chapitres étanches les uns aux autres nie les traces, les effets
à long terme ou à retard. L’esclavage colonial s’efface alors comme période charnière dans la
fabrication de groupes racialisés. Or, il en fut une matrice. Dès que la France s’est lancée dans la
traite des Noirs puis a développé dans ses colonies un système d’économie esclavagiste où la main
d’œuvre servile devint bientôt exclusivement d’origine africaine, elle a justifié, comme les autres
puissances négrières, cet état de fait avec un discours de racialisation. (Racialisé et racialisation sont
ici compris comme désignant la mise en place d’une ligne de couleur où les non Blancs sont associés
à des qualités négatives et les Blancs à des valeurs positives.) La traite des Noirs et l’esclavage
colonial ont construit une organisation au niveau mondial d’un marché du travail racialisé.
La présence d’une majorité d’esclaves noirs dominée par une minorité de Blancs aux colonies s’est
expliquée à travers un dispositif discursif et juridique où le « Noir » était affublé des qualités physiques
et mentales requises pour le travail servile. La racialisation de la société coloniale et la nécessité
d’établir des règles juridiques d’exception s’inaugurent donc avec la traite négrière et l’esclavage. Le
vocabulaire esclavagiste s’invite dans la société française dès le 18ème siècle (Les dictionnaires de
langue française font des termes, « noir », « nègre » et « esclave » des synonymes). La couleur
« blanche » s’insère dans la société mais comme une matière invisible. C’est l’autre qui est « coloré »,
il y a une « police des Noirs » (pas de « police des Blancs »), des Libres « de couleur » (pas de
« Libres blancs »). Dans l’Hexagone, des lois, des règles, des pratiques, des discours, pénètrent les
consciences et finissent par poser des équivalences entre « blanc » et « civilisé », « blanc » et
« citoyen », « blanc » et « liberté ». Des règles font obstacle au métissage accusé de diluer la couleur,
de produire des confusions (comment reconnaître un « Blanc » ?). La ligne de couleur coloniale
comme marqueur social, culturel et économique gagne peu à peu la société française. Elle s’insinue
au 19ème siècle dans les mouvements ouvriers, socialistes, féministes, et plus tard communistes, (et
encore plus tard écologistes), faisant obstacle à des politiques de solidarité. Si la manière dont furent
traitées par les syndicats les demandes des travailleurs immigrés dans la deuxième moitié du 20ème
siècle est connue, nous aurions tort de penser qu’au 19ème siècle le vocabulaire de la « race » (qui
rejoindra dans la deuxième partie du 19ème siècle un vocabulaire nationaliste territorialisé) n’aurait pas
touché des progressistes.
Cependant, et c’est une singularité, un discours a fini par s‘imposer dans les consciences faisant de la
France un pays qui se présente comme ouvert et accueillant aux « Non-Blancs » tout en mettant en
œuvre des politiques racialisées. Et la France fut à la fois ce pays accueillant pour de nombreux
Africains-Américains et des Africains et un pays qui édictait des lois discriminatoires. L’historien
William B. Cohen a formulé le paradoxe en ces termes : « L’aisance apparente avec laquelle Noirs et
Blancs se mêlaient socialement à Paris donnait l’impression que la société française était égalitaire et
libre de tout racisme. Les Français proclamaient depuis la Révolution des théories égalitaires dont ils
croyaient sincèrement avoir respecté l’esprit dans leur propre comportement. De leur côté, les
étrangers témoins de la façon dont à Paris on acceptait les Noirs dans les années 1920 et dans les
années 1930 corroborèrent l’idée qu’en France les préjugés de couleur n’existaient pas. Il n’en reste
pas moins que les Français n’avaient pratiqué de politique égalitaire ni dans leurs colonies des
Antilles ni, après 1850, dans leurs possessions africaines. Semblables aux autres Européens, ils
avaient entretenu pendant des siècles un jugement défavorable à l’égard des peuples noirs. »9 Cohen
semble ignorer que cette distinction entre métropole, terre d’égalité, et colonie, terre de
discriminations, remonte plus loin et qu’en métropole même, des règles, décrets et pratiques ont été
8 Il est entendu 1- que les races n’ont aucune existence scientifique, 2- qu’utiliser le terme « race » sans poser de préalable
contribue à le fixer comme une entité naturelle. Cependant pour na pas alourdir la lecture, je n’utiliserai pas
systématiquement des « .. » devant les termes « race », blanc, noir et j’utiliserai par convention une majuscule pour Blanc et
Noir quand ces termes désignent des personnes.
9 W. B. Français et Africains. Les Noirs dans le regard des Blancs, 1530-1880, Paris, Gallimard, 1981, p. 395. Comme le fait
remarquer, Elikia Mbokolo, Cohen limite cependant son étude à « la période de l’entre-deux-guerres et s’il ne trouve, pour en
rendre compte, que des arguments d’ordre psychologique ». Voir : Elikia Mbokolo, « Visibilité et invisibilité des élites noires
sur la scène politique française », http://www.udmn.fr/article.php?article_id=16
3

racialisés. Ce paradoxe entre politiques racialisées et perception de soi comme Français donc
étranger au racisme, entre contenu d’un récit national universel et réalités sociales, économiques et
culturelles discriminatoires, a une longue histoire qui, je l’ai dit, s’origine dans l’esclavagisme. La
coupure entre territoire où le racisme n’aurait jamais existé (la métropole) et territoire où il aurait existé
(la colonie) est le résultat d’un effort conscient pour faire de la métropole France, une terre d’égalité,
de liberté et de fraternité qui a besoin pour cela d’externaliser son côté sombre, de le « déporter » aux
colonies. Pour arriver à ce résultat, il faut notamment exclure les Noirs de la métropole. Or, des Noirs
il y en avait, amenés comme esclaves domestiques, ou vivant libres comme artisans, musiciens,
marins. Certes, ils n’étaient que quelques milliers mais déjà ce nombre inquiétait les pouvoirs. La
crainte existait que les esclaves fassent appel au « privilège de la terre de France » édicté en 1315
par Louis X Le Hutin et reconnaissant, au nom du « droit de nature », la « liberté à quiconque foulerait
son sol ». Ce qui signifiait en clair que tout esclave amené en France et échappant à son propriétaire
était en droit libre (plusieurs cas d’esclaves obtenant ainsi leur liberté existent). Un édit de 1716 refusa
alors ce statut aux Noirs venus des colonies : « Les esclaves nègres de l’un ou l’autre sexe, qui seront
conduits en France par leurs maîtres, ou qui y seront envoyés par eux, ne pourront prétendre avoir
acquis la liberté sous prétexte de leur arrivée dans le royaume ». Le premier recensement des Noirs
en France eut alors lieu en 1777 pour mieux les contrôler. Une série de règles et de décrets
régulèrent désormais l’entrée des Noirs en France, une « police des Noirs » fut créée et pour ceux qui
avaient obtenu l’entrée en France, ils avaient interdiction de s’y marier, ils étaient dans l’obligation de
se déclarer à la police…
Sur des terres où les femmes et hommes d’origine africaine réduits en esclavage constituaient la
majorité de la population, où être de couleur noire renvoyait au statut d’esclave, la société coloniale
inventa un vocabulaire racialisé qui indiquait le statut de chacun. Les « naturellement » libres étaient
blancs. Ceux qui avaient échappé à l’esclavage étaient eux, « Libres de couleur ». Cette précision
était nécessaire pour distinguer entre un statut naturellement acquis (Blanc donc libre) et un statut qui
indiquait que la personne avait été esclave avant d’être libre et qu’elle était donc « de couleur ». Puis il
y avait les esclaves naturellement noirs. Le juriste Jean-François Niort parle d’un « système
ségrégationniste (qui) se met donc en place au XVIIIe siècle, sur la base d’un critère de couleur , et
vise à instituer et maintenir une sorte de classe intermédiaire entre le colon blanc et l’esclave.»10 Ce
critère est renforcé par des mesures et des lois restrictives pour les affranchis. Aucun individu de
couleur n’est donc naturellement libre, s’il l’est, sa liberté est toujours fragile, soumise à des
réaménagements et au bon vouloir de celui qui le possédait envers qui il garde des devoirs. C’est
donc une liberté entravée. La couleur de la peau et le nom patronymique (qui lui y est attaché)
deviennent des réalités qui indiquent statut et place dans la société coloniale. Inquiète d’être envahie
par des Noirs qui pourraient passer pour « blancs », la société coloniale esclavagiste invente des
distinctions plus fines pour repérer toute trace de sang noir : chabins, quarterons…, toute une gamme
ségrégationniste émerge.
Les révoltes d’esclaves, leurs demandes, et surtout l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue, la
plus riche de toutes les colonies françaises et même la plus riche de toutes les colonies européennes,
celle qui fournit plus de la moitié du sucre consommé alors en Europe, secouent l’ordre esclavagiste
et racialisé. C’est une insurrection à la fois anti-esclavagiste et anticoloniale, c’est la première de ce
genre, qui inaugure la longue histoire de la décolonisation. Le « Noir » n’est plus seulement un être
qui peut être réduit en esclavage, bête de somme dans la plantation, incapable de comprendre ce
qu’est la liberté, il est devenu dangereux, menaçant, capable de vaincre des armées venues
d’Europe, auréolées de gloire comme l’étaient alors les armées napoléoniennes.
Si les révolutionnaires français réfutent toute distinction de couleur, ils tendent à ignorer le poids et la
matérialité de la ligne de couleur. Ils pensent que l’affirmation du principe d’égalité de tous les
hommes (sic) suffira à briser les obstacles qui s’opposent à ce principe. Certes, un tel principe pose
une « règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur » (Montaigne en 1590- le terme « principe »
vient du latin et signifie étymologiquement «un fondement, une origine », un élément « qui occupe la
première place »). Mais l’application de toute règle d’action ne se fait pas spontanément, elle a besoin
10 Jean-François Niort, « La condition des libres de couleur aux ileŝ du vent (XVIIe-XIXe siècles) : ressources et limites
d’un système ségrégationniste » in Jean-Francoiş Niort (sous la direction) Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe
sous le titre « Les libres de couleur dans la société coloniale, ou la ségrégation à l’œuvre (XVIIe-XIXe siècles) »,BSHG, n°
131, janvier-avril 2002.
4

d’outils, de mise en pratique qui font obstacle et réprime toute violation.
L’empire colonial post-esclavagiste mettra en place de nouvelles normes raciales. Le renouvellement
de pratiques racialisées brutales amènera des auteurs comme James Baldwin, WEB DuBois, ou
Frantz Fanon à revenir sur la fabrication du « Blanc ». Pour DuBois en 1903 que « la découverte de la
couleur blanche (whiteness) est une chose très moderne » et cette découverte que le « monde est
blanc et donc merveilleux » (« by that token wonderful ») était intimement liée à l’histoire de la
modernité.11 En écrivant : « Le Nègre n’est pas. Pas plus que le Blanc », Frantz Fanon soulignait à
son tour la facticité des constructions « Blanc » et « Noir ». Pour Baldwin, c’était un besoin pour les
« Blancs » de créer des « Noirs » afin de préserver une impossible pureté et ce, en rejetant sur les
Noirs ce qu’ils percevaient comme abject en eux.12 Autrement dit, pour tous ces auteurs, pas de
« Blancs » sans « Noir ». Les mouvements de décolonisation, le mouvement des droits civiques, la
rencontre des pays non-alignés à Bandung en 1955, le Congrès des Artistes et Écrivains Noirs à Paris
en 1956, inauguraient pour ces penseurs, un temps nouveau.
Aujourd’hui, le processus de décolonisation a gagné les sociétés qui furent bénéficiaires des empires
coloniaux. Alors, qui sont les « Blancs » d’aujourd’hui ? Avec l’accroissement de la pauvreté et des
inégalités, la nouvelle géopolitique de la violence dans le monde, le renouveau des demandes
d’égalité, la ligne de couleur revient comme frontière. Les demandes pour une plus juste répartition
des richesses bouleverse une géopolitique asymétrique héritée des empires coloniaux. Le nombre
des opprimés s’étend et leur répartition ne situe plus sur un seul axe Nord/Sud compte tenu de
l’émergence de nouveaux riches dans les pays dits « émergents ». Ceux qui se disent victimes d’un
« racisme anti-Blanc » vivent ces mutations comme une menace. Redire qu’il faut continuer à
construire ce qui réunit et donc de déconstruire des idéologies qui jettent les opprimés les uns contre
les autres, masquer la longue histoire d’une racialisation des « non Blancs » par les « Blancs » peut
sembler naïf. Mais justement, ne s’agit-il pas d’aller contre et au-delà d’une fabrication du « Blanc » ?
11 W.E.B. DuBois, « The Souls of White Folk », in Darkwater : Voices from within the Veil. New York : Harcourt Brace &
Howe, 1903, pp.29-30.
12 James Baldwin, Notes of A Native Son ; Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs ; WEB
DuBois,
5
1
/
5
100%