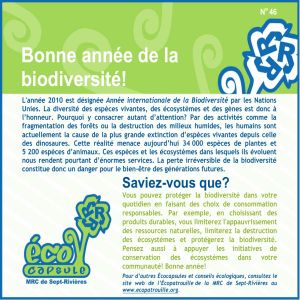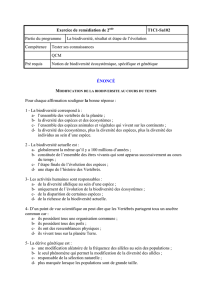La biodiversité

La biodiversité
La protection de la biodiversité est un thème à la mode, qui suscite des interrogations, des
réactions, voire des polémiques, sans que l’on sache très bien de quoi il en retourne. Nous en
verrons tout d’abord une définition souvent admise dans le domaine scientifique, avant d’en
aborder quelques limites et conséquences pour le propriétaire forestier.
Définition
Le terme de biodiversité a été surtout développé depuis 1992. La conférence de Rio1 a
consacré la notion de biodiversité et a alerté l’opinion publique sur la nécessité de la préserver
dans le souci d’un développement durable. Depuis, elle est devenue un enjeu important, y
compris pour la gestion forestière. Celle qui va suivre est une synthèse réalisée par le
groupement d’intérêt public de recherche sur les écosystèmes forestiers.
La biodiversité représente la variété qui existe entre les différentes catégories (ou même à
l’intérieur des catégories) d’organismes vivants présents sur une surface donnée : individus,
populations, communautés. La notion de biodiversité s’applique aussi bien aux espaces
naturels qu’aux espaces modifiés par l’homme. Elle n’a de sens que précisée par rapport à une
surface donnée ; elle peut être appréhendée à toutes les échelles, du micro habitat à celle de la
biosphère. A l’intérieur de la surface considérée, la diversité des catégories biotiques
(individus, populations, communautés ou processus) peut être mesurée, en fonction de la
nature, du nombre et de l’abondance des catégories. Elle peut aussi être mesurée en termes de
diversité génétique. Enfin, cette biodiversité peut varier dans le temps.
Ainsi, nous avons trois principaux groupes de diversité :
-La diversité génétique, à l’échelle d’une population ou d’un ensemble de
populations pour une espèce donnée ; elle est en constante évolution sous
l’action de nombreux mécanismes ;
-La diversité taxinomique, aux niveaux supérieurs de classification (comme le
nombre d’espèces, le nombre de genres, le nombre de familles) ;
-La diversité écosystémique qui considère des catégories qui ont à la fois des
composantes liées au vivant (espèces animales et végétales) ou non (types de
sols, topographie). Parmi les catégories les plus aisées à appréhender ou à
délimiter, nous retiendrons les associations de plantes entre elles, les types de
stations, les types de peuplements forestiers, les types de formes de massifs
1 La Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement s’est tenue à Rio de Janeiro au
Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'Etats et de gouvernements et 178 pays. Environ 2 400
représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) étant présents, tandis que plus de 17 000 personnes
assistaient au Forum des ONG qui se tenait parallèlement au Sommet. Cette conférence a été marquée par
l’adoption d’un texte fondateur de 27 principes, intitulé « Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement » qui précise la notion de développement durable :
La biodiversité – 26/08/2011
1

(massifs compacts, fragmentés, de petite taille ou de grande taille, etc.). On peut
aussi y introduire la diversité structurale (diversité de composition en strates de
différents types de peuplements).
La notion de biodiversité, peut être distinguée en deux composantes :
– l’une, qualifiée de « remarquable », correspondant à des entités (gènes, espèces,
habitats, paysages) identifiées et reconnues comme ayant une valeur intrinsèque et
fondée principalement sur d’autres valeurs qu’économiques ;
– l’autre, qualifiée de « générale » (ou « ordinaire »), n’ayant pas de valeur intrinsèque
identifiée comme telle mais qui, par l’abondance et les multiples interactions entre ses
entités, contribue à des degrés divers au fonctionnement des écosystèmes et à la
production des services qu’y trouvent nos sociétés.
Cette distinction d’entités « remarquables » n’est pas purement biologique : elle combine des
critères écologiques (la rareté ou un rôle fonctionnel déterminant s’il s’agit d’espèces),
sociologiques (le caractère « patrimonial »), économiques (la prédominance des valeurs de
non-usage sur les valeurs d’usage) et aussi juridiques (aires bénéficiant d’un statut de
protection, espèces inscrites sur une liste officielle).
Cette notion de diversité semble familière ; elle est difficile à interpréter en raison de son
caractère multidimensionnel. Cependant, et comme nous venons de le voir, la biodiversité
n’est pas synonyme de rareté ; elle ne se réduit pas à la seule présence d’espèces « phares » ou
« patrimoniales », c’est-à-dire emblématiques d’une région ou menacées. Elle n’est pas
synonyme de naturalité ; réduire le champ de la biodiversité à celui des écosystèmes vierges
relève d’un jugement de valeurs sur l’importance de la naturalité. La biodiversité n’est pas
non plus synonyme de gestion durable, la notion de durabilité dépassant largement celle de
biodiversité ; elle n’est qu’un des aspects de la gestion durable qui sous entend celle de
développement durable. Or, il n’y a pas consensus international sur ce thème..
Les perturbations du milieu, qu’elle soient d’origine naturelle (tempête…) ou humaine
(coupes, travaux sylvicoles, chasse..) conduisent dans nombre de cas à l’ouverture d’un
espace, phénomène nécessaire au développement d’organismes fixés comme les plantes, ou à
la libération des ressources nutritives du milieu abandonnées par leurs consommateurs
disparus et qui peuvent être ainsi réutilisées par de nouveaux individus.
Les connaissances actuelles sur l’évaluation de la biodiversité sont très partielles, et soulèvent
de nombreuses questions, en particulier sur son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes,
et sur la place de l’homme.
Pourquoi la biodiversité est-elle si importante pour la société ?
La biodiversité, fruit d’interrelations du monde vivant
Si les définitions du néologisme « biodiversité » sont nombreuses et variées, l’étendue de sa
signification pour la société est immense. Il s’agit en fait de considérer la « totalité des êtres
vivants en interaction, y compris les micro-organismes et les services rendus par les
écosystèmes ». La biodiversité d’aujourd’hui résulte de milliards d’années d’évolution,
formée par les processus naturels, avec sa dynamique propre imparfaitement connue et
subissant l’influence de l’Homme. La biodiversité et les écosystèmes au sein desquels elle
s’exprime fournissent un grand nombre des biens et services qui soutiennent la vie
humaine : les aliments, les combustibles et les matières premières ; la purification de l’air et
La biodiversité – 26/08/2011
2

de l’eau ; la stabilisation et la modération du climat de la planète ; la modération des
inondations, des sécheresses, des températures extrêmes et des forces éoliennes ; la génération
et le renouvellement de la fertilité des sols ; le maintien des ressources génétiques qui
contribuent à la variété des cultures et à la sélection des animaux, des médicaments, et
d’autres produits ; et des avantages culturels, récréatifs et esthétiques. Cependant, ces services
sont le plus souvent gratuits ou non rémunérés, et se conçoivent dans une logique à moyen
terme qui entre avec des conflits à court terme comme par exemple l’alimentation
quotidienne. D’autre part, le niveau de ces services fait l’objet de discussion : par exemple,
qu’est-ce exactement une sécheresse ? Si cette dernière question paraît évidente dans le désert
saharien, il n’en est pas de même lors d’étés en plus ou moins secs en Europe occidentale.
À l’échelle globale, la biodiversité doit être considérée « dans ses rapports avec les enjeux
majeurs que sont par exemple la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et
l’approvisionnement en eau potable, la croissance économique, les conflits liés à
l’utilisation et à l’appropriation des ressources, la santé humaine, animale et végétale,
l’énergie et l’évolution du climat. Cette vision implique de lier biodiversité et bien-être
humain dans l’esprit de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ».
Ainsi la biodiversité n’est plus uniquement vue – loin s’en faut – à travers le prisme de la
conservation de la nature pour elle-même ou de la sauvegarde de certaines espèces
emblématiques, amis aussi par rapport à des besoins humains, eux-même sous-tendus par des
fonctionnements de civilisation.
La biodiversité, un support à des services écosystémiques
Les services écosystémiques résultent des interactions entre organismes qui façonnent les
milieux et leur fonctionnement au sein des écosystèmes. La purification de l’air ou de l’eau, le
stockage du carbone, la fertilité des sols sont autant de services résultant non d’organismes,
mais d’interactions. À chaque type d’écosystèmes (forêts, zones humides, prairies, coraux,
etc.) correspondent des fonctions et des services différents, eux-mêmes dépendant de la santé
de l’écosystème, des pressions qui s’exercent sur lui mais également de l’usage qu’en font les
sociétés dans un contexte biogéographique et géoéconomique donné. Les sociétés humaines
utilisent les écosystèmes et, de ce fait, les modifient localement et globalement. En retour, ces
sociétés ajustent leurs usages aux modifications qu’elles perçoivent. Cette interaction
dynamique caractérise ce qu’il est convenu d’appeler des socio-écosystèmes
La perception et l’usage des services écosystémiques dépendent largement de l’échelle
considérée. Par exemple, le bénéfice tiré des produits non ligneux d’une forêt, tels que baies
et champignons, relève plutôt d’un intérêt local ou régional, alors que l’importance de la forêt
en tant que puits de carbone relève d’enjeux globaux.
1.1. La biodiversité comme support d’agricultures durables
La biodiversité est à la base de trois niveaux de services pour l’agriculture :
- Les services contribuant directement au revenu agricole tels que rendements,
qualité des produits.
- Les services contribuant au bon fonctionnement des agro-écosystèmes
par :
odes contrôles biologiques (rôle des ennemis naturels des ravageurs, des
pollinisateurs…). Les abeilles et les syrphes constituent des groupes d’insectes
clés pour ce type de services. Le maintien de populations « sources » nécessite
La biodiversité – 26/08/2011
3

en particulier un contexte paysager favorable, alliant l’hétérogénéité des tailles
et de la nature des parcelles et la présence d’habitats semi-naturels ;
ola fourniture de ressources aux plantes (fertilité, stabilité physique du sol),
c’est-à-dire les conditions d’alimentation en eau et en éléments minéraux des
cultures, assurés par la biodiversité de la faune et des microorganismes du sol,
mais aussi par celle de la flore ;
- Les services hors revenu agricole direct : limitation des pollutions des nappes
phréatiques, régulation du climat (stockage du carbone par les prairies par exemple),
façonnement des paysages, supports du tourisme rural.
Une difficulté apparaît tout de suite : la biodiversité dépend des milieux et donc de leur
variation : les actions ne seront donc pas stables dans le temps. Ce qui pose la question des
prix et coûts de la sécurité alimentaire, et donc de définir celle-ci qui n’a pas le même sens
dans les différents pays mondiaux.
La biodiversité comme support d’une nouvelle « biotechnologie »
Quatre axes principaux de valorisation de la biodiversité peuvent être identifiés :
- La biomimétique qui consiste à repérer un comportement remarquable, à
comprendre la relation comportement/structure, à imiter cette structure pour
élaborer des matériaux durables de façon rapide et à moindre coût.
- La bio-inspiration, qui est à un stade industriellement moins avancé, va
essayer d’identifier les molécules qui possèdent certaines propriétés et d’en
obtenir des objets différents de ceux créés par le vivant.
- La valorisation de la biodiversité bactérienne comme substitut ou appui à la
chimie.
- La bioremédiation, ensemble de techniques nouvelles mettant à contribution
des micro-organismes ou des plantes pour dépolluer des sols ou des eaux, qui
s’avère prometteuse sur le plan économique.
De fait, la biodiversité est au cœur des décisions politiques et stratégiques, avec des intérêts
financiers non négligeables…
Quelques conséquences pratiques
Nous évoquerons ici que les pratiques dans la gestion ordinaire, sans aborder celles liées à des
zonages juridiques et réglementaires spéciaux, comme Natura 2000. Nombre d’entre elles
sont pratiquées par des propriétaires en dehors de toute contrainte.
En forêt
La biodiversité implique, entre autres, le maintien de milieux variés qui peut être obtenu en
l’absence d’intervention humaine ; ainsi en est-il avec l’existence d’arbres morts, vieillissants
et avec des cavités, ou grâce à la sylviculture qui conduit à avoir des traitements diversifiés de
lisières tant en bordure de la forêt que des chemins ou des routes, des ouvertures plus ou
moins importantes, la variété des coupes réalisées, le développement d’essences forestières
variées avec leur cortège d’espèces inféodées.
•Les arbres morts, vieillissants et avec des cavités constituent des micro milieux
indispensables à une faune abondante, qui joue un rôle très important pour le contrôle
des prédateurs et l'alimentation en particulier des oiseaux et des chauve - souris.
La biodiversité – 26/08/2011
4

•La présence d’un sous-étage ou de lierre joue un rôle important. Non seulement ils ne
constituent pas de risque pour les arbres, mais ils sont le lieu de vie pour de multiples
auxiliaires comme les oiseaux et les insectes. Ils convient de les laisser pour autant
que faire se peut, hors contraintes de régénération.
•Les zones de transition constituent des milieux riches en espèces.
C’est le cas notamment des bordures de chemins et des routes forestières. Leur
création et leur entretien, très souvent variable en fonction des situations locales, sont
donc une action positive pour la biodiversité.
Il en est de même pour les lisières. Là encore, la variété des situations rencontrées, qui
vont de l’absence d’intervention à des ouvertures volontaires pour avoir des
peuplements résistants mieux au vent, a une influence positive sur la biodiversité.
•Les différentes sylvicultures pratiquées ont pour effet d’augmenter le nombre
d’essences forestières en Limousin, et aussi l’éclairement au sol. De plus, un objectif
de gestion durable peut favoriser le maintien de forêts anciennes qui ont, dans certains
cas, une flore spécifique.
•La mosaïque de gestion, qui résulte de la diversité de comportement des propriétaires
forestiers ainsi que de la grande variété de la structure foncière, augmente aussi le
type de milieux.
Le maintien volontaire de milieux particuliers est possible dans certains cas au travers des
contrats mis en place sur les zones Natura 2000. Ils posent cependant de grandes difficultés
pratiques, les modifications des méthodes de production de bois de façon moins rentable
n’étant pas toujours bien prises en compte, notamment au niveau des compensations
financières, au moment de la rédaction de ce document. De plus, elles n’intègrent que
partiellement l’ensemble des valeurs attribuées à la forêt.
Par ailleurs, il n’y a pas d’action prévue – ou possible ? – pour certains invertébrés qui sont
inféodés à des micro milieux et qui sont mal connus.
Dans les milieux associés à la forêt
Tout massif boisé d’une certaine importance comprend des zones sans arbres. Des
recommandations peuvent y être faites.
Les pelouses sèches et les landes
- Eviter les investissements lorsque ces milieux sont peu productifs (cas des pelouses
sèches et des landes humides).
- Rechercher, si possible par voie contractuelle, des solutions permettant de maintenir
ces milieux ouverts.
- Eviter les travaux de drainage sur les landes humides ou tourbeuses.
Les tourbières et tourbières boisées
- Ne pas planter ces milieux peu productifs.
- Ne pas entreprendre de travaux de drainage.
- Eviter le passage d'engins lourds qui pourraient tasser la tourbe.
- Rechercher des solutions, si possible par voie contractuelle, permettant de maintenir
ces milieux ouverts.
Les mares, étangs forestiers et berges
La biodiversité – 26/08/2011
5
 6
6
1
/
6
100%