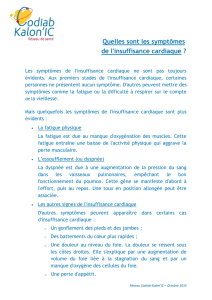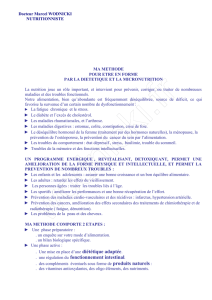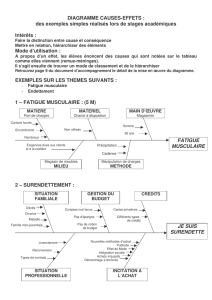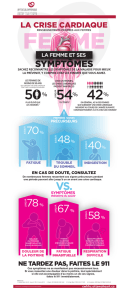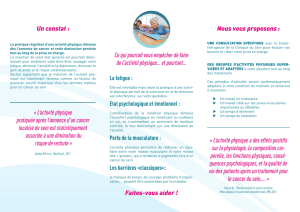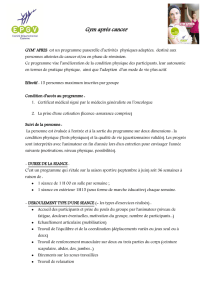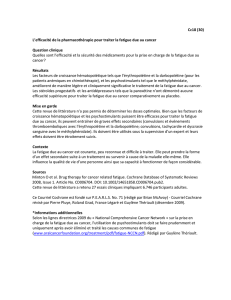Lire l`article complet

L
a neurologie pratiquée au début du XXIesiècle
est une discipline fascinante par l’organe dont
ceptible de recevoir une thrombolyse intravei-
neuse pour un accident ischémique pour réali-
ser que ces hommes et ces femmes combattent
pour l’intégrité de ce qui nous est le plus impor-
tant : le cerveau. Et les résultats sont là : quelle
que soit la pathologie, prévenir ou retarder le
handicap est un gain inestimable en termes de
qualité de vie et de réalisation de soi.
Les infirmières ont un rôle essentiel à jouer.
Infirmière de consultation ou d’hôpital de jour
où sa capacité à gérer des situations de crise
(poussées de SEP, par exemple, au Centre d’in-
vestigation de traitement et d’étude de la SEP, ou
CITESEP) ou à organiser la prise en charge de pa-
tients par différents intervenants est essentielle.
Infirmière de recherche gérant des essais théra-
peutiques. Infirmière en salle en neurovasculaire
ou en neurologie générale capable de gérer des
situations urgentes, de prendre en charge le han-
dicap ou l’inquiétude des proches.
Aujourd’hui, la neurologie est une discipline
dynamique où nous avons besoin d’infirmières
enthousiastes et prêtes à appréhender une disci-
pline de haute technicité.
Venez en neurologie, vous n’y serez pas déçue !
Olivier Heinzlef
Service de neurologie
de l’hôpital Tenon,
CITESEP, Unité neurovasculaire,
rédacteur en chef de la revue
elle s’occupe et par les progrès diagnostiques et
thérapeutiques réalisés au cours des quinze der-
nières années.
•Progrès diagnostiques avec la révolution de
l’imagerie médicale scanner et IRM mais aussi
du fait des progrès de la génétique. Aujourd’hui,
nous pouvons diagnostiquer tôt des maladies
comme la sclérose en plaques, l’accident vascu-
laire cérébral ou les anomalies structurelles à
l’origine des crises d’épilepsie. Poser un dia-
gnostic tôt, c’est aussi se donner les moyens de
mettre en route des traitements précoces. Et, là
encore, que de progrès accomplis avec l’explo-
sion du nombre de molécules dans la plupart
des grandes maladies : la migraine, l’épilepsie,
la sclérose en plaques, le Parkinson, l’Alzheimer,
l’accident vasculaire cérébral.
Il faut avoir assisté à un staff de neurologie au-
jourd’hui pour voir que la majorité des discus-
sions portent sur des aspects thérapeutiques.
•Révolution dans l’accident vasculaire céré-
bral, avec la thrombolyse intraveineuse et intra-
artérielle et la création des unités de soins inten-
sifs neurovasculaires, dont l’activité et l’ambiance
sont similaires à celles des autres unités de soins
intensifs.
Il faut avoir vu, à Tenon, l’énergie, l’enthousiasme
et la rigueur d’une équipe médicale et paramé-
dicale à l’œuvre à l’admission d’un patient sus-
Neurologie
Une discipline
de progrès
17
Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003
Sommaire
Multiples causes
pour soins multiples
• Troubles mnésiques :
une alerte pour les démences
• Les mouvements involontaires :
des symptômes révélateurs
• Radiologie et imagerie médicale :
une aide précieuse
pour le diagnostic
• Sclérose en plaques (SEP) :
mieux connaître les mécanismes
• Maladie de Parkinson :
de nouveau la chirurgie
• Les accidents cérébraux :
toujours une urgence
• La fatigue dans
les affections neurologiques :
un symptôme fréquent
• Traumatisés cérébraux :
rééducation grâce à l’odorat
La neurologie souffre d’une image un peu complexe
auprès du personnel infirmier.
Discipline ésotérique aux termes incompréhensibles,
patients souffrants de maladies rares aux noms
imprononçables et ayant des handicaps importants
rendant le travail difficile, enfin absence
de traitement actif et donc d’amélioration possible.
Mais la réalité est autre...

18 Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003
Neurologie
L
es maladies neurologiques résultent de causes
variées. L’une des causes principales est ce que
L’akinésie est un trouble caractérisé par une
raréfaction des mouvements spontanés du corps
et par une lenteur des mouvements spontanés.
Le patient peut avoir des troubles de la coordi-
nation des mouvements ou subir des mouve-
ments anormaux involontaires (mouvements
choréiques, tremblements rythmés).
Le syndrome pyramidal est toujours lié à un
trouble moteur. Le syndrome extrapyramidal se
retrouve dans une atteinte des noyaux gris cen-
traux (Parkinson), avec akinésie, tremblements,
hypertonie.
Signes liés à la sensibilité
La paresthésie traduit une atteinte des fibres ner-
veuses responsables de la sensibilité (fourmille-
ments, engourdissements...).
La dyskinésie est une impression anormale pro-
voquée par le toucher et représentant une per-
turbation qualitative de la sensation tactile.
Les signes cliniques neurologiques s’accompa-
gnent parfois de douleurs que l’on qualifie de
“spontanées”, “provoquées”, “permanentes”, “in-
termittentes”, “réelles” ou “imaginaires”.
Les troubles d’hypoesthésie sont une diminution
de l’intensité d’une perception.
Enfin, l’anesthésie est une suspension plus ou
moins complète de la sensibilité générale ou par-
tielle, qui peut être provoquée par un agent anes-
thésiant mais aussi survenir au cours d’affections
neurologiques.
Atteinte des fonctions supérieures
Les troubles du langage se signalent par une
aphasie (trouble ou perte de l’expression et de la
compréhension du langage acquis), une dysar-
l’on nomme les “maladies dégénératives” : les cel-
lules nerveuses perdent progressivement leur fonc-
tionnalité ou meurent prématurément (Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale
amyotrophique, etc.). L’autre cause importante de
maladies neurologiques concerne les troubles vas-
culaires. Ces derniers sont des lésions liées à une
perte transitoire ou définitive de la vascularisa-
tion d’une partie du cerveau. Des tumeurs peuvent
également entraîner des troubles neurologiques,
de même que les atteintes toxiques (oxydes de
carbone mais aussi alcoolisme, toxicomanie...).
Signes cliniques
Les maladies nerveuses sont diagnostiquées à
partir de certains signes liés, notamment, à la
motricité ou à la sensibilité.
Signes liés à la motricité
Le déficit de la force musculaire se signale par une
paralysie (perte passagère ou définitive de la fonc-
tion motrice d’un muscle, d’un groupe mus-
culaire, ou d’une partie du corps) ou une parésie
(paralysie légère ou incomplète se traduisant par
une diminution de la force musculaire).
Parmi les paralysies, on distingue, selon leurs
topographies : l’hémiplégie, la monoplégie, la
paraplégie, la tétraplégie. La paralysie tronculaire
est celle d’un tronc nerveux, la paralysie radi-
culaire celle d’une racine nerveuse, la paralysie
plexique celle d’un plexus.
Le tonus musculaire peut subir des modifications
telles que l’hypotonie ou l’hypertonie.
Système nerveux
Multiples causes
pour soins multiples
Le système nerveux a pour champ d’intervention
de nombreuses spécialités médicales. On distingue
aujourd’hui ce qui est du domaine des fonctions
psychiques et qui relève de la psychiatrie, de ce qui
concerne les lésions identifiables et localisables
des cellules nerveuses, qui sont du domaine
de la neurologie. La discipline est plurielle.

19
Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003
thrie (difficulté de l’élocution), une dysphonie
(anomalie de la qualité de la voix).
Les apraxies sont des troubles de la réalisation de
gestes indépendants de toute atteinte des fonc-
tions motrices et sensitives et de tout trouble de
la compréhension.
Les agnosies (auditive, tactile, visuelle) sont l’in-
capacité de reconnaître les objets indépendam-
ment de tout déficit sensoriel.
Les amnésies sont des troubles de la mémoire :
une perte totale ou partielle de la capacité de mé-
moriser l’information et/ou de se rappeler l’in-
formation mise en mémoire. La désorientation
spatiotemporelle est une perte du sens de l’orien-
tation dans le temps et/ou l’espace. Elle résulte
d’un bouleversement des perceptions mentales
qui permettent à une personne de se repérer dans
une situation donnée.
Surveillance de l’état du patient
L’“obnubilation” est un état voisin de celui d’un
sujet en train de s’endormir qui peut être réveillé
transitoirement ou incomplètement par des sti-
mulations auditives ou nociceptives. Quelques
réponses verbales rares ou imprécises peuvent
être faites par le patient.
Quand le patient est en état de “stupeur”, les ré-
ponses verbales sont imprécises. On peut obte-
nir l’exécution de quelques ordres simples.
Quant au “coma”, c’est la perte des fonctions de
la vie de relation et la conservation partielle de la
vie végétative. Les troubles respiratoires vont
mettre en jeu le pronostic vital. Il faut surveiller
les réflexes photomoteurs (anisocorie) et regar-
der comment le patient répond aux stimulations
sensitives et verbales.
Andrée-Lucie Pissondes
Troubles mnésiques
Une alerte pour les démences
Les démences se caractérisent par un affaiblissement progressif de l’ensemble des
fonctions intellectuelles. Cela est dû à une probable lésion des cellules nerveuses
cérébrales. On distingue deux catégories de démences : les démences symptomatiques
et les démences dégénératives. Avec une diminution de l’attention, du jugement, du
raisonnement, les troubles mnésiques sont les plus observés.
L
es démences symptomatiques sont le plus sou-
vent liées à la répétition d’accidents vasculaires
cérébraux mais elles peuvent également être
consécutives à une autre maladie neurologique,
une maladie hormonale, une intoxication ou une
infection. Les démences dégénératives sont re-
présentées par la maladie d’Alzheimer (avec atro-
phie cérébrale à prédominance postérieure), la
maladie de Pick (où l’atrophie prédomine dans les
lésions frontales), et les démences séniles.
Maladie d’Alzheimer
En France, plus de 700 000 personnes sont ac-
tuellement atteintes de démences. Parmi elles,
450 000 souffrent de la maladie d’Alzheimer. Si
les mécanismes de l’affection sont de mieux en
mieux connus, les causes restent à élucider et les
traitements étiologiques et non symptomatiques
à développer.
A partir de 65 ans, 1 à 2 % de la population sont
atteints de la maladie d’Alzheimer. Cette popu-
lation passe de 25 à 40 % après 90 ans.
©Voisin/Phanie.
●●●

20 Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003
●●●
Neurologie
Les lésions qui touchent le système nerveux cen-
tral sont physiologiques et liées au vieillissement.
Dans cette forme de démence, leur apparition
est précoce, leur développement accéléré.
Dans la forme familiale de la maladie, des muta-
tions sur une protéine précurseur du peptide bêta-
amyloïde ont été retrouvées. A partir de modèles
animaux, la connaissance de la maladie a pro-
gressé avec, cependant, ses limites : l’évolution de
la maladie sur plusieurs dizaines d’années restreint
en effet l’emploi d’animaux de laboratoire à durée
de vie plus courte que l’espèce humaine.
Le principe du traitement repose sur le blocage
des enzymes bêta et gamma-sécrétases, respon-
sables de la formation du peptide A bêta-amy-
loïde. Inflammatoires, les maladies neurodégé-
nératives profitent de la prescription d’AINS.
Ceux-ci entraînent en effet un retard d’apparition
de la maladie. Le même bénéfice est retrouvé
avec l’emploi régulier, au long cours, des statines.
Il est ainsi possible de “gagner” plusieurs années,
ce qui représente un bénéfice financier et surtout
humain, non négligeable.
Démence vasculaire
En dehors de la maladie d’Alzheimer, principale
cause de démence, la deuxième en termes de fré-
quence est la démence vasculaire. En faire le dia-
gnostic assez précocement est essentiel, car il
permet de déclencher un traitement qui, contrai-
rement aux autres démences, peut être efficace.
Le premier signe qui doit intriguer le praticien
est l’absence de reconnaissance des faits par le
patient lui-même : c’est la famille qui, s’étant
rendu compte de ses anomalies comportemen-
tales, accompagne le malade et en parle.
En effet, contrairement à la maladie d’Alzheimer,
les troubles mnésiques sont ici souvent au se-
cond plan, eu égard à l’atteinte primordiale des
fonctions instrumentales.
L’aphasie porte sur la compréhension comme sur
l’expression verbale. Des difficultés existent éga-
lement pour la réalisation de tâches simples : sai-
sir un objet, ramasser une feuille tombée par
terre. C’est l’apraxie. Parfois, au premier plan,
c’est la désorientation temporospatiale : perdu, le
patient peut aussi bien fuguer qu’inverser son
cycle nycthéméral. Quelquefois, enfin, c’est son
comportement dans son ensemble qui est per-
turbé, avec une agitation extrême ou, au
contraire, un complet abattement. Des halluci-
nations sont aussi possibles sous la forme de
bouffées délirantes permanentes ou ponctuelles.
Ce qui doit alerter, c’est en général l’ordre d’ap-
parition des troubles réalisant souvent un esca- ●●●
Trouble de la mémoire :
pas toujours une démence
Tout trouble mnésique ne signifie pas maladie
d’Alzheimer. Une forme peu connue de troubles
mnésiques des seniors est l’atteinte liée à des irré-
gularités du métabolisme glucidique. On sait ainsi
que plus de 25 % des plus de 65 ans ont des ano-
malies glycémiques. Ces anomalies sont suscep-
tibles d’entraîner chez elles des troubles mnésiques.
Quel est le mécanisme ? L’hippocampe est la zone
du cerveau qui subit les plus grosses variations
anatomiques (augmentation de volume), cela, pa-
rallèlement aux variations de la glycémie. L’hippo-
campe est aussi la région la plus active lors des tests
mnésiques. C’est enfin la région qui souffre le plus
d’une hypoxie comme d’une hypoglycémie. Une
hypoglycémie peut donc, au cours d’un désordre
glycémique non équilibré, être la cause d’un
trouble mnésique, d’où l’intérêt de bien contrôler
la glycémie des seniors, leur mémoire ne pouvant
que mieux s’en porter.
Arbre décisionnel
Tr oubles mnésiques +troubles instrumentaux
Syndrome démentiel +pathologie vasculaire
Démence vasculaire
Recherche de facteurs de risque Recherche de signes radiologiques
Tr aitement de la cause

22
lier : premiers troubles, stabilisation de l’état,
apparition d’un nouveau trouble, nouvelle stabi-
lisation, et ainsi de suite.
L’examen clinique peut retrouver des séquelles
vasculaires telles qu’une hémiparésie, un déficit
sensitif ou moteur d’une partie du corps, d’une
partie du visage. Une amputation du champ vi-
suel est aussi possible, comme l’est également un
syndrome pseudobulbaire. C’est alors l’imagerie
médicale qui permet de trancher : l’IRM ou le
scanner peuvent mettre en évidence des sé-
quelles d’infarctus cérébraux, d’hématomes, de
lacunes.
Le traitement de la démence vasculaire est essen-
tiellement préventif, il convient donc de retrouver
la cause de l’atteinte cérébrale pour la combattre,
mieux pour en prévenir les complications.
Ainsi, l’ECG et l’échographie détectent une ma-
ladie cardiaque qui a pu, jusqu’alors, passer in-
aperçue. Le holter ECG décèle des troubles du
rythme intermittents. Le Doppler renseigne sur
la circulation extracrânienne responsable de pa-
thologies intracrâniennes. Toute image suspecte
doit être précisée par une angiographie. Le trai-
tement étiologique sera instauré en fonction de
la pathologie retrouvée.
La prévention d’infarctus cérébraux conduit à la
prescription d’anticoagulants de même que
l’existence de signes d’une embolie d’origine car-
diaque ou de troubles du rythme. La prescription
établie, une surveillance attentive par l’équipe
médicale et par l’entourage est constante du
fait de l’existence de la démence, c’est pourquoi
les antiagrégants plaquettaires, voire l’aspirine,
plus simple d’utilisation, seront parfois préférés.
Lorsque le trouble du comportement est trop im-
portant, la prescription de neuroleptiques s’avère
souvent indispensable. Les psychotropes et les
Professions Santé Infirmier Infirmière - No46 - mai 2003
●●●
Neurologie
Communication pratique
Pour commencer une communication, il convient
de créer un climat, une atmosphère, en un mot
de prendre son temps. Ensuite, il faut mettre en
confiance le patient qui est dans un lieu inconnu,
et essayer de capter son attention, son regard.
Lorsque la communication débute, ne jamais lui
demander ce qu’il ne peut faire : c’est inutilement
anxiogène pour tout le monde.
En parlant, il faut accompagner les paroles de
gestes, d’effleurements, de touchers qui appuie-
ront le sens des mots et aideront à les faire passer.
Lorsque la tension monte, qu’une agressivité ou
un hyperactivisme apparaissent, il faut solliciter la
mémoire ancienne, qui est intacte.
Enfin, il est essentiel de toujours essayer de com-
prendre ce qui se cache derrière une attitude ou
un changement de comportement.
Avec ces quelques précautions, la communication
avec le patient dément ne sera jamais coupée.
Toujours possible, elle aura alors un rôle théra-
peutique valorisant le malade à ses propres yeux
et à ceux des siens, et facilitant même le travail
des soignants.
Migraines et céphalées
La migraine est une céphalée évoluant par crises
récurrentes et dont il existe deux variétés princi-
pales : la migraine sans aura (MSA) et la migraine
avec aura (MA), dans laquelle la céphalée est pré-
cédée ou accompagnée de symptômes neurolo-
giques transitoires. Il s’agit d’une affection multi-
factorielle résultant d’interactions entre facteurs
génétiques et facteurs environnementaux. La
composante génétique est plus importante dans
la MA que dans la MSA.
On estime à 5 millions le nombre de migraineux
en France. Environ 10 % d’entre eux ne se soi-
gnent pas du tout, et 50 % se soignent seuls, par
automédication. Les autres passent de médecin
en médecin, parce qu’ils se sentent à chaque fois
mal écoutés ou mal compris.
Des traitements permettent de “gérer“ la majo-
rité des migraineux, mais la prise en charge n’est
pas toujours facile, la stratégie devant être adap-
tée à la fréquence et aux facteurs déclenchants
des crises.
Pour être caractérisée MSA, cinq crises de cépha-
lées durant de 4 à 72 heures (sans traitement) doi-
vent être constatées. Le début est volontiers mati-
nal, voire nocturne. La douleur est pulsatile,
unilatérale, aggravée par les mouvements. Des
nausées et/ou des vomissements sont constatés ,de
même qu’une photophobie et une phonophobie.
Pour les MA, les symptômes sont totalement ré-
versibles, leur durée n’excède pas 60 minutes et
une céphalée doit suivre, être contemporaine, voire
précéder l’aura. Chez le migraineux âgé, l’aura
peut apparaître de façon isolée, c’est-à-dire sans
céphalées. Les divers signes associés sont ophtal-
miques, une paresthésie et/ou un engourdissement
unilatéral, une faiblesse/paralysie partielle unilaté-
rale, une aphasie ou des difficultés de parole in-
classables, un malaise, des vertiges, etc.
Quant à la migraine hémiplégique familiale
(MHF), elle est la seule variété monogénique,
autosomique dominante de MA.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%