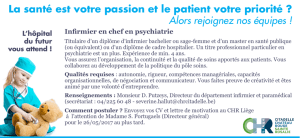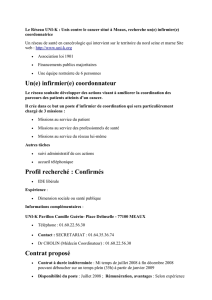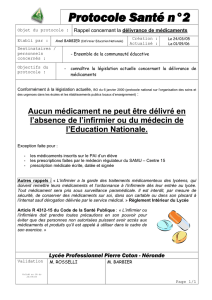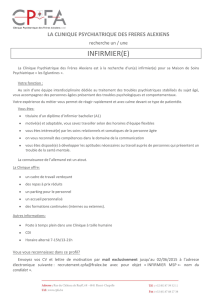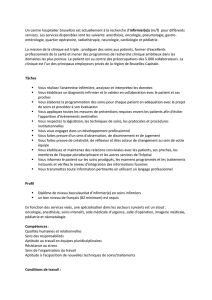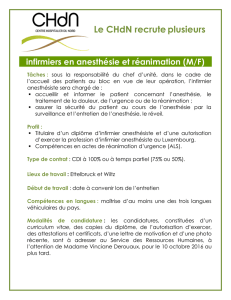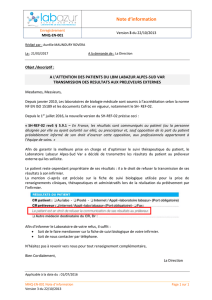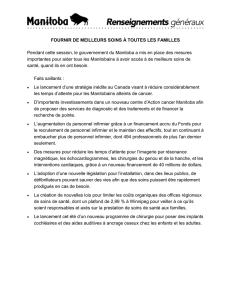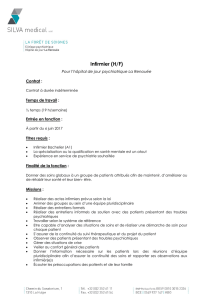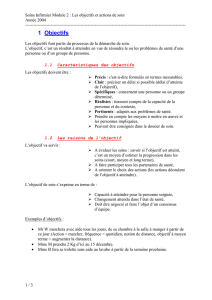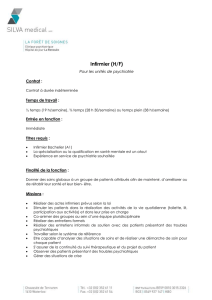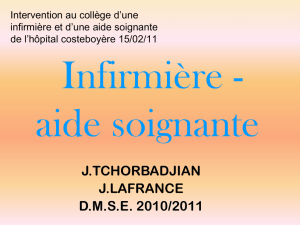Spécificité de l`infirmier(e) de réanimation oncologique

25
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.1-n°2-Avril-Mai-Juin 2001
Pratique infirmière
MARIE PIERRE MARTINEZ,
cadre infirmier, Centre Oscar-Lambret, Lille
et l’équipe :
V. BAERT,
C. BRELOT,
S. DECAUSSIN,
E. DEHEEGHER,
H. DEHEULE,
N. DELEMAZURE,
I. DESMET,
V. LOVERGINE,
A.S. VANVLASSENBROECK,
M. VITSE
On peut parler de professionnalisme lorsque l’in-
firmier répond de façon adéquate aux
demandes et aux besoins des patients. Pour
mettre en lumière les spécificités de l’infirmier en réani-
mation oncologique, il convient tout d’abord d’essayer
de présenter le patient en réanimation oncologique.
Un patient de réanimation
Le malade de réanimation se présente dans un
contexte de détresse vitale, il est accueilli pour :
-surveillance ou prise en charge après avoir subi une
chirurgie complexe, lourde et longue, ou effectuée en
urgence ;
-surveillance des complications aiguës dues à la
maladie cancéreuse ou au traitement : insuffisance res-
piratoire, choc infectieux ;
-surveillance des risques d’aggravation de patholo-
gies associées : cardiaque, rénale, etc.
Le patient et sa famille doivent donc faire face à
un pronostic vital à court terme. Ils vivent un choc
psychologique et sont accueillis dans une structure
vécue comme créatrice d’angoisse, de par son archi-
tecture particulière et le nombre important de ses
appareils.
Pour la famille, il est traumatisant de voir le proche
parfois sédaté et difficile à reconnaître, qui survit grâce
à des tuyaux. Le malade ressent souvent une perte d’es-
time de soi et une profonde altération de son image cor-
porelle devant ce corps sur lequel il n’est plus possible
de compter. La multiplication des actes techniques et
invasifs est perçue comme autant d’agressions physiques
et psychologiques.
La fatigue éprouvée, la douleur, les deuils vécus par
rapport à la perte d’autonomie respiratoire, nutrition-
nelle, motrice, verbale, provoquent une souffrance pro-
fonde.
Cette détresse est également alimentée par le fait que
la mort peut être proche. Or, à un moment où le besoin
de regroupement affectif, familial et social est le plus
aigu, le patient peut éprouver un sentiment d’abandon.
En effet, ce type de structure ne permet pas au proche
de dormir à son côté, les visites s’effectuent en nombre
restreint, ce qui entraîne une rupture certaine avec l’en-
tourage familial et social. S’ajoute à ces ressentis néga-
tifs nourris par le fait d’être dans un service “ à part ” à
cause d’un pronostic vital à court terme, l’angoisse du
pronostic vital à long terme dû à la maladie cancéreuse.
Un patient atteint du cancer
L’angoisse de mort qui suit l’annonce du diagnostic
de cancer prend toute son importance pendant cette
épreuve. En tant que personne atteinte de cancer, le
Spécificité
de l’infirmier(e)
de réanimation
oncologique
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

26
Bulletin Infirmier du Cancer Vol.1-n°2-Avril-Mai-Juin 2001
Pratique infirmière
patient a déjà dû faire face, avec sa famille, aux repré-
sentations de cette maladie. Il a souvent déjà subi des
traitements contraignants et pénibles. Il arrive dans ce
service avec un passé d’expériences douloureuses phy-
siquement et moralement.
Le nom de « réanimation » évoque une épreuve tran-
sitoire, mais sa présence dans cette structure implique
soit une récidive métastatique, soit une complication.
Une mutilation supplémentaire rend encore plus diffi-
cile la projection vers une suite “ bonne ”.
Le patient accueilli dans un service de réanimation
oncologique doit donc faire face à un pronostic vital à
court terme. Il présente un passé de patient et une dif-
ficulté à se projeter dans l’avenir, ce qui rend le présent
difficile à vivre.
Il est possible maintenant de présenter et de décrire
le travail infirmier.
Infirmier(e) en unité
de réanimation
Il est bien entendu que les gestes techniques et la
surveillance doivent être, comme dans tout service de
réanimation, connus, rapides et précis. Dans ce type de
service réputé “ fermé ” et où le patient est en situation
critique, ce qui engendre stress et angoisse, la notion
d’accueil de la part du personnel prend tout son sens.
L’accueil, l’écoute et l’échange sont indissociables du
processus de soin.
Une connaissance optimale du patient est un gage
d’efficacité. Il est donc nécessaire de mettre en place un
recueil de données le plus exhaustif possible. Une orga-
nisation sectorisée permet aux infirmier(e)s d’appré-
hender le malade dans sa globalité. Le temps passé
auprès de lui permet d’établir une relation de confiance
et induit une meilleure compréhension de ses besoins,
de ses attentes, de ses rythmes.
L’infirmier(e), en prenant en charge le patient dans
sa globalité ne produit pas d’actes mais effectue des soins
personnalisés. Le terme “ prendre soin de ” prend alors
tout son sens et le patient, replacé au centre, retrouve
son humanité dans ce service hyper-technique.
Il faut remarquer que cette attitude vaut aussi pour
la famille qui reconnaît dans le personnel infirmier un
interlocuteur privilégié capable de lui donner des infor-
mations. En effet, l’échange avec les proches permet de
mieux connaître le patient et, lorsque celui-ci ne peut
communiquer, leur aide est primordiale.
L’infirmier doit donc posséder de réelles qualités
d’empathie. En effet, devant cette personne en souf-
france, il ne peut se présenter uniquement comme tech-
nicien. Comme tout infirmier travaillant en structure
d’oncologie, il doit être une oreille, un bras, une épaule.
Infirmier(e) de réanimation
en oncologie
On peut affirmer que c’est dans ces structures fer-
mées, où l’idée de mort est souvent présente, que la rela-
tion entre l’infirmier, le patient et la famille se présente
comme importante et évidente.
C’est grâce aux qualités humaines de l’infirmier, grâce
à la relation qu’il met en place avec le malade que celui-
ci pourra accepter les soins agressifs. C’est grâce à une
information adaptée, que l’angoisse ressentie par les deuils
successifs et la difficulté d’entrevoir l’avenir sera atténuée.
L’infirmier(e) représente l’aspect humain, il recrée
l’équilibre entre l’humain et la technique. Il joue égale-
ment le rôle d’intermédiaire entre le malade et ses
proches et les différents acteurs intervenant dans le ser-
vice, médecins, psychologue, diététicienne, kinésithé-
rapeute, stomatothérapeute. C’est souvent lui qui iden-
tifie les besoins permettant une meilleur réinsertion : il
est souvent la parole du patient et de la famille.
Afin d’assurer une parfaite continuité des soins, il
faut souligner que l’équipe doit avoir une représenta-
tion identique du sens du soin : comprendre qu’a existé
un passé avant le service de réanimation et le prendre
en considération, que seule une prise en charge globale
permettra au patient d’arriver dans un service de soins
de suite en toute confiance pour continuer sa route.
En conclusion, l’infirmier(e) de réanimation onco-
logique doit posséder des compétences techniques, mais
là ne s’arrête pas son rôle. Il doit accompagner en toute
humanité un patient en souffrance, qui présente une
situation critique à court et à long terme.
Sa capacité à prendre en charge le patient commence
dès l’accueil. Ensuite, il se pose comme interlocuteur pri-
vilégié entre le malade, la famille, les professionnels médi-
caux et paramédicaux afin de prévoir l’avenir du patient.
C’est grâce à cette rencontre quotidienne, englobant
passé et avenir, par sa disponibilité, par l’écoute et
l’échange que l’infirmier fait émerger le fait que, dans
ce service hyper-technique angoissant et déshumani-
sant, “ il est encore possible ” comme le dit Jean Bernard,
“de ne pas donner des jours à la vie mais de la vie aux
jours ”. ■
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
1
/
2
100%