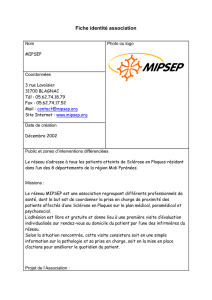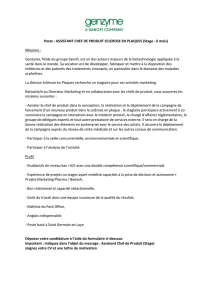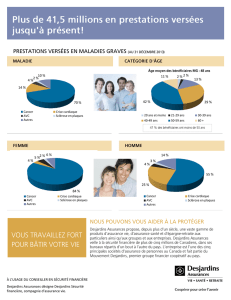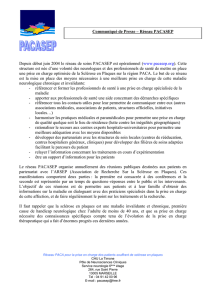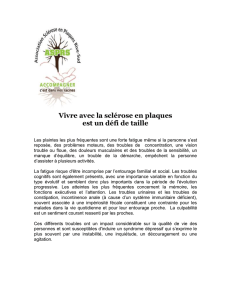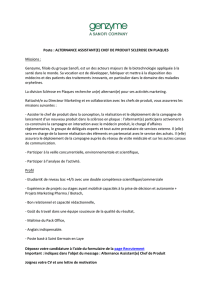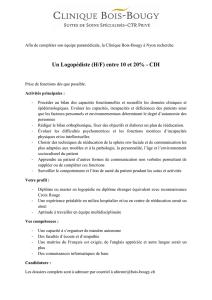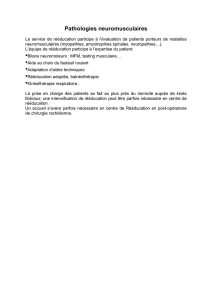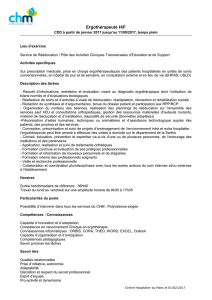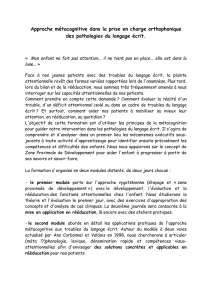Brochure sur la rééducation

Vous avez
une sclérose
en plaque
s
1
Ont participé à la rédaction de ce recueil :
Sylvie CANTALLOUBE,
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation.
Cédric FOREST,
Ergothérapeute.
Laurence MAILHAN,
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation.
Isabelle MONTEIL,
Médecin de Médecine Physique et de Réadaptation.
Christine TERBECHE,
Cadre de santé secteur Rééducation.
Cécile THIRION,
Cadre de santé secteur Rééducation.
SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION
HOPITAL LEOPOLD BELLAN
19-21, rue Vercingétorix - 75014 PARIS.
Nous remercions pour la relecture
de ce livret et leurs remarques pertinentes
le Professeur Catherine LUBETSKI
(Fédération neurologique Pitié-Salpétrière)
et le Professeur René MARTEAU
( Ligue française contre la sclérose en plaques)

La maladie
La sclérose en plaques (ou SEP) est une maladie de l’adulte
jeune. Elle débute le plus souvent entre 20 et 40 ans et touche
deux fois plus de femmes que d’hommes. En Europe, un
habitant sur 1000 est atteint de sclérose en plaques. En France,
on compte actuellement plus de 50 000 personnes touchées
par la maladie. Les signes de la sclérose en plaques sont
extrêmement divers : troubles visuels, troubles de la
sensibilité, déficit de la force musculaire, troubles de la
coordination, troubles urinaires sont les plus fréquents.
L’évolution de la maladie peut se faire sous 3 modes différents :
On parle de forme rémittente lorsque l’évolution se fait par
poussées. Les poussées se caractérisent par l’apparition, rapide le
plus souvent, de nouveaux signes neurologiques ou l’aggravation
brutale de signes déjà existants, qui disparaissent secondai-
rement en totalité ou en partie.
La forme primaire progressive se caractérise par une
aggravation progressive des premiers signes de la maladie.
La forme secondairement progressive correspond à une
aggravation progressive de signes neurologiques, après une
période initiale rémittente. On peut cependant observer des
poussées surajoutées à cette forme progressive.
Les signes de la maladie
Ils sont multiples et souvent associés :
• Les signes moteurs
• Les signes
cérébelleux
• Les signes sensitifs
• Les signes visuels
• Les signes urinaires, les troubles du transit et les signes génito-sexuels
• Les signes psychiques
Les signes moteurs :
Le déficit touche le plus souvent les deux membres inférieurs
(paraparésie)
,
de façon généralement asymétrique. Il peut se limiter à un membre
(monoparésie), le plus souvent inférieur, exceptionnellement supérieur.
En revanche, l’atteinte du membre supérieur et du membre inférieur homo
latéral n’est pas rare (hémiparésie). Enfin, les quatre membres peuvent être
atteints (tétraparésie). Une paralysie faciale peut également être observée.
La raideur musculaire
(ou spasticité)
est généralement associée au déficit moteur.
Les signes
cérébelleux
: (atteinte du cervelet)
Ils sont très fréquents dans la sclérose en plaques. Le syndrome
cérébelleux
peut être uni ou bilatéral et toucher les membres, le tronc, la tête. Il peut
se manifester par un tremblement intentionnel d’un bras par exemple,
un tremblement d’un membre inférieur en station debout, une nécessité
d’écarter les pieds en station debout (augmentation du polygone de
sustentation), une incoordination des membres supérieurs. Un tremblement de
la tête et du tronc peut y être associé, ainsi que des troubles de la voix par
mauvaise coordination du souffle.
Les signes sensitifs :
Il peut s’agir de sensations anormales non douloureuses
(paresthésies)
,
spontanées ou déclenchées par le toucher : picotements, fourmillements, mais
également impressions de cuirasse, de peau cartonnée. Ces
paresthésies
peuvent intéresser les membres, mais également le thorax et l’abdomen.
On peut aussi observer des douleurs de type “central” : sensations de brûlures,
de décharges électriques, de striction, d’étau, exagérées ou non par le toucher.
Une diminution de la sensibilité superficielle (toucher) n’est pas rare.
Les causes de la maladie
Les causes exactes de la sclérose en plaques sont inconnues
à l’heure actuelle. L’hypothèse la plus probable est que la
sclérose en plaques est liée au développement d’une
réaction immunitaire à un agent extérieur à l’organisme
(virus) sur un terrain génétiquement prédisposé.
Les recherches actuelles portent sur la localisation du ou
des gène(s) impliqué(s) dans l’apparition de la maladie et
de ses différents modes d’expression.
2 3
INTRODUCTION

Un examen détaillé peut retrouver des troubles
proprioceptifs
ou sensitifs profonds (par opposition aux troubles de
sensibilité superficielle) : diminution ou perte de la
perception du mouvement de membres ou segments de
membres dans l’espace (kinesthésie), diminution ou perte de
la perception de la vibration au niveau osseux des membres
(pallesthésie).
Ces différents troubles peuvent bénéficier d’une prise en
charge spécifique en rééducation, et parfois de traitements
médicamenteux.
Il faut être vigilant quant à ces troubles de sensibilité, qui peuvent
masquer un traumatisme (trouble de la sensibilité douloureuse :
brûlure, entorse...)
Les signes visuels :
La névrite optique rétro-bulbaire (ou NORB) est un signe
fréquent dans la sclérose en plaques. Elle résulte de la consti-
tution d’une plaque de
démyélinisation
au sein du nerf optique.
Elle se manifeste par une baisse rapide d’acuité visuelle d’un œil
(ou des deux yeux), souvent accompagnée d’une douleur
orbitaire. Le fond d’œil est souvent normal au début et peut
montrer plus tard une pâleur papillaire.
Le
nystagmus
est défini par la succession d’une déviation lente
des yeux et d’une secousse rapide dans le sens contraire. Il
correspond à une atteinte du tronc cérébral.
La paralysie de certains nerfs oculomoteurs ou les paralysies
internucléaires se manifestent par une vision double
(diplopie)
ou une limitation du regard vers le haut, vers le bas, ou sur
les cotés.
Les signes urinaires, les troubles du transit et
les signes génito-sexuels :
Ils sont eux aussi quasi constants dans la sclérose en plaques et
doivent être dépistés et traités afin d’éviter les complications
rénales et les souffrances psychologiques secondaires.
Les signes psychiques :
Une dépression modérée ou sévère est observée chez une majorité de
personnes atteintes de sclérose en plaques ; elle semble d’autant plus fréquente
que l’atteinte neurologique est sévère, mais n’est pas reliée au mode évolutif de
la maladie. Elle peut majorer la fatigue. Des études de qualité de vie ont montré
que le retentissement psychologique de l’affection existait dès le début de la
maladie. L’association d’un traitement médicamenteux et d’une prise en charge
psychothérapeutique doit être proposée.
Des troubles cognitifs (principalement troubles de la mémoire et de l’attention)
peuvent être observés. Ils peuvent être détectés par des tests spécifiques et
être améliorés par une prise en charge adaptée en orthophonie.
Votre médecin et vous
Le potentiel d’évolution de la sclérose en plaques en fait une maladie à part,
qui nécessite une prise en charge spécifique pendant de nombreuses
années. Chaque personne atteinte de sclérose en plaques a son histoire et son
évolution. La stratégie thérapeutique doit donc être adaptée à chacun et
tenir compte des individualités. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir un
médecin neurologue de référence assurant une continuité cohérente de prise
en charge de votre maladie, en particulier dans le cas d’un traitement de fond.
Le médecin rééducateur ou de médecine physique et de réadaptation
intervient en complément de la prise en charge neurologique. Analysant les
incapacités et les gênes de vie quotidienne, il oriente la rééducation, conseille
sur le choix d’aides techniques ou d’adaptations nécessaires (
orthèses
;
fauteuil ; cannes ; domotique...)
En centre de rééducation, il coordonne l’action de l’ensemble des paramédicaux
(kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, infirmières, aides-
soignants, psychologues, psychomotriciens) pour optimiser la qualité de la
prise en charge des patients.
La rééducation doit être réalisée avec plaisir et sans douleur. La programmer
dans la semaine permet de mieux gérer la fatigue qu’elle peut engendrer.
Il est important de ne pas aller jusqu’à l’épuisement lors des activités
quotidiennes et d’entrecouper les activités par des pauses fréquentes.
4 5
INTRODUCTION

Quels lieux de rééducation ?
La prise en charge initiale doit être assurée le plus souvent en libéral pour
éviter toute rupture avec le milieu familial, social et professionnel. Des
kinésithérapeutes compétents, aidés de prescriptions de rééducation détaillées
obtiennent le plus souvent de bons résultats.
La réalisation de mobilisations passives avec étirements, d’une rééducation
spécifique de l’équilibre ou d’une correction posturale permet de gérer la
majorité des difficultés à ce stade.
Quand apparaît une gêne quotidienne, une réduction sévère du périmètre
de marche (<100 m), des chutes fréquentes (>1/semaine), des difficultés à
assurer une activité professionnelle, une incapacité à se relever du sol ou des
douleurs mécaniques (rachis, genou), l’indication d’une prise en charge en
milieu spécialisé doit être discutée, en hôpital de jour ou dans des
services de rééducation adaptés au cours d’une hospitalisation à temps plein.
Des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie, des prises en
charge psychologiques y sont dispensés. Des séjours de 3 à 4 semaines
permettent le plus souvent d’atteindre les objectifs, fixés à l’entrée ou lors
d’une consultation de préadmission. Une évaluation de la
spasticité
avec de
possibles conséquences thérapeutiques (traitements généraux ou locaux), le
traitement des troubles urinaires et de la constipation sont généralement
associés.
Ces prises en charge ne se substituent en aucun cas aux traitements
neurologiques mais en sont complémentaires.
A un stade évolué, l’évaluation de l’environnement pour adapter le domicile
avec essai et conseil d’aides techniques reste indispensable pour permettre le
maintien le plus longtemps possible au domicile dans des conditions de
sécurité maximales (rôle de l’ergothérapie).
Pourquoi la rééducation ?
La rééducation de la sclérose en plaques est un traitement
complémentaire du traitement médical prescrit par les
neurologues. Selon les différents stades de la maladie, son
objectif est de préserver une fonction, d’optimiser les
capacités résiduelles ou de prévenir les complications
(neuro-orthopédiques, urinaires, de décubitus).
Selon le type de déficit ou le degré d’évolution de la maladie, la
prise en charge en rééducation implique de la kinésithérapie, un
séjour en milieu spécialisé, une prise en charge de la
spasticité
,
des troubles urinaires, des conseils pour le maintien au
domicile...
Quand rééduquer ?
Il est nécessaire d’envisager une prise en charge en rééducation
dès l’apparition d’un symptôme gênant la vie quotidienne. Il
peut s’agir d’une boiterie, de l’apparition de fuites urinaires, d’une
faiblesse d’un membre, de
spasticité
...
L’intervention précoce permet d’éviter la survenue de compen-
sations nocives qui, une fois installées, sont difficiles à corriger :
mauvais schéma de marche, canne portée du mauvais côté,
réduction des boissons pour éviter des fuites urinaires avec les
conséquences sur le transit intestinal et les infections urinaires
ou les lithiases...
La rééducation se justifie aussi au décours d’une poussée de la
maladie, à visée de reconditionnement à l’effort et de gestion
de la fatigabilité.
Lorsque les déficits moteurs, sensitifs ou le syndrome
cérébelleux
se majorent, le but de la rééducation est de
maintenir la plus grande autonomie possible avec ou sans
fauteuil roulant.
Quand le handicap devient sévère et les déficits définitifs,
il faut envisager la phase de réadaptation avec l’apport
des aides techniques (fauteuil roulant électrique, syn-
thèses vocales, adaptation du domicile...).
6
Fauteuil roulant électrique
7
REEDUCATION

9
La prise en charge en kinésithérapie
La prise en charge en ergothérapie
La prise en charge en orthophonie
La prise en charge de la fatigue
La prise en charge des douleurs
La prise en charge des troubles génito-sexuels
La prise en charge des troubles vésico-sphinctériens
La prise en charge des troubles du transit
Comment choisir ses exercices
de rééducation ?
Les exercices proposés dans ce livret doivent vous permettre
de mieux appréhender la rééducation.
Certains de ces exercices pourront être réalisés par vous seul,
d’autres nécessiteront la participation et la surveillance des
professionnels de rééducation.
Tous les exercices proposés ne concernent pas forcément le
traitement de votre forme de sclérose en plaques.
N’hésitez pas à demander conseil à votre kinésithérapeute ou à
votre médecin.
Les principes de rééducation
Aucune rééducation n’est spécifique de la sclérose en plaques.
Comme nous l’avons vu plus haut, les formes de la maladie sont
multiples. La rééducation repose sur une analyse précise des
troubles occasionnés par la maladie.
Les techniques utilisées par les professionnels sont issues de la
rééducation neurologique et adaptées aux caractéristiques de
l’affection (en particulier pour la fatigue).
Il n’existe pas de technique miracle mais plutôt des indications
de prise en charge en fonction du niveau d’autonomie.
Les techniques qui suivent sont à moduler en fonction du cas de
chacun, des objectifs recherchés et des demandes du patient.
RÉÉDUCATION
8
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%