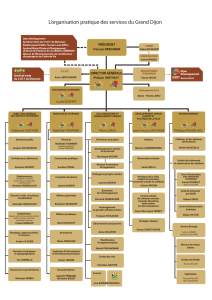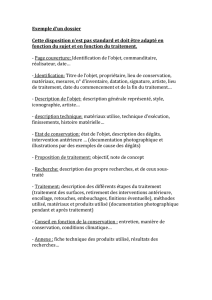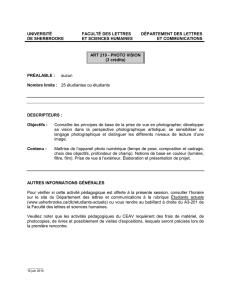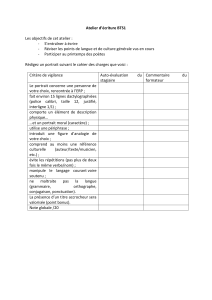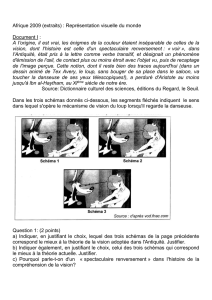dans l`image (photographique) chez Michel Tournier - E

Mariana Tu\escu
« Images d’univers » dans l’image (photographique)
chez Michel Tournier
0. Avec son esprit philosophique centré sur l’antinomie et nourri de KANT et de
BACHELARD, Michel TOURNIER définit dans Le miroir des idées (1994, 1996)
certains couples de contraires, dont le signe et l’image :
« Signe et image sont les deux grandes voies de la communication
entre les hommes à travers l’espace et le temps.
À première vue, l’image présente sur le signe un avantage décisif, son
universalité. [...]
Notons d’abord que deux des trois grandes religions du mode occi-
dental – la region juive et l’islam – rejettent et même condamnent
l’image. [...]
On ne donnerait pas une idée fausse du christianisme en en faisant une
réhabilitation de l’image en face du signe. Lorsque Jésus monte sur le
mont Thabor, c’est pour se montrer à ses disciples dans toute sa splen-
deur divine (image). En redescendant dans la vallée, il leur commande
de ne pas dire un mot (signe) de ce qu’ils ont vu. L’art chrétien fut le
fruit de cette révolution. [...]
Notre société marie étroitement le signe et l’image. La photographie,
le cinéma, les magazines, la télévision sont avant tout images, certes.
Mais ces images seraient inintelligibles et inintéressantes sans les com-
menaires et les paroles qui les accompagnent – et qui sont des signes.
Alors que les signes, eux, se suffisent à eux-mêmes, comme le
prouvent le livre et la radio. » (123-124).
1. L’hypothèse que nous aimerions évoquer dans ces pages est une hypothèse
sémantico-logique, proposée par Robert MARTIN. Elle est basée sur les notions
d’« univers de croyance »et d’« image d’univers ».
L’univers de croyance est « l’ensemble indéfini des propositions que le locuteur
(l’énonciateur, n.n.), au moment où il s’exprime, tient pour vraies ou qu’il veut
accréditer comme telles (R. MARTIN, 1992 : 38) ». L’univers de croyance étant le
lieu de toutes les propositions décidables et de toutes le propositions auxquelles
l’énonciateur attribue effectivement une valeur de vérité (VRAI, FAUX, POSSILE),
cet univers « rassemble en lui l’ensemble des mondes possibles tels que l’énoncia-
teur les conçoit, ces mondes étant définis comme des ensembles consistants de
propositions liés aux instants d’un temps ramifié » (R. MARTIN, 1992 : 46). Alter-
natives au monde de ce qui est (m0), les mondes possibles sont de deux sortes : des
mondes potentiels (qui ne contiennent aucune proposition contradictoire avec celles
de m0) et des mondes contrefactuels (qui contiennent au moins une proposition
contradictoire avec celles de m0, admise pour fausse).
Les univers de croyance engendrent les « images d’univers ». On appelle
«image d’univers » la représentation d’un univers dans le discours. « Il y a image

d’univers dès lors que, épistémiquement, le locuteur renvoie, dans son discours, à un
univers de croyance » (R. MARTIN, 1992 : 47).
L’univers de croyance détermine la véridiction du message produit, son carac-
tère non pas vrai, mais véridictoire.
L’énoncé fictionnel appartient à l’image d’univers d’un énonciateur, « sorte de
médium », « qui permet à l’auteur-créateur de dire ce qu’il dit sans qu’il en naisse
aucune impression de mensonge » (R. MARTIN, 1992 : 286).
L’image d’univers représenté dans le discours figurativo-fictionnel engendre une
certaine vision du RÉEL, « plus on moins éloignée de la vision que peut en avoir le
lecteur, voire l’auteur lui-même » (R. MARTIN, 1992 : 286) et crée, par là même,
un PARAÎTRE qui s’oppose à l’ÊTRE ou, au mieux, qui enrichit ce dernier de nou-
velles dimensions cognitives, encyclopédiques, psychologiques, sémantiques.
Nous nous trouvons ainsi devant une vision subjective du monde, devant une
modalité épistémique qui n’est pas sans rappeler la théorie classique de
Émile BENVENISTE sur la subjectivité du langage ou la philosophie du langage de
la perception, élaborée par les tenants de l’École Analytique Anglaise – A. J. AYER,
H. H. PRINCE, G. J. WARNOCK et J. AUSTIN –, engagés dans le débat autour de
l’« argument de l’illusion ». Résumée par J. AUSTIN (1966, 1971), cette doctrine
postule que : « nous ne percevons jamais directement des objects matériels. Ce que
nous percevons directement, ce sont seulement des données sensibles (sense-data)
ou nos propres idées, impressions, sensa, perceptions sensibles et percepts... »
(J. AUSTIN, 1971 :22). La « donnée sensible » et la « chose matérielle » existent
aux dépens l’une de l’autre.
Forts de ces éléments de méthode, nous allons essayer de déceler certains aspects
de l’herméneutique de l’image et de l’image photographique telle qu’elle apparaît
dans la création de Michel TOURNIER.
Nos textes de référence sont Des clefs et des serrures.Images et proses
(Chênes/Hachette, 1979) et La goutte d’or (Galimard, 1986).
2. Des clefs et des serrures regroupent quarante sujets de réflexion fort divers :
l’athlète, les animaux, le mistral, Van Gogh, l’amour, la mort, le dandysme, le riz,
l’aquarium, l’autoportrait, le froid, le cerveau, l’escalier, les moulins de Beauce, la
Normandie, « les accidents, les niaiseries et le reste », etc...
Ces petites proses poético-philosophiques, traversées le plus souvent par une
description antinomique et toujours basées par une mise en abîme encyclopédique,
accompagnent soixante chefs-d’œuvre de la photographie, signées par des maîtres
comme : Dieter Appelt, Édouard Boubat, Lewis Caroll, Henri Cartier-Bresson, Jean
Dieuzaide, Robert Hamelin, Jacques-Henri Lartigue, Eikon Hosoe, Leni
Riefenstahl, Jean-Claude Mougin, etc.
Le livre est emblématique à deux égards : le pertinence du rapport texte – image
photographique et le statut de ces petites proses d’être des textes-images.
Ces petites proses sont des textes-images, où l’univers de croyance de l’énonci-
ateur (créateur) engendre des mondes possibles et les images d’univers sont sym-
boliquement déclenchées à partir du signifiant linguistique et photographique. Voici,
par exemple, une séquence tirée du premier texte – Des clefs et des serrures :
« ... le monde entier n’est qu’un amas de clefs et une collection de ser-
rures. Serrures le visage humain, le livre, la femme, chaque pays
étranger, chaque œuvre d’art, les constellations du ciel. Clefs les
60 / Mariana Tu\escu

armes, l’argent, l’homme, les moyens de transport, chaque instrument
de musique, chaque outil en général. La clef, il n’est que de savoir s’en
servir. La serrure, il n’est que de savoir la servir... afin de pouvoir
l’asservir.
La serrure évoque une idée de fermeture, la clef un geste d’ouverture.
Chacune constitue un appel, une vocation, mais dans des sens tout
opposés. Une serrure sans clef, c’est un secret à percer, une obscurité
à élucider, une inscription à déchiffrer. »
Les images photographiques qui accompagnent ce texte sont signées Eikon
Hosoe et Jean Dieuzaide.
Ces textes-images ont un caractère visuel, l’image y règne, l’auteur pense avec
son œil ; mais, en même temps, son univers de croyance enrichit la pellicule de
connotations et d’inférences analytiques qui engendrent les mondes possibles du
texte. La représentation du monde que le texte de TOURNIER nous propose
s’inspire bien souvent d’une photopraphie dont il devient « la légende », c’est-à-dire
la glose poétique et figurative, le commentaire interprétatif et symbolique et l’exal-
tation fabuleuse.
Il en est ainsi, par exemple, du texte Les Moulins de Beauce.
La description définitionnelle du moulin à vent engendre un réseau d’inférences
existentielles et prédicatives, celles-ci fonctionnant par équivalence, par inclusion et
par méréonymie, comme dans l’image ci-dessous :
« Un moulin à vent, c’est d’abord une maison. Une vraie maison où
gîte maître meunier.
Mais cette maison ne ressemble à aucune autre. D’abord elle se dresse
solitairement à l’écart du village, au centre du pays plat céréalier. C’est
souvent une tour de bois, posée sur un socle de maçonnerie en forme
« Images d’univers » dans l’image (photographique) chez Michel Tournier / 61

de tronc de cône ou de pyramide... Mais cette tour travaille et, pour ce
faire, elle a des ailes. [...]
Seul relief de la plaine, seul accueil du vent de la plaine, le moulin est
maison, arbre, poumon. L’arbre secoue dans le vent sa crinière de
feuilles en mugissant. C’est sa façon de respirer. [...] Cette affinité du
moulin et de l’arbre a valeur de clef. En effet, de tous les instruments
à vent – voilier, planeur, orgue, cerf-volant, harpe éolienne,
trompette –, le moulin est le seul qui répond à une vocation terrienne.
Les autres flottent – dans l’eau, dans l’air, dans l’esprit. Lui, âprement
fiché sur son socle, arc-bouté sur sa queue, jaillit directement de la
terre grasse et accomplit pleinement sa mission qui est d’assurer la
médiation entre le blé et le pain. Car le meunier reçoit du cultivateur et
donne au boulanger. [...]
Prisonnier du sol comme un voilier échoué sur un banc de sable, le
moulin ne bat-il pas des ailes désespérément pour tenter de s’arracher,
de planer, de voler ? On songe à
quelque grand papillon gauche et fra-
gile, cruellement épinglé sur un bou-
chon. S’il en était ainsi, il serait naturel
que le meunier eût sa part de cette
grande aspiration de la machine agri-
cole rêvant de devenir aéroplane. Don
Quichotte lui-même, chargeant un
moulin et emporté avec Rossinante par
ses ailes, ne voulait peut-être que partir
aussi avec ce qu’il avait pris pour un
grand oiseau sur le point de s’envoler. »
Un va-et-vient continuel s’établit entre le
texte et l’image photographique, circuit
entretenu par les mondes possibles et les
images d’univers représentés. Soit une
séquence du texte Le Riz, accompagné par
cette photo due à Édouard Boubat :
62 / Mariana Tu\escu

« Qui n’a pas mangé et vu manger du riz en Inde ne sait pas ce que
contiennent ces trois simples lettres (trois lettres, comme dans le mot
blé, mais entre ces deux nourritures fondamentales, il y a la distance
de deux groupes de civilisations). Le peuple indien est un peuple de
prêtres. Tous ses actes sont rituels, toutes ses actions paraissent obéir à
un modèle séculaire. Les gestes de l’Indien qui prépare son riz sous
vos yeux vous racontent une légende, ceux qu’il accomplit en
mangeant ont valeur de sermon. Son visage dévoré par la flamme de
son regard nie ardemment tout le reste de son corps, et donc cette nour-
riture est d’essence spirituelle. »
La valeur symbolique de certaines photos se voit doublée d’une saillance per-
ceptive. Tout concourt ainsi à faire de l’image photographique un condensé du texte.
C’est, par exemple, le cas des petites proses intitulées : Vue de Normandie et L’esprit
de l’escalier :
« La prairie normande agit comme une tunique stomacale, chaque
graminée comme une papille digestive, dissolvant la pomme blette, la
feuille sèche, l’oiseau mort, le nid tombé avec sa fragile cargaison
d’œufs mouchetés, la poupée oubliée, les larmes, les rires, les sou-
venirs. »
La vocation antinomique traverse la plupart des représentations textuelles de
TOURNIER. Les images photographiques ci-dessus en font foi. Les deux escaliers
antithétiques et complémentaires sont celui qui descend à la cave et celui qui monte
au grenier.
« Le premier est de pierre, froid, humide, et il fleure la moisissure et la
pomme blette. L’autre a la sèche et craquante légèreté du bois. C’est
qu’ils anticipent chacun sur les univers où ils mènent, lieu d’obscurité
« Images d’univers » dans l’image (photographique) chez Michel Tournier / 63
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%