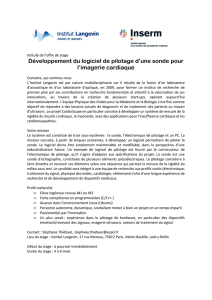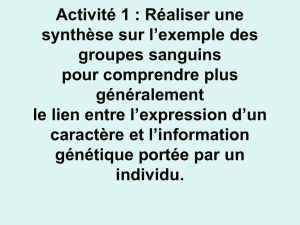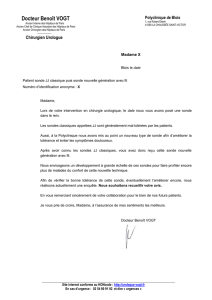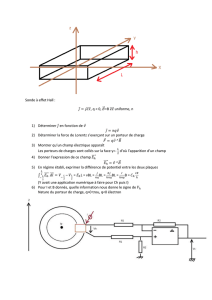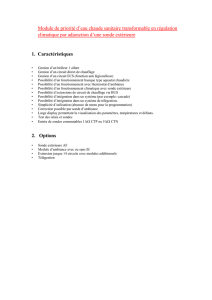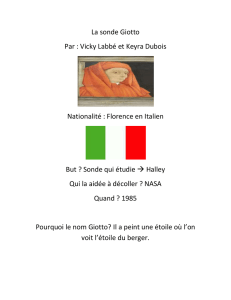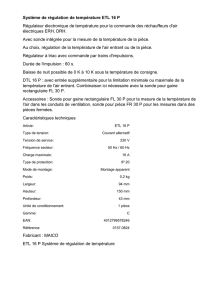Alimentation entérale - Soins des abords digestifs

44
LIBÉRALE
Chez l’adulte, les abords digestifs pour
l’alimentation entérale concernent les
sondes nasogastriques, nasoduodénales,
et nasojujénales en cas de gastrostomie et de
jéjunostomie.
Le médecin prescrit la pose de l’abord digestif et
les médicaments à administrer. Le choix des
formes galéniques se fait en collaboration avec
le pharmacien.
Le médecin pose la sonde dont le site d’instil-
lation se situe en post-pylorique (duodénal ou
jéjunal). Sur prescription, l’infirmière peut
poser une sonde nasogastrique en vue de l’ali-
mentation entérale. Elle assure également les
soins et la surveillance de tous les patients en
assistance nutritive entérale, elle administre les
médicaments, et en surveille les effets. Son rôle
consiste aussi à éduquer le patient et son en-
tourage, et à participer à la surveillance cli-
nique des malades. L’infirmière change unique-
ment la sonde d’alimentation nasogastrique,
communique au médecin toute information
permettant une meilleure adaptation du traite-
ment en fonction de l’état de santé du patient et
de son évolution, enregistre ses actions et leur
résultat dans le dossier de soins.
Étapes de la procédure : rôle infirmier
•Informer le patient : l’infirmière vérifie la com-
préhension des informations reçues par la per-
sonne et apporte des compléments d’informa-
tion si nécessaire.
•S’assurer d’une prescription médicale complète :
la prescription doit être qualitative et quantita-
tive, datée et signée. Un anesthésique de contact
peut être prescrit.
•Préparer le matériel : rassembler le matériel
pour le soin du nez, des gants à usage unique,
la sonde, le matériel de fixation. Si un lubrifiant
L’ANAES vient d’éditer des recommandations concer-
nant une suite ordonnée d’actions préconisées pour
les soins et la surveillance des abords digestifs.
L’infirmière est habilitée, sur prescription médicale, à
poser une sonde nasogastrique en vue de l’alimen-
tation entérale.
Alimentation entérale
Soins des abords digestifs
Poser la sonde nasogastrique
La pose est un geste simple mais susceptible d’entraî-
ner des complications chez tout patient et plus parti-
culièrement chez ceux présentant des troubles de la
déglutition et des troubles de la vigilance (prévoir
dans ce cas un plateau technique).
Des règles strictes d’hygiène sont à respecter. La pose est
réalisée à jeun. La personne consciente est installée en
position assise. La narine est éventuellement anesthé-
siée en fonction de l’avis médical et la participation du
patient est sollicitée. La sonde est fixée avant le contrô-
le de la bonne position de son extrémité. Lorsque la
bonne position est confirmée, un repère indélébile est
marqué sur la sonde à 2 ou 3 cm du nez et la longueur
externe de la sonde est mesurée.
Vérifier la position de la sonde :
L’absence de toux et de résistance durant la pose ne pré-
sume pas de la bonne position de la sonde nasogas-
trique. Le meilleur moyen de vérification initiale est le
contrôle radiologique.
Fixer la sonde nasogastrique :
La fixation s’effectue immédiatement après la pose.
La méthode consiste à préparer la peau (lavage, sécha-
ge), à poser un ruban adhésif étanche, à base de ma-
tière plastique, à l’enrouler autour de la sonde au ni-
veau de la base du nez, et à appliquer la moitié d’une
bande de ruban adhésif élastique d’environ 4 cm sur
le nez, sa partie basse étant fendue jusqu’à la pointe
du nez, chaque moitié du sparadrap étant alors enrou-
lée autour de la sonde. La fixation sur la joue est limi-
tée au minimum en évitant de former une grande
boucle qui entre dans le champ visuel du patient et
qui augmente le risque d’arrachement. La fixation par
un fil est utilisée dans des indications spécifiques, en
ORL notamment.

est utilisé, il doit être compatible avec le maté-
riau de la sonde. Ainsi, l’utilisation d’un lubri-
fiant à base de silicone est déconseillée si la
sonde est en silicone.
•Assurer les soins d’hygiène et de confort : quel que
soit l’abord, il est important d’assurer une bonne
hygiène buccale et de maintenir les apports hy-
driques par la bouche chaque fois que cela est
possible. Les soins infirmiers consistent égale-
ment à aider la personne à exprimer ce qu’elle
ressent face à l’altération ou à une perturbation
de son image corporelle et à maintenir au maxi-
mum les activités de la vie quotidienne.
•Rincer la sonde : le but est d’éviter l’obstruction
et de désobstruer la sonde. Le liquide de rinça-
ge est l’eau, sauf indication contraire. Il est sou-
haitable d’obtenir une prescription de la quan-
tité de liquide journalière à injecter ainsi que la
nature du liquide de rinçage. En prévention de
l’obstruction des sondes, il semble utile de rin-
cer la sonde chaque fois qu’elle est utilisée après
avoir vérifié sa bonne position. On ne doit pas
utiliser le mandrin mais une seringue de gros
calibre pour entreprendre des manœuvres de
désobstruction.
•Administrer les médicaments : l’introduction de
médicaments se fait dans le respect de leur forme
galénique, choisie en fonction des difficultés liées
à la technique d’administration (interaction entre
les aliments et le principe actif). L’avis du phar-
macien est nécessaire. L’emplacement de la sonde
doit être vérifié avant l’administration de médica-
ments et entre chaque médicament afin d’éviter
les interactions des traitements.
•Changer la sonde : il n’existe pas de préconisa-
tions en faveur d’un rythme précis de change-
ment de sondes quelles qu’elles soient.
•Identifier les complications et les prévenir : les
complications peuvent être l’absence de coopé-
ration (présence de deux personnes lors de la
pose), la douleur (surveiller sa disparition),
l’enroulement de la sonde (retirer et reposer la
sonde), l’hémorragie nasale et extériorisée par la
bouche (retirer la sonde, comprimer la narine et
appeler le médecin), l’obstruction des orifices
de sonde (ôter la sonde, la désobstruer, la repo-
ser), la régurgitation (installer le patient en po-
sition latérale de sécurité), la toux et les lar-
moiements (retirer la sonde, la réintroduire,
vérifier systématiquement la bonne position de
la sonde).
Des accidents peuvent se produire. En cas de
fausse route muqueuse pharyngée, introduire
doucement la sonde. La pose de sonde est
contre-indiquée chez le traumatisé craniofacial.
Si la sonde s’est posi-
tionnée dans l’arbre
trachéobronchique,
en cas de difficulté et
d’utilisation d’un man-
drin, il faut l’interven-
tion d’un médecin. Il
faut dans ce cas véri-
fier l’emplacement de
la sonde par contrôle
radiologique avant de
démarrer la nutrition.
Éduquer le patient
L’ éducation du patient doit commencer à l’hôpi-
tal afin que le retour au domicile soit facilité.
C’est une étape essentielle réalisée progressive-
ment. L’infirmière à domicile doit s’appuyer
sur une fiche de liaison hôpital-domicile, car
c’est elle qui assure le suivi, notamment l’éva-
luation des capacités du malade à se prendre
en charge et à faire face à certaines difficultés
techniques. Ainsi le patient doit devenir au-
tonome et suffisamment averti pour pouvoir
signaler tout changement au médecin ou à
l’infirmière.
A.-L.P.
D’après les recommandations de l’ANAES
(Informations consultables sur le site : http://www.anaes.fr)
45
Soins d’hygiène
Pour la sonde nasogastrique, les actions de soins consis-
tent à dépister l’escarre de l’aile du nez, éviter le risque de
reflux gastro-œsophagien par la position demi-assise
obligatoire pendant la nutrition et deux heures après la
fin de celle-ci. Pour la sonde de gastrostomie, posée par
le médecin, il faut éviter le risque de reflux gastro-œso-
phagien par la position demi-assise absolue pendant la
nutrition et dans les deux heures qui suivent la fin de
l’alimentation.
Pour les sondes de gastrostomie et de jéjunostomie, il faut
préconiser l’utilisation de la douche dès que possible et
prendre en compte les difficultés de l’habillage. Les soins
locaux visent à assurer l’hygiène locale et/ou l’antisepsie,
à éviter la macération et à surveiller le site d’insertion.
©H.Raguet-Phanie
1
/
2
100%