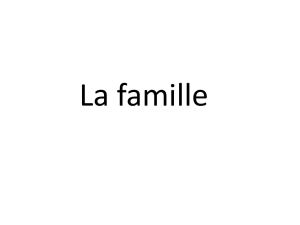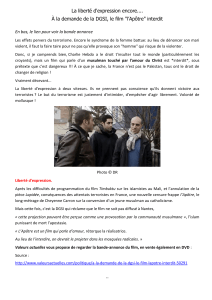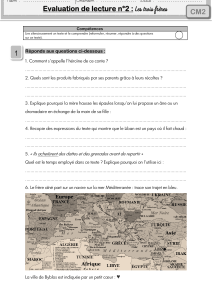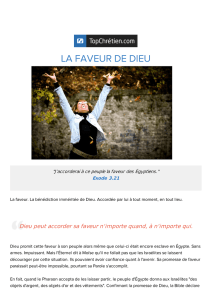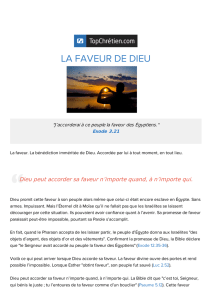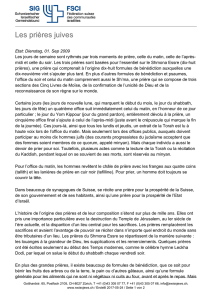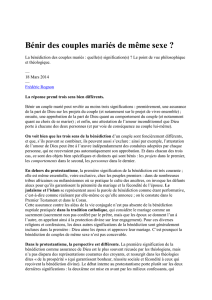Le travail - fmm Canada

Le travail
L’homme n’est pas sauvé par ses œuvres,
si belles soient-elles.
Il lui faut encore devenir lui-même
l’œuvre de Dieu.
François d’Assise selon Éloi Leclerc
Le travail est « un bien de l’homme » disait Jean-Paul
II : par son travail, l’homme développe ses capacités et
les met au service d’une communauté ; il coopère avec
d’autres personnes pour produire des « biens » et des
« services » ; sur son lieu de travail, il noue des liens
interpersonnels pour constituer une communauté. C’est
le caractère positif du travail : bien plus qu’une
nécessité pénible à laquelle on consentirait pour gagner
sa vie, le travail est un lieu d’épanouissement personnel,
et un lieu de construction de la communauté humaine.
En permettant le développement des personnes et des
communautés, le travail est un des lieux
d’accomplissement de la vocation à laquelle Dieu
appelle l’homme, celle de continuer son travail de
création et de veiller à ce que « le message chrétien ne
détourne pas les hommes de la construction du monde
et ne les incite pas à se désintéresser du sort de leurs
semblables » (Gaudium et spes, §34).
Avant sa conversion, l’Apôtre Paul était fabricant de
tentes. Aveuglé, illuminé et retourné sur le chemin de
Damas, il devient un homme nouveau, mais ne change
pas ses habitudes de travail. Ses mains deviendront
désormais un instrument de bénédiction pour une
multitude. Il encourage même les nouveaux convertis
«à demeurer dans la condition où ils étaient quand ils
ont reçu l’appel de Dieu» (1Cor 7, 20; Act 18, 1-4).
C’est que tout en ayant reçu la mission d'annoncer le
Seigneur ressuscité, Paul ne veut rien recevoir en
échange. Même importante, l’annonce de l’Évangile est
gratuite et ne cherche pas de récompense. Et si la
mission de l'Apôtre occupait largement son temps, il se
faisait un point d’honneur et de fierté de gagner sa vie et
de ne pas dépendre des autres. «Argent, or, vêtements, je
n'en ai convoité de personne; vous savez vous-mêmes
qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont
pourvu les mains que voilà» (Ac 20, 33-34).
Toute personne doit travailler pour se nourrir et pour
nourrir les siens. Paul ne veut pas échapper à cette loi de
la condition humaine qui était pour lui une question
d’honnêteté et de dignité: « Si quelqu'un ne veut pas
travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous vous
encourageons, (…) à travailler de vos mains comme
nous vous l'avons ordonné » (1 Thess 4, 10-11).
Pour Paul, le travail était aussi sa part de collaboration à
l’œuvre de Dieu. Selon la Bible, «Yahweh prit l’homme
et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le
garder (Gen 2, 15). Si le Décalogue prescrit le sabbat,
c’est au terme de six jours de travail (Ex 20,8ss). En effet,
les tableaux imagés de la Création en six jours
soulignent que le travail de l’homme est présenté
comme un reflet de l’action du Créateur. Le récit nous
signifie qu’en formant l’homme «à son image et à sa
ressemblance» (Gen 1,26), Dieu a voulu l’associer à son
dessein. Après avoir mis l’univers en place, il l’a remis
entre les mains de l’homme avec le pouvoir d’occuper
la terre et de la soumettre (Gen 1, 28). Et tous ceux qui
travaillent, même s’ils «ne brillent ni par la culture ni
par le jugement, tous cependant, chacun par son métier,
«soutiennent la Création» (Si 38, 34).
Dans l’Évangile, le travail est magnifié par l’exemple
de Jésus fils de charpentier (Mt.13, 55) et ouvrier lui-
même (Mc 6,8). Dans la logique de l’Incarnation et du
chemin de pauvreté choisi par Jésus, le fils de Dieu vit
dans la simplicité de notre condition humaine, dans
l’humilité de l’ordinaire de nos jours.
Quand Jésus emprunte ses comparaisons au monde du
travail, il en reconnaît la valeur : pasteur, vignerons,
médecin, semeur (Jn 10,1ss; Mc 2,17; 4,3). Non seulement
il présente l’apostolat comme un travail, celui de la
moisson, (Mt 9, 37; Jn 4, 38) ou de la pêche (Mt 4, 19), non
seulement il est attentif au métier de ceux qu’il choisit
(Mt 4, 18), mais il suppose par tout son comportement, un
monde au travail : le laboureur à son champ (Lc 9,62), la
ménagère à son balai (Lc 15,8) et il trouve anormal de
laisser enfoui un talent sans le laisser fructifier (Mt 25,
14-30) (cf. Vocabulaire théologie biblique).
Comme saint Paul, François d’Assise encourage ceux
qui veulent le suivre à continuer leur travail, les incitant
à le vivre comme une mission : «Que les frères qui
savent travailler, travaillent et exercent le même métier
qu’ils ont appris, s’il n’est pas contraire au salut de
l’âme et s’il peut être pratiqué honnêtement» (1R VII, 3).
Dès les débuts du mouvement franciscain, les frères et
les sœurs se définissent comme des gens de travail. Ils
s’engagent d’abord au service des lépreux ou des
personnes âgées qu’on plaçait dans des hospices. Quand
les premiers frères de François se mirent ensemble, ils
rencontrèrent des gens qui étaient comme eux au travail.
Dans sa règle, il leur demande de se comporter comme
de vrais frères mineurs, i.e. humbles et petits (1R 7,2).
Même si pour François, le travail était considéré comme
un service, il le relativise par rapport à son engagement

envers Dieu. Un jour il avait confectionné un panier
d’osier pour frère Sylvestre; son travail achevé, il le
livre au feu. À Frère Léon qui s’en étonne, François
répond : «Je veux travailler de mes mains, et je veux
aussi que tous mes frères travaillent. Non pour le
cupide désir de gagner de l’argent, mais pour le bon
exemple et pour fuir l’oisiveté. Rien de plus lamentable
qu’une communauté où l’on ne travaille pas. Mais le
travail n’est pas tout, frère Léon, il ne résout pas tout. Il
peut même devenir un obstacle redoutable de la vraie
liberté de l’homme. Il le devient chaque fois que
l’homme se laisse accaparer par son œuvre au point
d’oublier d’adorer le Dieu vivant et vrai (…) L’homme
n’est grand que lorsqu’il s’élève au-dessus de son
œuvre pour ne plus voir Dieu, alors seulement, il atteint
toute sa taille.» (La Sagesse d’un pauvre d’Éloi Leclerc).
Fondatrice d’un Institut missionnaire, Marie de la
Passion a vite compris que le but de cette œuvre ne
pourra se réaliser que s’il y a équilibre entre prière et
action. De plus écrit-elle, pour trouver des ressources,
«nous devons tendre à gagner notre pain, comme saint
Paul et comme les travailleurs; c’est plus franciscain».
Avec ses religieuses, elle créera des ateliers de broderie
et d’imprimerie, et malgré sa lourde tâche
d’organisation de l’Institut, elle s’investira elle-même
en écrivant des livres qui seront publiés.
Dans les constitutions écrites en 1882, au chapitre
premier qui explique la fin spéciale de l’Institut, elle
recommande à ses sœurs l’amour du travail : «Qu’elles
ne soient jamais inoccupées. Qu’elles donnent à la
prière le temps marqué par l’obéissance et que le reste
de la journée soit occupé aux œuvres et au travail des
mains. Qu’elles cherchent à faire promptement et le
mieux possible tout ce qui leur est confié».
Réflexion
1. Continuer le travail de création de Dieu, voilà la
vocation de l’homme. Comment mon travail me
permet-il de continuer le travail de création de
Dieu ? Y a-t-il d’autres lieux d’accomplissement
de cette vocation ?
2. Converti, Paul ne change pas ses habitudes de
travail. Ses mains sont un instrument de
bénédiction pour la multitude. Être un
instrument de bénédiction, qu’est-ce que ça veut
dire pour moi ? Comment mes mains peuvent-
elles être un instrument de bénédiction pour moi,
pour les autres ?
3. L’annonce de l’Évangile est gratuite, selon Paul,
elle ne cherche pas de récompense. Qu’est-ce
que la gratuité ? Est-ce que je peux identifier des
gestes gratuits que j’ai posés aujourd’hui?
4. Pour Marie de la Passion comme pour François
d’Assise, le travail était une valeur essentielle
à l’accomplissement de leur œuvre. Qu’est le
travail pour moi? Est-il une valeur importante ?
Comment me permet-il de vivre mon
engagement afmm ?
Prière : Tu es béni. Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre,
de la vigne et du travail de nos mains !
Chant : Comme Lui R. Lebel
ou
Comme on fait son jardin R. Lebel
L’apôtre Paul
« le travail de nos mains »
En artisans de paix et de réconciliation,
nous travaillons
à rendre le monde plus juste, plus humain…
Const. fmm #39
Fiche no 4
1
/
2
100%