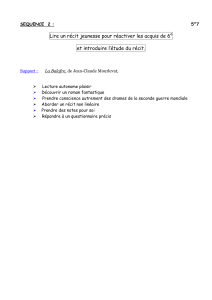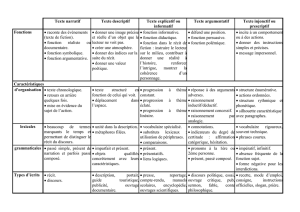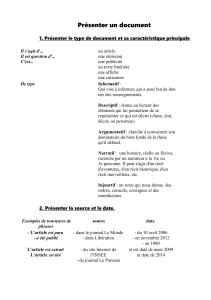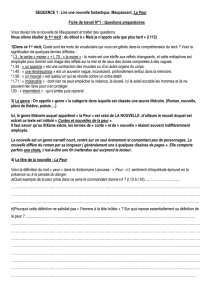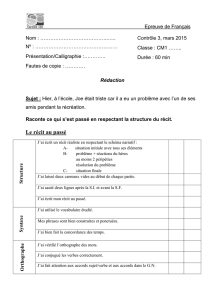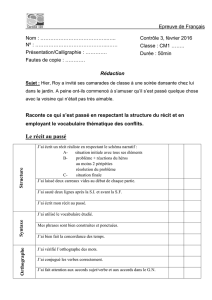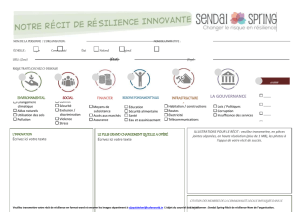Variations sur le moi dans la fiction narrative en

1
Variations sur le moi dans la fiction narrative en prose au XVIIe siècle
Dans le prolongement de l’interrogation de la semaine dernière sur les replis du moi au
sein d’un récit rétrospectif et mémoriel, voici un parcours jalonné de quatre fictions narratives
en prose qui s’échelonnent à peu près de génération en génération entre 1620 et 1680 :
l’Histoire comique de Francion publiée par Charles Sorel en 1623 et augmentée en 1626 et
1633
1
; Le Page disgracié de Tristan L’Hermite (1643)
2
; l’Histoire d’Henriette d’Angleterre
composée par Mme de Lafayette (?) à partir de 1664
3
; enfin La Princesse de Clèves (1678)
4
.
Aucun de ces textes où se mêlent fiction romanesque et réalité constitutive ou contextuelle
n’est reçu à son époque pour un roman (le terme définit autre chose) ni pour une biographie
fictive (le terme n’existe pas). Pourtant, la proximité trouble entre leur auteur et son
personnage majeur noue un rapport que nous avons coutume d’assimiler aujourd’hui à celui
que tisse entre eux le roman de type pseudo-biographique ou autofictionnel, dont A la
recherche du temps perdu constitue un des modèles. La lecture appliquée à ces quatre œuvres
consistera ici à montrer comment s’y décline de diverses façons la réciprocité entre la
structure du moi du personnage éponyme, son « for intérieur » fictionnel, et la forme de
relation spécifique que l’instance auctoriale entretient avec lui.
*
Francion, un précis de décomposition du moi
1-Une aventure éditoriale en trois volets
Une première Histoire comique de Francion, racontant la vie et les frasques, la fortune et
les infortunes d’un jeune aristocrate provincial devenu collégien à Paris puis homme de cour,
client d’un grand seigneur et noceur impénitent, parut en sept livres en 1623
5
. Charles Sorel,
déjà auteur de quelques pièces en vers et récits romanesques, avait à peine plus de vingt ans.
Trois ans plus tard paraît une deuxième version, enrichie de trois livres nouveaux et refondue
par la division en deux de l'ancien livre cinq, profondément corrigée pour ne pas dire
entièrement réécrite, plus satirique mais très assagie dans son hétérodoxie morale et
religieuse : effet sans doute du procès de Théophile et de la remise en ordre moral annoncée
en 1624 par l'arrivée de Richelieu au ministère. La part romanesque y croissait au détriment
du récit de formation ; l’énonciation à la première personne, qui occupait les trois quarts du
texte initial, était détrônée par la troisième personne ; une conclusion attendue par un mariage
avec une jeune fille dont le portrait l'avait séduit se substituait à la fin très « ouverte » du texte
de 1623, qui abandonnait le héros sur les routes en quête de la belle. Bref, ce que Sorel avait
donné alors pour une « histoire comique », définie par lui comme le pendant des « histoires
tragiques » alors en vogue pour leur pathos et leur recherche d’effet, ressemblait désormais
davantage à un roman de mœurs et d’amour.
En 1633, un nouvelle et dernière version, attribuée par supercherie au romancier défunt
Moulinet du Parc, s'enrichissait d'un douzième livre, procédant de la scission du onzième,
gonflé de nouvelles péripéties. Le texte, à nouveau très remanié, avait été truffé de
commentaires moralisateurs et de discours critiques suggérant une nouvelle relation,
métadiscursive, de l'auteur avec son œuvre : bientôt d’ailleurs, Sorel récusera explicitement la
paternité du Francion. De l'énonciation à la première personne, envahissante dans la version
de 1623, en passant par la narration plus objective qui caractérisait l'allongeail de 1626,
jusqu'à cette inflexion vers le commentaire critique intégré à la fiction en 1633, une relation
toujours plus distante entre l’auteur et son ouvrage s’établissait, signalée par l'attribution

2
apocryphe à Moulinet du Parc et la dédicace du volume par celui-ci à Francion, donné pour
l'acteur réel des fictions rapportées alternativement par lui-même et par le narrateur.
Bref, le Francion est un texte instable : par sa structure évolutive ; par sa texture
perpétuellement corrigée (pas une phrase n’est exactement semblable d’une version à une
autre) ; par la posture de son auteur à l’égard de son ouvrage, qu’il semble répudier, et son
personnage, qui tantôt paraît lui avoir ressemblé, tantôt avoir incarné ses idéaux, tantôt n’être
qu’une création de papier et de jeu.
2. Une instabilité auctoriale
Cette instabilité du rapport de l’auteur à son texte entraîne par contrecoup celle du moi
écrivant, celle de la personne de l’écrivain, dont la représentation renvoyée par son œuvre se
diffuse elle aussi en un jeu de plans kaléidoscopiques, tout comme l’ouvrage se métaorphose
au fil de ses réécritures capricieuses. L’auteur de cette œuvre palimpseste se diffuse en un moi
tout aussi instable qu’elle, à la fois évolutif et polymorphe. Evolutif, du jeune libertin d’à
peine plus de vingt ans à l’auteur assagi qui dix ans plus tard est en marche vers un poste
d’historiographe royal (il hérite la charge en 1635) et semble prendre toujours plus de distance
envers son ouvrage. Polymorphe, car il passe du statut d’auteur occulté à juge et critique d’un
ouvrage dont il récuse la paternité, tout en affectant que Francion est une personne réelle qui a
dicté à un romancier entretemps disparu le récit de sa vie. Si la dernière version est intitulée
La vraye histoire comique de Francion, ce n’est pas parce que Sorel prendrait parti pour un
processus conformiste d'amélioration de l'œuvre au fil des réimpressions. Mais parce qu’une
fiction d’invention la donne pour « composée par Nicolas De Moulinet, Sieur du Parc,
Gentilhomme Lorrain. », « amplifiée en plusieurs endroicts, et augmentée d'un Livre, suivant
les manuscripts de l'auteur » et ouverte par une lettre « A Francion » :
Cher Francion, a qui pourrois-je dedier votre Histoire qu’a vous mesme ? […] Je ne doute
point que si vous eussiez voulu prendre la peine de mettre par escrit vos avantures, au lieu que
vous vous estes contenté de me les raconter un jour de vive voix, vous eussiez fait toute autre
chose que ce que j’ay fait, mais je ne veux point entrer aussi en comparaison avecque vous.
6
Bref, voilà une vérité qui repose sur trois supercheries : l'attribution du Francion à du
Parc mort opportunément huit ans plus tôt ; l’attribution à Francion de la vie réelle que le
roman lui prête ; et la fiction de la découverte posthume d'une suite inédite aux onze livres
déjà parus. Le dédale des justifications dans lesquelles s'engage l'« Avis aux lecteurs touchant
l'auteur de ce livre » n'a rien à envier aux aventures contées par le nouveau livre ajouté par
cette édition : signe de la connivence entre les pôles fictionnel et critique, si la critique tend à
envahir la fiction au sein du texte, la fiction se déverse aussi allègrement dans le métatexte
critique. Au point d'emporter dans son flux l'identité de l'auteur. À Francion palimpseste ne
pouvait que répondre un Sorel pseudonyme, un Sorel qui d'ailleurs n'a jamais signé qu'une de
ses œuvres et s'est masqué toujours derrière les jeux de la feinte attribution et de la
supercherie à demi-révélée.
Et l’inventivité critique n’en reste pas là. Dans La Science universelle (1641), reprenant et
augmentant un jugement déjà paru dès 1634 dans La Science des choses corporelles, Sorel
loue les « embellissements » qu'aurait apportés Moulinet du Parc à une œuvre dont l'original
« n'estoit pas fort gros en son commencement, & avoit beaucoup d'imperfections », pour avoir
été composé sans doute par plusieurs écrivains, du Souhait, du Rosset ou du Verdier,
qu'auraient ensuite rejoint « d'autres personnes que les premiers Auteurs » : à preuve
« l'inégalité du style » de l'ouvrage, indice certain « que plusieurs y ont travaillé
7
». Cette
fiction se poursuit dans La Bibliothèque française (1664, 16672), où Francion est analysé par
deux fois : d'abord dans la rubrique « Des Romans comiques, ou Satyriques, & des Romans
burlesques », où l'on excuse son irrévérence par les libertés permises à l'époque déjà ancienne
de son invention (1667) ; puis parmi les « Livres attribuez à l'autheur de la Biblothèque

3
françoise », c’est-à-dire Sorel, pour y être désavoué au profit de l'attribution fictive à du Parc,
associée à la suggestion persistante d'une rédaction collective. Il suggère même à quelque
« Ecrivain adroit » de remettre Francion sur le métier :
…il vaudroit mieux oster de ce Livre ce qui peut causer du scandale, sans se soucier des Gens qui
ne le trouveroient plus à leur gré. S'il est mal-aisé de retrancher des choses qui sont enchaisnées
avec d'autres & qui en composent la suite, un Escrivain adroit en pourroit pourtant supposer
d'autres, qui seroient aussi à propos, & qui au moins ne seroient point sujettes à la Censure.
8
La métamorphose de l'œuvre en sujet d'évaluation critique entraîne la transfiguration de son
auteur passé par toutes les identités possibles jusqu'à l'anonymat d'un « repreneur » potentiel :
le processus de création perpétuelle a enveloppé l'auteur dans la contagion fictive de son
principe génétique.
Ainsi, ce n’est pas dans son personnage que se projette Sorel, mais dans son œuvre, dans le
processus de création et de réception de son œuvre, où l’unité de son moi d’auteur se disloque
en une posture multiforme. Il y a là un prolongement du rapport ludique de Cervantès avec
Don Quichotte, mais démultiplié. L’instance auctoriale explose et le concepteur d’une œuvre
en devient aussi le récepteur, l’évaluateur, voire le contempteur au sein tantôt du texte, tantôt
du paratexte, tantôt des péritextes. D’où Sorel tire occasion de donner en acte de manière
étonnamment moderne à nos yeux une analyse décomposée de la relation d’un texte à son
principe de composition et à l’agent de celle-ci, en déconstruisant la notion d’auteur et en
construisant dans sa complexité le modèle d’une instance éclatée
d’écrivain/lecteur/critique/personnage.
3- Un personnage décomposé
Parallèlement à la dissolution du sujet écrivant dans une instance auctoriale multiforme et
fictionnelle, on assiste à celle du personnage éponyme : espèce d’Arlequin de la narration,
Francion dissout lui aussi son moi de personnage dans un jeu de miroirs à la cohérence
éclatée. Dès l’origine, il est instable : par son statut social, sa philosophie et son caractère. Il
ne cristallise pas vraiment en personnage cohérent, il est ouvert, comme l’œuvre à laquelle il
donne son nom et dont il dessine l’imprévisible trajet. C’est un prisme social, tantôt miséreux,
tantôt favori du roi, tour à tour écolier et salonnard, bel esprit et duelliste, acteur et fourbe,
marqué par un double emblème : celui d’un singe mystificateur et imitateur qui, dès sa petite
enfance, l'avait barbouillé et vêtu à la surprise épouvantée de sa nourrice. Et puis l’emblème
aussi d’un rêve durant lequel il se voit, nous raconte l’ouvrage, chutant dans un bassin rempli
d’âmes pour en ingérer cinquante mille : image projetée de la création littéraire, de l'invention
mue par l'imagination.
C’est qu’en effet un autre fil rouge que celui de la désillusion, du déguisement, de la
mystification parcourt le texte : celui de l'œuvre d'art, réelle ou imaginaire, intégrée, évoquée,
voire citée dans le cours du texte, celui de la littérature imaginaire composée autour de
Francion et par lui. À l'origine, le jeune collégien se révèle grand lecteur de romans de
chevalerie et d'amours pastorales. Puis la fréquentation des gens de lettres éduquant à la fois
son goût et son jugement, on le voit exercer sa plume tour à tour dans le livret de ballet,
l'éloge circonstancié et le blâme satirique. Confidence inattendue, il avoue avoir versé dans
cette satire le fiel accumulé contre les auteurs de ses déconvenues de poète méconnu et
d’ambitieux éconduit, et s’en être trouvé apaisé :
Si je n’eusse jetté les fougues de ma colere sur le papier, je fusse tombé dans un desespoir le
plus violent du monde. Voyez de grace quel enchantement. N’est-il pas estrange, et ne me
guerissoit il pas contre la Reigle naturelle ? Apres avoir descrit mon mal , je ne le sentois plus si
violent, encore que j’en apperceusse les plus vifs accez naifvement representez.
9
On sent derrière ces lignes cette chaleur d’enthousiasme qui poussera le héros, parvenu à
meilleure fortune et réconcilié temporairement avec l’humanité, mais exalté alors par son

4
bonheur, à composer lui-même, semble-t-il, pour voix accompagnée de luth les vers que
produit le texte durant le récit de l'orgie chez son protecteur. En assumant la paternité d'un
poème qui fait en même temps partie du texte dont lui-même est issu en tant que créature de
fiction, Francion participe fictivement à la rédaction de la fiction dont il est le héros,
Une autre étape est franchie quand Sorel prête à son héros, sous forme d'annonce, le projet
de ses futurs livres : celui de La Science universelle dont la première partie allait paraître un
an après le dernier Francion, celui de L'Orphise de Chrysante, elle déjà composée et publiée
en 1626, du Berger extravagant, de même date, et de La Maison des jeux à venir. Enfin,
Francion est donné, au livre XI pour auteur du livre que lit son lecteur, ou plutôt qu'il a lu en
1623 : une Jeunesse de Francion, aussitôt désavouée qu'avouée par son protagoniste comme
une erreur de jeunesse, justement — « petites sottises de son enfance » (p. 437). Le même
ouvrage ou presque est plaisamment évoqué aussi dans l'Avis au lecteur de 1633, mais sous le
titre des Jeunes Erreurs, et présenté alors comme imputable au pseudo Moulinet du Parc…
Ces jeux de miroir et de facettes culminent avec le projet d'un Livre sans titre qui semble le
point aveugle de ce montage optique, l’angle de restitution de ce tableau anamorphotique : un
ouvrage qui est présenté comme « fantasque », qui serait écrit et pourtant encore à venir, et
qu’introduirait une épître dédicatoire Aux Grands qui est en réalité celle de la version de 1626
réinscrite dans le roman de 1633 — effet d'abyme vertigineux et pourtant exact : car, de fait,
le Francion de 1626 est sinon un livre sans titre, du moins un livre sans existence autonome,
absorbé par la nouvelle version de 1633.
Cet effet prismatique répercute sur le statut du personnage sa polymorphie. Le caractère
polyfacétique de ses rôles et de ses masques, la diversité de ses statuts et de ses réactions,
l’invraisemblance et la diversité de tonalité et de registre des situations et des actions, tantôt
facétieuses, tantôt romanesques, tantôt érotiques ou héroïques, sont jetées dans un récit dont
l’énergie cinétique, la vivacité de déroulement emportent l’adhésion du lecteur de Francion
sur la question rien moins que douteuse de la vraisemblance et de la cohérence du héros
éponyme : la succession des plans qui nous le montrent tour à tour gueux et noble, filou et
généreux, menteur et franc, débauché et épris, n’est pas unifiée par une logique supérieure
d’évolution psychique et philosophique construite, revendiquée, fondée sur la comparaison
entre les phases et les évolutions, les retours en arrière, les conversions qui seraient après tout
légitimes chez un jeune homme suivi du berceau à l’orgie de la vie adulte. Sorel n’a pas
souhaité signer ce contrat de vraisemblance, celui du réalisme moderne conférant une
psychologie à son personnage majeur. Il entend apparemment ce qu’il appelle « naïveté » tout
autrement que notre réalisme, contrairement aux apparences : comme une confiance faite au
mouvement pour assortir les plans successifs et disparates de son récit. Tout va si vite que,
comme au cinéma, l’image s’anime sans qu’on s’interroge sur son relief. Francion en tire sa
crédibilité tout en accréditant par sa parole et sa personnalité la crédibilité des récits qu’il fait,
par un jeu de tautologie qui s’impose à l’imagination séduite du lecteur qu’étourdit ce
bariolage de voix et de (points de) vue.
On imagine bien d’où auront procédé cette technique et cette esthétique : de l’influence
exercée par le modèle picaresque sur la conception du roman, auquel Sorel le réfère d’ailleurs
explicitement à la fin du livre III :
Ignorez vous que ces actions basses sont infiniment agreables, et que nous prenons mesme du
contentement à oüyr celles des gueux et des faquins, comme de Guzman d’Alfarache et de Lazaril
de Tormes ?
10
Mais en poussant Francion jusqu’au marquisat, Sorel tentait un pari plus risqué,
invraisemblable, aux limites de l’incohérence sociale et intellectuelle. Cette naissance lui
permettait de propulser son personnage jusqu’aux plus hautes sphères de la société, de le faire
vivre à la cour, parler au roi, traverser tous les milieux de haut en bas de l’échelle sociale :

5
bref, de promener à travers les yeux de Francion notre regard partout et jusqu’où un regard de
pícaro interlope n’aurait pu accéder ou du moins se maintenir.
Du paria picaresque, Sorel a ainsi récupéré de quoi faire de Francion un joker, une carte du
jeu social sans assignation spécifique, propre à toute fonction dans le jeu du roman et de la
société. Passeur universel et passe-muraille, entremetteur esthétique et éthique, relais du
regard de l’auteur et du lecteur sur le spectacle du monde, transversal par rapport au flux des
événements et des scènes qu’il filtre et commente, Francion est l’Autre du roman, le signe
neutre que l’on peut interchanger, sémaphore et sismographe répercutant toutes les nuances
de caractère et de mœurs, revêtu de toutes les parures sociales, parce que son statut de
narrateur l’extrait par essence (alors que ses modèles ibériques s’en extrayaient par naissance)
de la toile bien tissée de l’organisation sociale, morale et même religieuse. Il s’en fait le
prisme et relaie le regard du romancier et du lecteur sur le réel perçu avec cette « naïveté »
qui, d’un autre côté, prive le personnage d’un for intérieur, d’une cohérence d’âme et de
caractère, donc de sa vraisemblance. C’est ce statut prismatique construit dans et par la
narration qui rejoint le statut de l’auteur déconstruit par les fictions éditoriales qu’a imaginées
Sorel : ainsi s’assortissent instance narrative et instance narrée, l’auteur entrant un peu en
fiction et le personnage décalquant l’activité d’invention, de telle manière que leur
connivence se noue sous la forme d’un éclatement du moi de Sorel, d’un éparpillement du
moi de Francion, utilisés pour penser la littérature romanesque moderne qu’ils sont en train
de fabriquer en l’éprouvant. Il y a un côté Faux-Monnayeurs avant Gide dans l’entreprise
étrange de mise à l’épreuve de la fiction narrative par cet ouvrage étrange et méconnu.
*
Le Page disgracié, une fiction de soi ?
1. Entre autobiographie, histoire comique et roman héroïque
Autre exemple de rapport complexe noué entre le moi d’un créateur et celui du personnage
éponyme d’une fiction narrative, Le Page disgracié de Tristan L’Hermite raconte à la
première personne, des origines à ses dix-huit ou dix-neuf ans, la vie, tantôt fidèle à la réalité,
tantôt notoirement imaginaire, d’un Page dont la personne et l’existence prétendent se
confondre avec celles de son auteur
11
. Le récit est constitué de deux parties, terminées sur la
promesse de commencer des mémoires de la vie adulte de Tristan, qui en fait ne verront
jamais le jour. La première partie du Page comprend d’abord, en préambule, un récit
d’enfance qui correspond à une réalité : le jeune François de L’Hermite, avant de se pseudo-
nommer Tristan, a en effet vécu à la cour d’Henri IV comme page d’un des bâtards du roi, le
duc de Verneuil. Pour combler les vides d’un récit d’enfance évidemment assez pauvre en
événements notables, le romancier a truffé ces pages de facéties empruntées au modèle des
vies de collégiens et aux récits piquants de « postiqueries » ou niches enfantines et
adolescentes qui ridiculisent divers personnages gravitant à la cour. Bâti sur le modèle
littéraire et poétique de la « mauvaise vie », l’adolescente mal guidée et mal influencée du
jeune garçon se perd ensuite dans le vice, le jeu, l’erreur, l’étourderie, bref, la vanité des
choses. Son sang trop bouillant le conduit à tuer un homme qui l’a bousculé. Pour échapper à
la « disgrâce » qui l’attend, le Page qui cesse de l’être fuit sous le faux nom d’Ariston
jusqu’en Angleterre, après avoir rencontré dans une auberge à Rouen (cadre picaresque
traditionnel) un alchimiste dont il attendra vainement le retour pour espérer de lui la fortune,
autre emblème de vanité.
En Angleterre, il connaîtra une passion partagée avec la fille de son hôte, une belle
anglaise sans nom ni prénom, que la jalousie d’un rival fera accuser le Page d’avoir tenté de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%