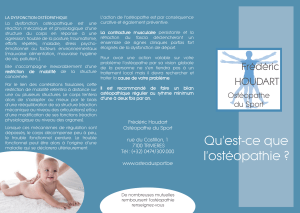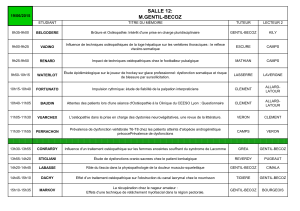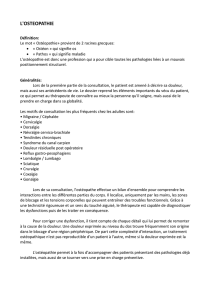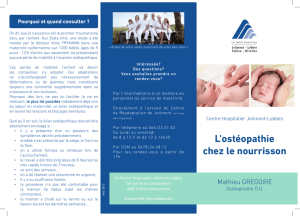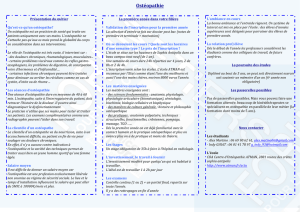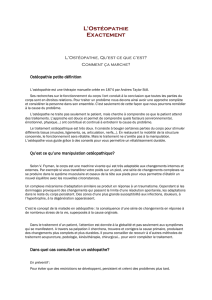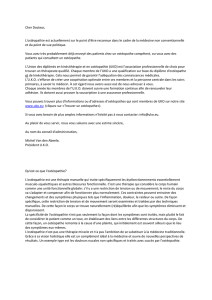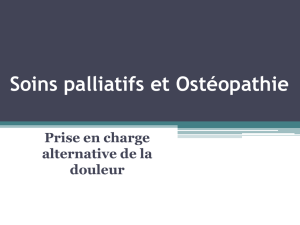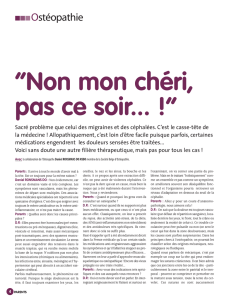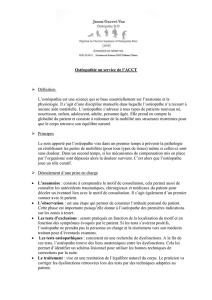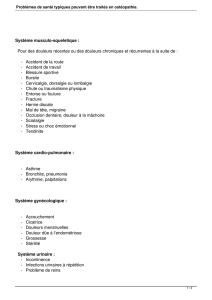la FMC - Amejjay

dossier
L’ostéopathie
Les Premières Journées mondiales de médecine manuelle
ostéopathique s’ouvrent aujourd’hui à Toulouse dans le
contexte de la reconnaissance de la profession par la loi du 4
mars dernier, relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
PAR LES DRS PHILIPPE HUMBERT, FRANÇOIS LE CORRE,
DIDIER FELTESSE, CHRISTIAN JEAMBRUN, JEAN-JACQUES LOBEL
la FMC
du généraliste
vendredi 20 septembre 2002 n°2217
Raguet /Phanie
cahier détachable
objectifs
> Les principes d’action de l’ostéopathie p. 2.
> Les indications p. 3 et p. 4.
> Ostéopathe : médecin ou non médecin ? p. 4.
> Comment agit l’ostéopathe
sur le rachis lombaire et l’épaule p. 5 à 8.

numéro 2217 vendredi 20 septembre 2002
2
Le fondateur de l’ostéopathie, Andrew Taylor
Still, est américain. Il naît le 6 avril 1828 en
Virginie. L’idée de médecine holistique lui vient,
pendant la guerre de Sécession, alors qu’il n’a pour
soigner que sa foi, son cœur et ses mains : il a la
révélation de la perfection du corps humain dans
ses dimensions structurelles, fonctionnelles et psy-
chologiques, toutes trois interdépendantes et ne
formant qu’un tout harmonieux définissant la santé.
Cette perfection inclut la capacité d’autorégula-
tion et d’autotraitement face à la maladie.
Pour Still, l’homéostasie corporelle est subordon-
née à l’intégrité anatomique et dynamique des struc-
tures, en particulier à l’intégrité physiologique de
l’appareil musculo-squelettique. Il baptise sa disci-
pline « ostéopathie », soulignant ainsi le lien qu’il
établit entre os et pathos. L’os est l’élément consti-
tutif dominant de la structure, à la fois repère
diagnostique (par sa position et sa perte de mobi-
lité) et levier thérapeutique essentiel pour redonner
la liberté de mouvement. Pathos désignant alors
dans son esprit toute perturbation de la fonction.
Du coup, la structure dominant la santé devient
synonyme de liberté de mouvement. Et la lésion
ostéopathique, appelée aujourd’hui « dysfonction
somatique », peut se définir comme la dégrada-
tion ou l’altération fonctionnelle des éléments cons-
titutifs du système somatique
(squelettique, myofascial, viscéral, vasculaire,
lymphatique et nerveux) en rapport avec celle-ci.
LES DIFFÉRENTS LIENS
Toute anomalie de la structure, toute perte de
mobilité articulaire ou tissulaire retrouvée à l’exa-
men clinique risque de retentir sur une ou plusieurs
fonctions, localement ou à distance, et s’inscrit dans
un véritable cercle vicieux auto-entretenu mena-
çant le fonctionnement harmonieux du tout. La
notion de liens vient expliquer l’influence potentielle
de chaque partie du corps sur le tout.
Le lien mécanique
L’ostéopathe, par son approche de la régulation
posturale, des chaînes articulaires et musculaires,
s’efforce de replacer toute dysfonction articulaire
(augmentation de chaleur, de volume, déformation,
etc.) dans un schéma beaucoup plus général. On
parle de lésions primaire et secondaire, de lésion de
groupe, d’une zone charnière ou victime, de lésion
totale. Ainsi un blocage de l’astragale retentira sur
la fonction de la cheville mais aussi sur le fonc-
tionnement du genou, de la hanche, du bassin, du
rachis, etc. ; autant de conséquences qu’il faut pren-
dre en charge au même titre que la lésion primaire.
Le lien neurologique
La neurologie classique décrit des douleurs viscé-
rales projetées dans les radiculalgies. L’ostéopa-
the connaît bien ces réflexes viscéromoteurs ayant,
à distance de l’organe qui souffre, un retentissement
musculo-squelettique (douleur interscapulaire chro-
nique de certains ulcères de l’estomac, par exem-
ple).
Le lien fluidique
Selon Still, comme la terre, notre organisme est
irrigué, pour se nourrir, de différents fluides ayant
chacun son débit et son rythme que l’ostéopathe
doit savoir appréhender : la circulation artério-
veineuse soumise au rythme cardiaque, la circula-
tion aérienne au rythme respiratoire, le liquide
dossier fmc l’ostéopathie
Les grands principes
L’ostéopathie est une science, mâtinée de philosophie, visant à la régulation
et à la correction du fonctionnement musculo-squelettique. La loi du 4 mars 2002,
en la reconnaissant comme « discipline médicale », l’introduit dans l’arsenal
diagnostique et thérapeutique médical classique.
DRPHILIPPE HUMBERT*, DRFRANÇOIS LE CORRE**
* Membre de
l’École française
d’ostéopathie.
Toulouse.
** Président du
Gemmif (Groupe
d’enseignement de
médecine manuelle
d’Ile-de-France.
Paris).
De A.T. Still à la loi de 2002
L’ostéopathie s’est développée en
France grâce à deux voies L’une
rationaliste et scientifique, sous l’im-
pulsion du Pr Robert Maigne, a permis
sa reconnaissance hospitalo-universi-
taire, au prix de l’abandon de ses
concepts philosophiques et de certai-
nes de ses techniques jugées scienti-
fiquement non valables ; l’autre, sous
l’impulsion de non-médecins formés
pour la plupart en Angleterre, relayés
par le Dr Didier Feltesse à la faculté de
médecine de Bobigny, restée plus
proche des concepts originaux, a été
longtemps rejetée par le corps médical
traditionnel. La loi du 4 mars 2002
autorisant l’usage du titre d’ostéopa-
the à ces non-médecins permettra-t-
elle, par la réflexion qu’elle suscite, une
synthèse de ces deux courants ?
Dr Jean-Jacques Lobel,
président du GETM
FMC

numéro 2217 vendredi 20 septembre 2002
céphalo-rachidien au rythme cranio-sacré, la
lymphe à un rythme beaucoup plus lent tout comme
les différentes sécrétions viscérales (d’où l’effica-
cité de l’ostéopathie pour traiter un œdème chro-
nique de cheville après entorse, ou prendre en
charge la composante mécanique des insuffisances
respiratoires).
Le lien psychosomatique
Grâce à la simplicité du rapport à l’autre qu’éta-
blit la main,le médecin ostéopathe perçoit en direct
la souffrance du corps. Il s’efforcera de libérer la
parole du corps en souffrance, afin que s’expriment
les mots enfermés sous les maux et qu’opèrent
parallèlement les techniques ostéopathiques de
détente.
LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
L’approche médicale classique reste la base
incontournable. L’approche générale ostéopathique
apprécie le tonus et l’équilibre postural avec ses
différentes portes d’entrée, ainsi que toutes les mobi-
lités articulaires et tissulaires.
>Pour chaque dysfonction somatique, on explore
l’ensemble des paramètres structuraux et fonc-
tionnels situés dans le métamère intéressé, le tissu
cellulocutané (couleur, chaleur, texture, sensibilité),
les muscles (souplesse, contracture, atrophie,
fibrose), les ligaments (rétraction, distension, sensi-
bilité), les articulations (douleur, épanchement,
restriction de mobilité, hyperlaxité, ressauts, bruits
anormaux), les viscères (sensibilité, volume, consis-
tance, rapports anatomiques), les vaisseaux (pouls,
œdèmes, syndrome canalaire), les nerfs (point
gâchette, syndrome canalaire, déficit sensitivo-
moteur ou réflexe).
>Cet examen palpatoire, riche en informations
sémiologiques, va de l’écoute, où la main délicate-
ment posée sur la structure en apprécie les varia-
tions de tension et de rythme (comme dans les tech-
niques cranio-sacrées), aux techniques beaucoup
plus appuyées de mobilisation forcée (mais toujours
indolore), en passant par des mobilisations très fines
à la recherche d’une restriction de mobilité d’une
articulation intervertébrale ou sacro-iliaque.
LE TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE TRADITIONNEL
Tout comme l’approche diagnostique, le traite-
ment ne se conçoit que de manière globale.
Certaines techniques s’adressent
aux tissus mous :
–la peau : techniques de massage et de mobilisa-
tion du tissu fibroconjonctif ;
–les muscles : techniques visant à détendre, assou-
plir, étirer (pression prolongée des points réflexes,
étirement passif, contracté-relâché, technique
neuromusculaire d’écrasement longitudinal, mise
au repos du muscle par raccourcissement passif
prolongé, décordage, massage transverse
profond) ;
–les fascias : étirements, postures, massages ;
–les ligaments : étirement, ponçage ;
–les viscères : pressions et mobilisations douces à
visée circulatoire, métabolique et mécanique ;
–le système circulatoire : pompages, techniques
crâniennes, drainage lymphatique.
Certaines techniques s’adressent
aux articulations
Elles visent une action de détente, de restitution
de mobilité, mais aussi une action réflexe dans
tout le métamère :
– manipulations avec impulsion (thrust) :ce sont
des maniements de haute
vélocité et faible amplitude,
qui produisent un craque-
ment ;
–manipulations dites physio-
logiques : un positionnement
passif des pièces osseuses en
situation lésionnelle exagé-
rée est suivi d’un lent retour
à la normale ; elles s’accom-
pagnent souvent d’une libé-
ration articulaire avec relâ-
chement musculaire et
atténuation de la douleur ;
–le strain counterstrain (Jones), qui consiste à
placer l’articulation en position antalgique la plus
neutre possible ; au bout de quatre-vingt-dix se-
condes, le retour à la position de repos se fait
lentement, en soixante secondes, pour obtenir la
levée de la contracture et l’antalgie ;
–les tractions axiales ont un effet de détente.
LES INDICATIONS CONSENSUELLES
Les indications de l’ostéopathie sont beaucoup plus
nombreuses que ses contre-indications. Elle peut
rendre service dans la plupart des syndromes
douloureux consécutifs à une dysfonction segmen-
taire vertébrale bénigne, ainsi que dans les pertur-
bations de la mobilité vertébrale existantes, bien
souvent d’ailleurs liées à la survenue d’une douleur
lors du mouvement. """
3
Les tests de mobilité
des membres inférieurs
font partie de l’examen clinique
ostéopathique systématique.
L’ostéopathie, médecine hygiéniste dès son ori-
gine, reprend à son compte toutes les propo-
sitions de la médecine préventive et propose
d’intervenir précocement sur d’éventuelles
lésions récentes, avant que ne se constituent
des enraidissements ou des détériorations plus
difficiles à traiter ultérieurement, grâce à une
surveillance régulière.
La prévention
par l’ostéopathie
D.R.
FMC

"""Font l’objet d’un consensus :
–toutes les affections mécaniques de la colonne
vertébrale à savoir : les lombalgies chroniques
liées à une dysfonction somatique située sur les
étages lombaires inférieurs (en particulier L4-L5
ou L5-S1), ou à une souffrance de la jonction
thoraco-lombaire, ou à une dysfonction sacro-
iliaque ; les lumbagos aigus ; les douleurs dorsa-
les primaires ou secondaires à une souffrance
cervicale ou lombaire ; les cervicalgies chroniques
ou aiguës (torticolis) ; les épiphysites de croissance
(ou maladie de Scheuermann) ; les coccygodinies ;
les douleurs projetées d’origine vertébrale (refe-
rred pains), soit au niveau des membres, soit au
niveau viscéral (voir ci-contre) ;
–les affections consécutives à une atteinte arti-
culaire périphérique, à savoir : entorses du genou
et de la cheville ; tendinites, capsulites et,plus tard,
périarthrites post-traumatiques de l’épaule (ne
pas oublier, pour ces dernières, la fréquence des
« épaules réflexes » d’origine cervicale) ; les
épicondylites (ou tennis-elbow) ; les affections
qualifiées de tendinites ou de musculaires au
niveau du bassin (pubalgie, maladie des adduc-
teurs), du genou (partie interne, externe parfois
rotulienne), de la cheville, du talon et du pied, du
poignet, etc. ; les névralgies d’origine mécanique
consécutives à une souffrance uniradiculaire
(cruralgie, sciatique, névralgie cervico-brachiale,
névralgie intercostale, syndrome d’Arnold ou
fémoro-cutanée, ou encore pluriradiculaire diffuse,
voire plexique) ;
–au niveau du crâne : les céphalées (après avoir
éliminé une cause médicale grave, secondaire à
un processus tumoral ou infectieux, à une hyper-
tension artérielle, à une maladie systémique, etc.),
les douleurs de la nuque irradiant vers les tempes
ou vers le front, les douleurs occipito-sus-orbi-
taires irradiant à l’angle interne de l’orbite ou
derrière les globes oculaires, les pesanteurs ou
douleurs au sommet du crâne provoquées par
un travail de bureau, etc. ; les troubles de l’équi-
libre ou faux vertiges ; les dysfonctions de l’arti-
culation temporo-mandibulaire.
LES INDICATIONS POSSIBLES
Les manœuvres ostéopathiques peuvent également
être appliquées à de nombreuses et diverses affec-
tions, : les enraidissements post-fracturaires ; les
enraidissements et déformations de maladies rhu-
matismales (observés, par exemple, dans la pel-
vispondylite rhumatismale, la polyarthrite rhuma-
toïde ou autres collagénoses) ; les insuffisances
respiratoires, asthmatiques, emphysémateuses, obs-
tructives (le traitement manuel permet d’augmen-
ter significativement le volume d’air courant et de
lever les épines irritatives d’origine pleurale parié-
tale) ; les sinusites chroniques récidivantes et aut-
res affections ORL ; certains syndromes gynécolo-
giques, digestifs ou affections circulatoires, etc.
Une minorité de praticien recourent aux techniques
dites cranio-sacrées, souvent efficaces chez les
nourrissons et les enfants, en particulier pour cor-
riger les désordres cranio-faciaux.
numéro 2217 vendredi 20 septembre 2002
dossier fmc l’ostéopathie
4
Ce qui fait débat
Ostéopathe : médecin ou non-médecin ?
L’article 75 de la loi relative aux droits
du malade, votée cette année, autorise l’usage
du titre d’ostéopathe et de chiropracteur
à des praticiens non médecins.
Les décrets d’application de cette loi, pas encore publiés
à l’heure actuelle, devront préciser la formation requise
et le champ d’action de ces praticiens. Quelle que soit
la teneur de ces décrets, cette nouvelle loi aura le mérite
de réglementer et de clarifier une situation antérieure où
de nombreux non-médecins pratiquaient l’ostéopathie
dans l’illégalité la plus totale, sans aucune garantie pour
les patients. Les ostéopathes ou chiropracteurs non
médecins, reconnus par cette nouvelle loi, auront donc
certainement une formation valable sur les techniques
ostéopathiques. Compte tenu de cette nouvelle situation,
faut-il adresser vos patients à un ostéopathe médecin
ou non médecin ?
La réponse à cette question réside essentiellement
dans le problème du diagnostic. En effet, le diagnostic
ostéopathique, à la recherche des modifications de mobilité
ou de consistance ostéo-articulaires et tissulaires, ne suffit
pas à assurer une prise en charge complète du malade.
Devant la plainte de ce malade, le praticien doit en effet être
capable d’établir un diagnostic médical complet, surtout
de réévaluer et de remettre en question ce diagnostic
à chaque consultation, en fonction de l’évolution de
DOULEURS
PROJETÉES
La souffrance
d’un étage
vertébral
a la particularité
d’entraîner des
douleurs cutanées
associées à
une modification
du pli cutané dans
le dermatome
correspondant.
Ces fausses
douleurs
viscérales peuvent
égarer
l’examinateur
qui n’aurait pas
pris la précaution
d’analyser le pli
cutané entre
le pouce et
les autres doigts
(fausse
appendicite,
fausse douleur
vésiculaire,
pseudo-colite,
pseudo-douleur
ovarienne...).
FMC

LE PATIENT LOMBALGIQUE
La lombalgie n’est pas une maladie mais un symp-
tôme. L’Anaes insiste sur l’importance de l’évalua-
tion initiale du patient lombalgique. Il est indispen-
sable de s’assurer avant toute chose qu’il n’existe
pas une affection grave sous-jacente (tumorale,
infectieuse, inflammatoire ou traumatique). Ces
pathologies graves, qui nécessitent la prescription
d’imagerie et d’examens biologiques, représentent
à peine 10 % des causes de lombalgies. Sinon, il
s’agit de lombalgies communes, que l’ostéopathe va
pouvoir prendre en charge.
Toutes les études convergent pour prouver, lors-
qu’elles sont bien faites, l’efficacité des manipula-
tions dans la lombalgie aiguë. Le Pr Robert Maigne,
qui a fait passer la manipulation du stade de « rebou-
tement » à un acte médical, décrit la manipulation
vertébrale comme « une impulsion d’environ un
dixième de seconde sur un segment mobile dans une
direction précise donnée par un médecin compétent
après verrouillage des segments sus- et sous-jacent
et mise en tension préalable des muscles. Cette
manipulation doit respecter la règle de la non-
douleur et du mouvement contraire ». Elle s’adresse
surtout au spasme musculaire à l’origine """
numéro 2217 vendredi 20 septembre 2002 5
Deux motifs de consultation
La prise en charge de la lombalgie et de la dysfonction humérale antérieure
sont deux recours classiques à l’ostéopathie. Les principes diagnostiques
sont communs à la médecine traditionnelle. Les techniques manuelles
thérapeutiques sont multiples et soucieuses du primum non nocere.
DRDIDIER FELTESSE*, DRCHRISTIAN JEAMBRUN**
* Directeur du DIU
d’ostéopathie
de l’université
de Bobigny. Avec
la collaboration
de l’Association
des médecins
ostéopathes
de France.
** Toulouse.
la symptomatologie et de l’examen clinique.
C’est seulement à cette condition que peuvent être dépistées
des pathologies plus ou moins graves, mais dans lesquelles
la prise en charge ostéopathique est insuffisante, voire
contre-indiquée (pathologies tumorales, rhumatismales
inflammatoires, endocriniennes, psychiatriques,
cardio-pulmonaires essentiellement).
Seul le médecin est apte, par sa formation théorique
et son expérience pratique, à garantir cet indispensable
diagnostic médical complet. Sinon, à quoi serviraient
les études de médecine ?
En fait, l’idéal pour la sécurité, des patients serait
que tous les ostéopathes soient médecins,
comme aux Etats-Unis. A défaut, et puisqu’il faut bien
s’accommoder de la situation actuelle,
nous pouvons proposer l’attitude suivante.
Pour ce qui ne relève pas de la maladie, mais plutôt
du confort ou du mieux-être, vous pouvez adresser votre
patient à l’ostéopathe non médecin. On retrouve ici
une situation similaire à la thalassothérapie, par exemple,
et on peut imaginer qu’il suffira alors d’un contrôle médical
préalable afin de s’assurer de la non-contre-indication
à l’ostéopathie.
Pour ce qui relève d’une pathologie, un diagnostic médical
préalable est, bien sûr, indispensable. Vous pouvez établir
vous-même ce diagnostic et assurer le suivi médical,
en confiant le traitement ostéopathique à un ostéopathe
non médecin. Cependant, si vous n’êtes pas bien informé
des indications et des modalités de l’ostéopathie,
il est préférable d’adresser votre patient à un collègue
médecin ostéopathe. Celui-ci assurera le suivi diagnostique
et la prise en charge ostéopathique de votre patient,
en vous tenant informé de ses constatations médicales.
Grâce à ce respect mutuel des compétences de chacun,
nous pourrons ainsi dépasser les querelles et polémiques
entre les différents intervenants, pour assurer au patient
une sécurité optimale.
DRJEAN-JACQUES LOBEL
(président du GETM [Groupe d’étude
des thérapeutiques manuelles], Mézières-sur-Seine [78]
D.R.
Manipulation lombaire
en rotation.
FMC
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%