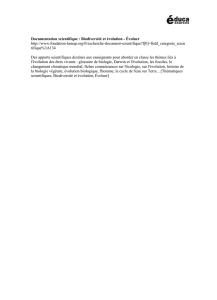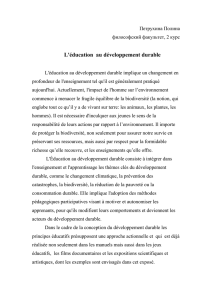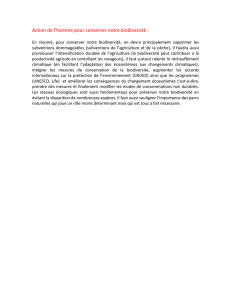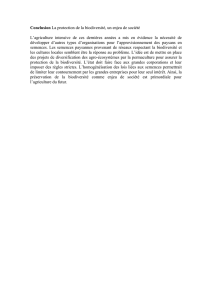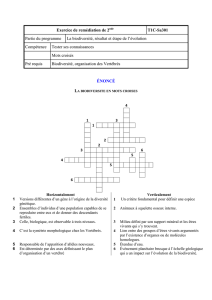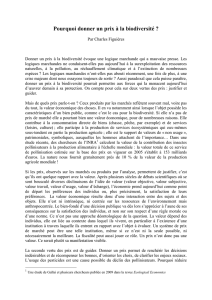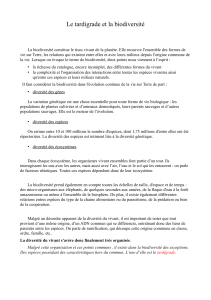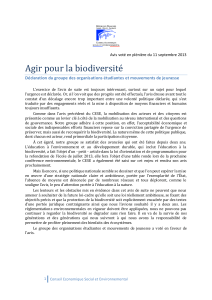Biodiversité et développement durable

Biodiversité et développement
durable : la recapitalisation
écologique, un nouvel objectif
politique
Bernard Chevassus-au-Louis, Anne-Marie Ducroux
Introduction
Comme le rappelle l’article 1er de la loi Grenelle I, la préservation de la biodiversité s’ins-
crit dans une ambition globale de développement durable : ainsi, la Stratégie nationale
pour la biodiversité, présentée en février 2004 par la ministre de l’Écologie et du Déve-
loppement durable, Roselyne Bachelot, a été conçue comme une composante « secto-
rielle » de la Stratégie nationale du développement durable que le gouvernement français
avait adoptée en juin 2003. Nous souhaitons donc, cinq ans après, revisiter les liens entre
ces deux notions et préciser la place et l’importance de cet enjeu de la biodiversité au sein
des défis du développement durable.
Rappelons tout d’abord que la notion de développement durable introduit deux idées
nouvelles et complémentaires par rapport à la notion de croissance, au sens économique
du terme : d’une part, ce développement ne doit pas compromettre la possibilité, pour les
générations futures, de bénéficier des mêmes « atouts » et libertés de choix que ceux qui
fondent le nôtre aujourd’hui ; d’autre part, il convient de prendre en compte non seule-
ment la croissance économique (augmentation de la richesse moyenne, mesurée par le
fameux PIB) mais également des améliorations sociales et culturelles (éducation, réduc-
tion des inégalités, santé) et une bonne gestion de l’environnement (conservation, voire
développement du « patrimoine naturel »). Même si ces trois dimensions du développe-
ment ont des contenus différents, en interactions, il est possible d’en donner une lecture
à travers la notion de « capital », fondement mais également résultante d’un processus
25
portée pratique de telles affirmations soit aisée à dégager. Mais la doctrine juridique s’est
plu à relever dans la charte la présence de tels « objectifs de valeur constitutionnelle » :
ces derniers autoriseront plus tard le législateur à porter atteinte en leur nom à des
principes traditionnels, comme le droit de propriété, et favoriseront donc, mais sans les
imposer, des politiques de protection de la biodiversité plus efficaces. ! ! !
Humanité et biodiversité

27
d’années, par l’activité des êtres vivants pour fonder son développement économique
depuis le xixe siècle. Mais cette utilisation massive s’est faite à notre avis avec une concep-
tion des ressources du vivant fondée sur trois croyances dont on perçoit aujourd’hui le
caractère erroné : celle de l’abondance, celle de la gratuité et celle de l’indépendance.
Croyance dans l’abondance, tout d’abord : dès lors qu’elles étaient renouvelables, il
était naturel de considérer ces ressources comme inépuisables et il est vrai que les pré-
lèvements de l’homme vis-à-vis de ressources accumulées au cours du temps ont
longtemps été marginaux. Ainsi, alors que le xixe siècle est souvent associé au dévelop-
pement des grandes pêches, on estime que le total des pêches mondiales n’était, en
1850, que d’environ 2 millions de tonnes. Ce total n’était encore que de 18 millions de
tonnes en 1950, alors qu’il est aujourd’hui supérieur à 90 millions de tonnes et qu’il a
sans doute dépassé, pour de nombreux stocks, les quantités exploitables durablement. En
outre, certains stocks vivant à grande profondeur (des espèces comme les grenadiers)
n’étaient pas exploitables avec les techniques disponibles dans les années cinquante et
leur mise en exploitation dans les années soixante-dix a pu donner l’impression de véri-
tables, mais éphémères, pêches miraculeuses. Les débats actuels sur la pêche montrent
bien la difficulté qu’ont de nombreux acteurs à admettre, pour des raisons économiques
et sociales, ce caractère limité d’une ressource environnementale.
Croyance dans la gratuité, ensuite : à travers la notion juridique de res nullius (« qui
n’appartient à personne »), la biodiversité ne se voyait reconnaître de valeur que si un lien
de propriété ou de production lui était attaché, ce qui rendait le vivant « non commercial »
appropriable par quiconque mais néanmoins sans coût, ni autre forme de valeur (le cas
des pêches étant à nouveau un exemple emblématique de cette situation). En outre, ces
ressources étant supposées sans limites, leur prix ne pouvait légitimement intégrer que
les facteurs « rares » de production, à savoir les dépenses engagées par l’homme pour se
les procurer, les transformer et les mettre sur le marché. Comme l’efficacité technolo-
gique de l’homme a crû de manière impressionnante au cours de la révolution indus-
trielle, le prix de ces ressources a donc baissé progressivement, renforçant l’illusion de leur
abondance. Ce n’est que progressivement que s’est imposée l’idée qu’une exploitation ex-
cessive de ces ressources allait non seulement conduire à leur renchérissement mais in-
duisait pour la société des coûts indirects à moyen et long termes. Les grandes inondations
des Alpes du Sud au XIXesiècle – notamment celles de 1856, à l’origine de la loi de 1860
sur le reboisement des terrains de montagne – ont été l’un des exemples du coût de ce
que l’on n’appelait pas encore la perte de services écologiques. Mais ce n’est qu’à la fin
du xxe siècle que des études associant écologistes et économistes ont commencé à cer-
ner l’ampleur de ces pertes, en suggérant que la totalité des « services non marchands »
des écosystèmes pouvait représenter en fait une valeur supérieure à celle des produits ex-
ploités par l’homme. Ce que nous avons appelé le « paradoxe de la mise en valeur des
écosystèmes10 » – à savoir que la valeur totale des services rendus par un écosystème
fortement exploité par l’homme pouvait être inférieure à celle d’avant sa « mise en
Une société en mouvement ?Humanité et biodiversité
de développement : capital économique, capital humain et capital écologique consti-
tueraient donc globalement l’assise du développement durable.
Mais cette ambition de développement durable s’exprime à un moment de l’histoire de
l’humanité où la négligence de nécessités de long terme pendant des décennies a créé
des effets de plus en plus aigus au présent, qui nécessiteraient des réponses urgentes, et
au moment où d’autres urgences à relativement court terme apparaissent prégnantes et
pourraient inciter à remettre à des périodes plus favorables la prise en compte de ces
questions : en effet, l’évolution démographique de notre planète dans les quarante an-
nées à venir va induire une augmentation considérable de la demande de la production
alimentaire – sans doute un doublement – à laquelle s’ajoute la nécessité de s’affranchir
peu à peu de l’utilisation, omniprésente, des énergies fossiles, en recourant notamment
à une exploitation accrue de la productivité des écosystèmes (voir l’article d’Emmanuel
Delannoy). Cette « crise du moyen terme » peut donc conduire à reléguer au rang des
« postériorités » les enjeux du long terme.
Parmi les défis à la fois de court et de long termes, celui de la biodiversité apparaît cen-
tral. Néanmoins, la notion de crise de la biodiversité, même si elle a été exprimée comme
étant la « sixième extinction », peut difficilement prendre dans l’agenda politique la
dimension d’une véritable crise médiatisable nécessitant des mesures urgentes et spec-
taculaires, à l’image des crises sanitaires ou de la récente crise financière. Alors même que
son état menace d’entraîner bien des bouleversements dans les sociétés, elle s’appa-
rente plus à de multiples petits effondrements, dont beaucoup sont, hélas, invisibles et
silencieux, plus qu’à un effondrement global visuellement repérable. C’est pourquoi
présenter et faire reconnaître la biodiversité comme un fondement central du dévelop-
pement durable constitue un défi majeur qu’il convient de relever.
Pour ce faire, il nous semble nécessaire de revisiter les liens qu’ont entretenus les hu-
mains avec la biodiversité au cours d’un passé proche, en particulier depuis la révolution
industrielle, et d’examiner non seulement les usages mais aussi et surtout les représen-
tations de cette biodiversité qu’ils ont développées. Dans un second temps, nous poserons
la question du rôle de la biodiversité à l’avenir, pour montrer que, alors que notre repré-
sentation de la biodiversité a été profondément renouvelée depuis une trentaine
d’années9, il est opportun de repenser dans ce cadre les usages que nous pourrions en
faire. Ceci nous amènera pour finir à reposer la question des trois éléments capitaux du
développement durable, de leurs relations et de la manière de les faire fructifier.
Regard sur le passé : trois croyances à revoir
Dans un autre article de ce manifeste, Emmanuel Delannoy montre à quel point l’homme
s’est appuyé sur les ressources accumulées au fil des millénaires, voire des millions
26
10. CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2008a.
9. Voir CHEVASSUS-AU-LOUIS, 2007 et 2008a et b pour une présentation détaillée de cette nouvelle vision du vivant.

29
naturel ou du gaz de houille, produits également de la biodiversité passée : l’impression
d’indépendance croissante n’a donc été, en fait, qu’un transfert dans l’espace (le guano)
ou le temps (les gisements de nitrates puis de gaz naturel) vers l’exploitation d’autres res-
sources de la biodiversité. De plus, on a pu constater progressivement les effets néfastes
– tant pour l’environnement que pour la santé – de l’utilisation des nitrates, très solubles,
par rapport à des engrais organiques libérant plus lentement l’azote. Enfin, la conséquence
de cette volonté d’anticipation vis-à-vis de la nature est souvent la création de nouvelles
dépendances de l’homme face aux solutions qu’il a créées : il suffit de voir par exemple
les efforts que doivent entreprendre aujourd’hui les agriculteurs pour se libérer du recours
aux engrais azotés. Cet exemple des nitrates montre combien la maîtrise par l’homme des
choix qu’il effectue et des phénomènes qu’il engendre est finalement très faible.
Si l’on admet cette analyse illustrée des trois croyances, un constat s’impose : nous demeurons
durablement liés à la biodiversité et notre avenir dépendra de la manière dont nous saurons
« ménager » cette biodiversité, c’est-à-dire à la fois en utiliser les ressources et contribuer à
sa conservation et à son adaptation aux évolutions à venir, voire même activement contribuer
à la recréation de nature et des services associés.
Autre constat, que nous pouvons tirer de l’exemple des engrais : les possibilités de remplacer les
ressources d’une biodiversité locale par des ressources prélevées en d’autres points de la planète,
ou issues de la biodiversité passée, vont être de plus en plus limitées. Le « ménagement » de la
biodiversité doit donc d’abord se faire à l’échelle locale, cette notion n’excluant pas, bien au
contraire, des échanges et des actions collectives à une échelle plus large.
Demain : de nouvelles visions et relations à construire
Puisque notre destin est durablement lié à celui de la biodiversité, dont nous sommes
d’ailleurs une composante, pouvons-nous effectivement « compter sur la biodiversité »
pour assurer notre avenir et devons-nous établir avec elle de nouvelles relations ?
Même si nous sommes prêts à répondre positivement à ces questions, il nous semble né-
cessaire d’identifier auparavant trois illusions relatives à ce qu’est la biodiversité et à ce
qu’elle est susceptible de fournir, ceci afin d’éviter… de fortes désillusions.
La première est l’illusion de la « solution miracle » : la biodiversité « contiendrait des
pépites », des solutions encore inexploitées qui, à la fois, apporteraient un progrès radi-
cal et ne seraient pas dotées des défauts des solutions antérieures : nouvelles molécules
naturelles remplaçant les pesticides de synthèse, biocarburants de seconde ou troisième
génération, nouveaux médicaments, agents de lutte biologique, etc. Souvent portées au
pinacle par les médias, ces solutions « biologiques » connaissent tout aussi souvent un suc-
cès éphémère. Cette désillusion résulte sans doute d’une incompréhension du mode de
Une société en mouvement ?
28
valeur » – a été particulièrement souligné dans le cas du développement des élevages de
crevettes dans les mangroves tropicales ou des fronts pionniers dans la forêt amazonienne.
Croyance en notre indépendance, enfin : il nous semble en effet que cette exploitation
s’est faite souvent avec l’idée qu’elle était temporaire et que les progrès technologiques
de l’humanité allaient lui permettre de s’affranchir progressivement de sa dépendance vis-
à-vis de la nature et que, en outre, les changements induits par l’intervention humaine
étaient maîtrisés, avec des conséquences sous contrôle. Ainsi, le remplacement des huiles
de poissons ou de cétacés par l’huile de roche (le pétrole), puis par l’énergie de fission
nucléaire, a permis à la fois de repousser les frontières de la rareté (sans parler de la
fusion nucléaire maîtrisée, qui nous promet de petits soleils inépuisables sur terre) et de
soutenir une telle vision. On peut citer également les promesses des aliments synthé-
tiques11, voire les succès – au moins à court terme – des médicaments et produits phyto-
sanitaires de synthèse. Mais ces évolutions n’étaient en fait, le plus souvent, qu’une
transition entre l’utilisation des ressources actuelles de la biodiversité et l’exploitation de
ses ressources passées, énergétiques en particulier, ou étaient fondées sur l’imitation,
plus ou moins réussie, « d’innovation » du vivant par la chimie. De plus, ces substitutions
ont souvent révélé, plus ou moins tardivement, des effets imprévus affectant non seule-
ment la biodiversité en général mais l’homme lui-même : les exemples de la résistance
aux antibiotiques ou aux insecticides ou du réchauffement climatique sont, à ce titre,
emblématiques et bien documentés. Nous développerons plutôt celui, moins connu, des
engrais azotés.
En effet, le développement des grands voiliers puis des bateaux à vapeur a permis, dans
les années 1840, une première transition par rapport à l’utilisation d’engrais naturels lo-
caux produits par les animaux d’élevage ou les légumineuses : le courant froid remontant
les côtes d’Amérique du Sud était à la fois, depuis des milliers d’années, à l’origine d’un
climat aride, de proliférations exceptionnelles de poissons et, conséquemment, d’oiseaux
marins, permettant ainsi l’accumulation de leurs fientes sur des îles proches du littoral. Ce
fameux guano du Pérou a représenté une première opportunité pour certains agriculteurs
de s’affranchir de la production locale d’engrais naturel. Puis, toujours dans ces zones
arides, l’exploitation des gisements de nitrates naturels du désert chilien d’Atacama – res-
source unique sur notre planète, dont la formation est mal comprise mais a pu impliquer
des phénomènes biologiques – a constitué, jusqu’à la Première Guerre mondiale, une
autre source majeure d’engrais pour l’Europe. Enfin, cette guerre a conduit l’Allemagne,
soumise au blocus, à développer les nitrates de synthèse pour les munitions12, activité
reconvertie ensuite pour la fabrication d’engrais. Mais cette synthèse nécessite du gaz
Humanité et biodiversité
11. « Le jour où l’énergie sera obtenue économiquement, on ne tardera guère à fabriquer des aliments de
toutes pièces, avec le carbone emprunté à l’acide carbonique, avec l’hydrogène pris à l’eau, avec l’azote et
l’oxygène tirés de l’atmosphère. » (BERTHELOT Marcellin, 1896.)
12. Pour fabriquer la poudre, on utilisait principalement le salpêtre, production naturelle de nitrate de potas-
sium par des bactéries dans des mélanges d’eau, de paille, d’urine et de « terres salpêtreuses ». Ces méthodes
traditionnelles limitaient l’ampleur des conflits : en 1775, la production annuelle de poudre en France était
d’environ 800 tonnes, ce qui n’aurait alimenté que quelques jours de la bataille de Verdun en 1916.

31
dans le cas du vivant, de poser le problème de notre « maîtrise de la non-maîtrise »,
c’est-à-dire de la manière de se comporter vis-à-vis de processus encore très mal compris.
En corollaire, les interventions humaines devront se placer dans une logique d’apprentis-
sage individuel et collectif, c’est-à-dire qu’il conviendra de créer des lieux et des pratiques
de mise en commun des expériences individuelles et de repenser nos processus d’inno-
vation eux-mêmes : alors que les innovations technologiques s’inscrivent dans une lo-
gique « descendante » – séparant clairement les « producteurs » et les « consommateurs »
de ces innovations et visant à produire des innovations « clés en main », immédiatement
efficaces –, les usages intelligents de la biodiversité doivent se concevoir dans une lo-
gique beaucoup plus interactive, tirant parti de l’ensemble des savoirs et expériences tant
des « experts » que des « profanes » pour produire progressivement des innovations adap-
tées.
Ce mode d’innovation, fondé sur l’agrégation progressive des acquis et expériences d’un
réseau d’acteurs, sera peut-être considéré par certains comme ne permettant pas de
« vraies innovations », similaires aux innovations de rupture ayant révolutionné de mul-
tiples domaines, comme le transistor, le laser ou la communication sans fil (de la radio au
téléphone portable et aux puces intelligentes). Mais ces innovations de rupture ont été
fondées, dans la plupart des cas, sur des percées majeures dans la compréhension et la
maîtrise de processus physiques. C’est pourquoi nous considérons que, dans l’état actuel
de nos connaissances sur la biodiversité, cette démarche « modeste » doit être reconnue
comme pertinente et encouragée. Elle rejoint le concept « d’innovation précautionneuse »
développé notamment par Bruno Latour15, à savoir une démarche où l’examen des consé-
quences possibles de l’innovation n’intervient pas a posteriori, pour des innovations déjà
complètement définies, et même parfois déjà diffusées, mais accompagne pas à pas le
processus d’innovation.
Troisième illusion enfin, celle de croire que les innovations fondées sur la biodiversité se révé-
leront plus performantes que les solutions antérieures, sans avoir à reconsidérer la notion même
de performance économique, ses critères de mesure, et sans adopter une nouvelle vision, plus
globale, de la performance. Ainsi, si l’on demande à des systèmes de culture plus économes en
intrants (eau, engrais, produits phytosanitaires, énergie) d’avoir les mêmes « rendements » qu’un
système classique intensif, en continuant à définir le rendement – comme c’est d’usage en agriculture
– en termes de quantité produite par hectare, on risque fort de conclure à la moindre performance de
ces systèmes alternatifs. Par contre, si l’on rapporte ces productions aux intrants consommés – ce qui
est la définition classique d’un rendement (par exemple lorsqu’on regarde, pour une voiture, la dis-
tance parcourue par litre d’essence consommé) – la comparaison devient plus ouverte.
On peut d’ailleurs expliquer aisément cette focalisation, jusqu’à une époque récente, sur les
rendements par unité de surface : les autres facteurs (eau, engrais, énergie) étant relativement bon
marché et la surface disponible limitée, c’étaient ces rendements qui conditionnaient le plus direc-
tement la performance économique des exploitations.
Une société en mouvement ?
30
fonctionnement de la biodiversité : celui-ci est fait d’une multitude d’interactions entre ses
entités et combine donc des processus dont aucun n’est individuellement « parfait ».
Autrement dit, la biodiversité tire son efficacité de la combinaison de solutions isolément
imparfaites.
Ainsi, un agent de lutte biologique (un insecte, un champignon) ou une molécule élicitrice
(molécule produite par les plantes et qui stimule leurs défenses vis-à-vis des agresseurs)
ne sont pas des solutions « absolues », instantanées ou sans conditions : vouloir les utili-
ser pour remplacer un pesticide de synthèse supposera d’agir en même temps sur les
pratiques de culture, le choix des variétés, la gestion des sols, l’aménagement du paysage
pour favoriser la faune auxiliaire, etc. De plus, ces agents auront, par rapport au déve-
loppement d’un ravageur ou d’un pathogène, des « fenêtres d’efficacité » parfois étroites,
qu’il conviendra de repérer par une observation fine des cultures. Enfin, l’éventualité d’ef-
fets inattendus, parfois très dommageables, ne saurait être exclue au prétexte qu’il s’agit
de solutions « biologiques » : l’histoire de la lutte biologique est, hélas, riche de nombreux
exemples de tels effets comme celui, récent, de la prolifération de la coccinelle asiatique
introduite pour lutter contre les pucerons.
Il faut donc apprendre à construire en réalité des solutions « intégrées » et intégrantes de
biodiversité – c’est-à-dire combinant de manière pertinente des interventions réparties
dans l’espace et le temps – et qui soient en outre « ouvertes », car capables d’incorporer
progressivement de nouveaux apports issus de notre compréhension de la biodiversité, à
l’image des logiciels libres en informatique. C’est ce que nous avons appelé « l’innovation
en profondeur », par analogie avec les stratégies militaires de « défense en profondeur »
combinant plusieurs obstacles que l’on sait individuellement vulnérables13.
Ceci introduit la seconde illusion, celle de la « maîtrise du vivant ».Il nous faut en effet
admettre que même dans les pays où la biodiversité a fait l’objet de nombreux travaux,
nous n’avons aujourd’hui qu’une connaissance et une compréhension très partielles de ses
composantes et, surtout de son fonctionnement. Rappelons en particulier notre mécon-
naissance actuelle des micro-organismes, dont on sait qu’ils représentent l’essentiel de
la matière vivante et qu’ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des grands cy-
cles de l’azote, du phosphore ou du carbone. De même, l’écologie a surtout étudié les
échanges de matière et d’énergie au sein des écosystèmes – les fameux « réseaux tro-
phiques » – mais beaucoup moins les échanges d’informations. En particulier ceux liés à
toutes les molécules qui circulent à très faible dose dans ces écosystèmes, entre indivi-
dus de la même espèce ou d’espèces différentes, et peuvent conditionner l’évolution de
ces systèmes. Si nous souhaitons établir de nouvelles relations avec la biodiversité, il faut
donc admettre que nous ne la maîtrisons pas et que nous ne faisons, en fait, que la « sol-
liciter » et tirer parti, de manière empirique, de ses réactions. Alors que l’on évoque sou-
vent la question de la « maîtrise de la maîtrise » de la technologie14, il convient plutôt,
Humanité et biodiversité
13. CHEVASSUS-AU-LOUIS et GRIFFON, 2008.
14. L’expression est, selon les auteurs, attribuée à Edgar Morin, à Michel Serres, à Javier Pérez de Cuéllar, voire
à Claude Bébéar !
15. LATOUR B., 2008 :
A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design. Keynote Lecture for
the “Networks of Design”. Meeting of the Design History Society
, Falmouth, Cornwall, 3d September 2008.

33
de « valeurs de non-usage », pour tenir compte du fait que les humains peuvent accorder une va-
leur au simple fait que quelque chose existe. Dernière remarque, cette notion de capital « naturel »
n’exclut pas le fait que l’homme ait pu contribuer à sa constitution : le cas des paysages, des races
animales ou des variétés végétales en sont des exemples parlants.
L’évaluation globale de ce capital naturel est problématique, même si l’on peut en proposer des éva-
luations partielles à travers la valeur économique des services écologiques (voir l’article de G. Pipien
et J. Weber sur le rapport du Centre d’analyse stratégique) ou donner des estimations de la valeur
des stocks. Ainsi, la Banque mondiale a réalisé, pour l’an 2000, une estimation du capital naturel
de 120 pays17, basée sur les stocks de ressources minérales, forestières, pastorales, de terres arables
et d’espaces protégés18. La valeur de ces stocks est estimée en prenant en compte la valeur
économique des produits qui en résultent et la durée possible de leur exploitation. Autrement dit,
l’estimation se limite aux services de prélèvements. Les valeurs vont de moins de 1000 US$ par ha-
bitant pour des pays comme le Bangladesh, l’Éthiopie, Haïti ou le Malawi (généralement des pays
très peuplés) à plus de 30 000 US$ par habitant pour des pays comme le Canada, la Nouvelle-
Zélande ou la Norvège.
Bien que difficilement commensurables (le rapport de la Banque mondiale propose néanmoins des
estimations de la richesse totale des pays cumulant ces trois capitaux), les trois capitaux sont « subs-
tituables », c’est-à-dire qu’il est possible de faire appel à l’un d’entre eux pour en développer un
autre ou de développer l’un pour s’affranchir d’une dépendance excessive vis-à-vis d’un autre, à
l’exemple de la substitution capital/travail par la mécanisation lors de la révolution industrielle.
Nous avons évoqué précédemment à quel point cette révolution industrielle avait fondé le déve-
loppement de notre richesse matérielle sur des prélèvements dans le capital naturel ; de même,
utiliser une partie de notre richesse, voire s’endetter, pour développer l’éducation ou le système de
santé n’est pas une dépense mais un investissement qui s’inscrit dans une logique de développe-
ment du capital humain.
Mais l’interrogation autour du développement durable est justement née de la perception des limites
de ces transferts. Ainsi, alors que l’on observait jusqu’aux années quatre-vingt, dans les pays dé-
veloppés, une croissance simultanée de la richesse matérielle et des indicateurs de développement
humain19, il est apparu que ceux-ci pouvaient stagner, voire décroître, alors que le PIB poursuivait
sa progression. De même, les classements des pays selon leur PIB par habitant et selon ces indica-
teurs de développement humain révélaient des anomalies préoccupantes20 : ainsi, si les pays scan-
dinaves figuraient en bonne place pour ces deux classements, les pays du Golfe conservaient, malgré
leur richesse, de faibles valeurs pour les indicateurs de développement humain. Inversement, la
France est par exemple au dixième rang pour ces indicateurs, alors qu’elle n’est qu’en vingtième
position pour le PIB par habitant. L’introduction de données environnementales dans ces indicateurs
Une société en mouvement ?
32
La comparaison est encore plus ouverte si l’on prend en compte, en termes économiques, les consé-
quences environnementales de ces rendements élevés sur l’eau, les sols ou la biodiversité. On re-
trouve ici le paradoxe déjà évoqué de la mise en valeur des écosystèmes: une prairie ou une culture
conduite de manière moins intensive pourra se révéler plus performante si on l’évalue par rapport
à ce cahier des charges plus global. Encore faudra-t-il, si l’on veut que ce cahier des charges soit ef-
fectivement pris en compte, mettre en place les mesures économiques concrètes reconnaissant
cette meilleure performance.
Les trois capitaux : de la substitution au codéveloppement
Comme indiqué en introduction, l’une des manières de poser la question du développement dura-
ble est de considérer comment le développement de nos sociétés se fonde sur un certain nombre
de « capitaux », comment il les produit, et d’examiner leurs relations et leurs devenirs au cours
d’un processus de développement. Pour cela, examinons tout d’abord de manière plus précise le
contenu de ces capitaux.
Le premier est le capital économique au sens strict16, c’est-à-dire l’ensemble des biens matériels et
des richesses, tant individuels que collectifs, en nature ou en espèces. Ce capital économique peut
donc assez aisément être évalué en unités monétaires, ce qui signifie, comme on l’a vu récem-
ment, qu’il peut connaître des variations rapides et de grande ampleur.
Le second, le capital humain, est constitué de l’ensemble des compétences, des savoir-faire, mais
aussi des « savoir-être » acquis ou produits par les individus. Les aspects relatifs à la santé (morta-
lité infantile, espérance de vie) sont également des composantes de ce capital, qui est non seule-
ment individuel mais collectif. On distingue parfois le capital humain au sens strict, lié aux personnes,
et le capital social, relatif aux relations entre les personnes, mais nous utiliserons le terme « capi-
tal humain » pour inclure ces deux dimensions : une langue, des processus démocratiques, des sys-
tèmes d’entraide, le respect des minorités… font partie de ce capital. Même si certaines des
composantes du capital humain peuvent avoir une valeur économique directe – par exemple, le ni-
veau d’éducation peut favoriser la compétitivité d’un pays –, on voit bien qu’une évaluation globale
de ce capital utilisant une unité de mesure commune à toutes ses composantes est difficilement en-
visageable.
Enfin, le capital naturel correspond à l’ensemble des éléments que nous avons évoqués précé-
demment : il comprend les ressources présentes et passées de la biodiversité mais aussi les res-
sources physiques (eau, roches) supports de la biodiversité, mais qui peuvent être également
utilisées directement par l’homme. Cette notion de « ressources » est à prendre au sens très large
et n’implique pas forcément une consommation au sens strict, qui en diminuerait la quantité : les
paysages d’un pays, la présence d’espèces ou d’habitats remarquables sont des éléments patri-
moniaux qui contribuent à notre bien-être, nous permettent de nous « ressourcer » et doivent être
considérés comme faisant partie du capital naturel. De plus, les économistes ont développé la notion
Humanité et biodiversité
16. On le désigne également sous le nom de « capital physique », mais le terme peut prêter à confusion dans
notre propos.
17. Dans cette étude, l’eau et les ressources aquatiques ne sont pas prises en compte.
18. HAMILTON K., 2006.
Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century
, 208 p., Édition The
World Bank, Washington DC. Disponible sous ce titre sur Internet.
19. Le plus connu, l’IDH (indicateur du développement humain), utilisé par l’ONU, combine le pouvoir d’achat,
l’espérance de vie et le niveau d’éducation moyen de la population d’un pays.
20. On trouvera facilement sur Internet ces deux classements.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%