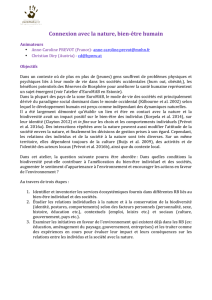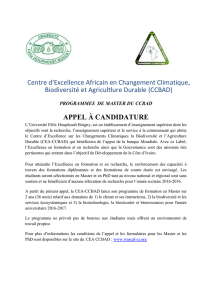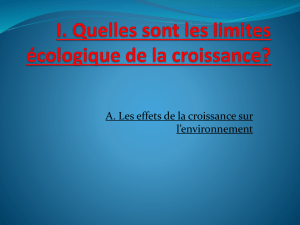Indicateurs et reporting : une autre mesure de la performance

Indicateurs
et reporting :
une autre mesure
de la performance

Entreprises, relevez le défi de la biodiversité
76
INDICATEURS ET REPORTING :
UNE AUTRE MESURE DE LA PERFORMANCE
■ Changer les compteurs pour comprendre la réalité
«
Changer les compteurs permettrait de changer les
perceptions des managers et des dirigeants et, au fi nal,
les stratégies des entreprises. » Didier Livio 51, Synergence
Les entreprises produisent chaque année de nombreux indicateurs
dont les plus connus sont les indicateurs fi nanciers (bilan actif passif,
chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, résultat net, etc.), véritables
repères pour les parties prenantes. La performance d’une entreprise
se mesure aujourd’hui à l’aune de ses résultats fi nanciers. Pour
autant, cela ne nous dit rien de son comportement écologique ou
social. Une autre unité de mesure serait donc utile.
En France, dans le cadre de la Responsabilité sociale et environ-
nementale (RSE), l’article 116 de la loi sur les Nouvelles régulations
économiques (NRE), promulguée en 2002, impose aux entreprises
cotées de produire un reporting social et environnemental au sein d’un
rapport extrafi nancier ou rapport développement durable. Plusieurs
indicateurs sont passés en revue : consommations d’eau, quantités de
déchets produites, émissions de gaz à effet de serre, dépenses pour
l’environnement ; ces derniers sont censés donner une idée de la per-
formance environnementale de l’entreprise en question.
51 Directeur du cabinet d’ingénierie sociale Synergence et président du Centre des jeunes
dirigeants de 1994 à 1996.
▲La performance fi nancière d'une entreprise ne dit rien
de son comportement écologique ou social.

CHAPITRE 3 ■ Agir maintenant 77
Derniers nés, les indicateurs de biodiversité font une apparition
timide dans les rapports extrafi nanciers. Les premiers avaient une
vocation pédagogique ; ils ont été développés pour faire prendre
conscience aux organisations de leur interdépendance avec le mon-
de vivant. Parmi eux, citons l’IIEB (Indicateur d’interdépendance de
l’entreprise à la biodiversité) ou de l’outil EBEVie. Ces deux outils ont
largement contribué à faire évoluer les perceptions. L’ESR
52 (Eco-
system Services Review) est quant à lui un outil visant à compléter
utilement les systèmes de management environnementaux exis-
tants. On y propose une démarche proactive, structurée pour mettre
en évidence les liens entre l’évolution des écosystèmes et les objec-
tifs économiques dans cinq champs (opérationnel, réglementaire et
juri dique, image et réputation, marchés et produits, fi nancement). La
démarche ESR, passe par cinq étapes : défi nir un périmètre d’étude,
identifi er les services prioritaires rendus par la nature, analyser l’évo-
lution de ces services prioritaires, étudier les risques et opportunités
pour l’entreprise et défi nir une stratégie. Enfi n, depuis 1997, la Global
Reporting Initiative (GRI) publie régulièrement des lignes directrices
pour l’élaboration des rapports développement durable, à la fois pour
les entreprises et les agences de notation qui les évaluent.
Ces indicateurs ont permis aux entreprises de progresser en
connaissance. Désormais, il va s’agir de construire une grille d’in-
dicateurs propre à chaque secteur d’activités, sans restreindre le
périmètre d’étude à un site industriel mais en couvrant l’ensemble
des interactions de l’entreprise avec la biodiversité.
■ Quels indicateurs choisir ?
Les propriétés complexes des écosystèmes et de la biodiversité ne
peuvent se résumer en quelques indicateurs simples, sauf à réduire
notre attention seulement à la faune et la fl ore. Comme l’illustre le
tableau page suivante, l’approche par les services écosystémiques
53
est une des réponses apportées au besoin d’indicateurs multi critères.
D’une part, elle permet de suivre l’évolution de plusieurs paramètres
fonctionnels de la biodiversité, d’autre part, les services écosystémi-
ques englobent l’échelle des gènes, des espèces et des milieux. Enfi n,
ils font le lien entre les thématiques environnementales traditionnel-
lement cloisonnées comme l’eau, l’air, les déchets, le C02, qui ont un
intérêt limité quand elles sont envisagées séparément.
52 En France il est porté par l’Institut Inspire.
53 La CICES (Common International Classifi cation of Ecosystem Services) travaille à une classifi ca-
tion internationale des services écosystémiques dont nous avons repris les éléments ici.

Entreprises, relevez le défi de la biodiversité
78
L'APPROCHE PAR LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
PERMET D'ÉLARGIR NOTRE VISON DE LA BIODIVERSITÉ
Services
écosystémiques Quelques exemples d’indicateurs
Climat : régulation
des échanges gazeux
stockage du carbone
• Suivi des émissions de gaz à effet de serre.
• Part des émissions d’origine fossile par rapport
à celles d’origine renouvelable.
• Compensation des émissions par du stockage (végétalisation).
Épuration et
fi ltration des eaux
• Évolution de la qualité de l’eau dans les espaces sous
responsabilité et dans les zones de rejets d’eaux usées.
• Effort de non-étanchéisation des sols.
Refuges pour
les espèces • Inventaire et suivi des populations d’espèces (par exemple,
STOC* pour les oiseaux), patrimoniales et ordinaires.
Pollinisation • État des populations d’insectes pollinisateurs.
• Surface d’habitats favorables aux pollinisateurs sauvages.
• Installation de type « ruches ».
Fertilité des sols • État des sols dans les espaces sous responsabilité.
• Quantité de métaux lourds et de pesticides dans les sols.
• Modes d’occupation du sol et emprises foncières de l’entreprise.
Continuités
écologiques
(trames et
corridors biologiques)
• Fragmentation du paysage due à l’activité.
• Efforts de maintien ou reconnexion des habitats naturels.
• Intégration paysagère des ouvrages bâtis.
Dégradation des
déchets fermentes-
cibles par les sols
• Quantité de déchets produits par l’activité.
• Description des différents fl ux de déchets.
• Part de déchets fermentescibles valorisés en compost/biogaz.
• Réhabilitation des sols dégradés par génie écologique.
Fourniture en eau
• Qualité de l’eau à l’entrée et à la sortie des sites.
• Consommations d’eau nécessaire au besoin de l’activité.
• Suivi des produits chimiques utilisés (par exemple,
REACH**).
Fourniture en
matières premières
alimentaires/
minérales/fossiles
• Comptabiliser les fl ux (entrées et sorties) de toutes les matières
issues de la biodiversité : organismes vivants, matières biolo-
giques non transformées, matières biologiques transformées,
matières fossiles, matières cultivées.
• Quantité de terres rares entrant dans les processus.
Ressources
génétiques • Variétés utilisées dans les processus de production.
• Manipulations génétiques et sélections.
Patrimoine culturel
et services récréatifs
à la population
• Conservation d’un patrimoine culturel et historique.
• Listes rouges de l’UICN aux échelles régionales et nationales.
• Perception des salariés vis-à-vis des pratiques de leur
entreprise.
* STOC : Suivi temporel des oiseaux communs.
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc.
** REACH : enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques.

CHAPITRE 3 ■ Agir maintenant 79
Nous pouvons poser l’hypothèse selon laquelle le maintien ou
l’amélioration de la disponibilité de plusieurs services écosysté-
miques simultanément aura des conséquences positives sur la
biodiversité. Inversement, toute activité prédatrice de ces services
(qui les surexploite, les transforme, les stoppe) ou qui n’aura d’effet
positif que sur un seul d’entre eux
54, peut être considérée comme
non durable. La construction d’un tableau de bord peut aider les
dirigeants à faire évoluer leur stratégie.
■ Vers un tableau de bord biodiversité
Pour le construire, voici le type de questions qu’il convient de se poser :
● Quels sont les services écosystémiques en relation avec mon acti-
vité, avec celle de mes fournisseurs, et avec les autres acteurs que
mes activités infl uencent ?
● Quelles sont les pratiques de mon entreprise qui les mettent en
danger ?
● Quels sont les indicateurs pour me permettre de mesurer l’impact
de mon entreprise ?
● Comment entretenir ou améliorer la qualité de ces services éco-
systémiques ?
Entreprise industrielle, commerciale ou de service, le tableau de bord
se construit au cas par cas, en fonction du secteur d’activité ciblé et de
son périmètre par rapport à la biodiversité. Il doit permettre de compta-
biliser les impacts directs et indirects des interactions de la fi rme avec la
biodiversité et les services écosystémiques (Houdet et al. 2009). Il peut
s’agir des services écosystémiques liés à l’ensemble des intrants/sor-
tants des processus de production (dont les fl ux de matières issues de
la biodiversité), en remontant le long des chaînes d’approvisionnement
jusqu’aux fournisseurs (logique d’analyse de cycle de vie), mais aussi des
services écosystémiques liés aux espaces fonciers. Dans certains cas,
l’éloignement entre l’entreprise et les écosystèmes est si grand (secteur
tertiaire) qu’il faut remonter jusqu’aux fournisseurs ou aux clients pour
comprendre les effets de ladite entreprise sur la biodiversité… ce qui pose
par ailleurs des problèmes de frontière de responsabilité entre acteurs.
54 Les émissions et le stockage du carbone sont les critères retenus dans la lutte contre
le changement climatique, au détriment des autres services écosystémiques comme la pollinisation,
la diversité des essences plantées, la qualité des sols, etc., d’où la nécessité de s’intéresser
à un panel de critères diversifi és.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%