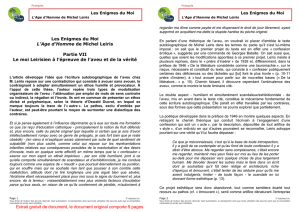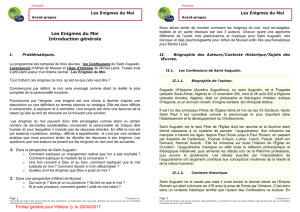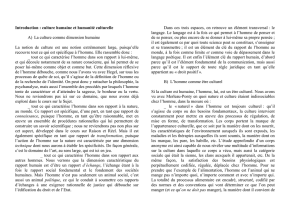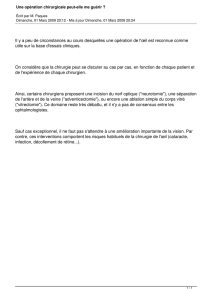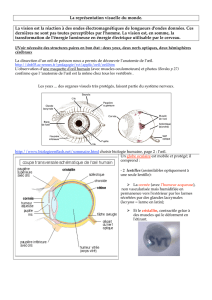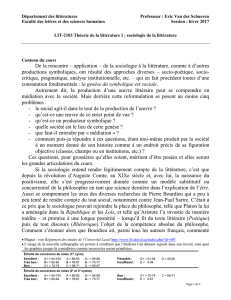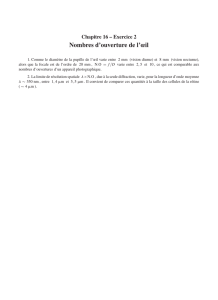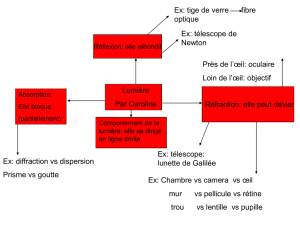11 AREAS Peixoto

143
L’oeil de l’ethnographe / Fernanda Arêas Peixoto
L’OEIL DE L’ETHNOGRAPHE
Fernanda Arêas Peixoto
Paulo
Rapprocher l’œil de l’objet induit une autre façon de voir
0. Introducon
Documents
Documents1 Zébrage
1
GradhivaC’est-à-dire
Jean Jamin.

144
Inscripons liéraires de la science
trompeur aux dires de Jean Jamin
2, il se lie avec Documents,
3. Si
4
5.
Documents
Documents
2
SimulacreLe point cardinal
Mots sans mémoire La grande fuite de neige
Glossaire j’y
serre mes glosesRévoluon surréaliste
Nuits sans nuit.
3 La Gazee des Beaux-Arts
Documents
Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, EthnographieArchéologie,
Beaux-Arts, Ethnographie, Variétés
4 Documents
Muséum Naonal d’Histoire Naturelle
Instut d’Ethnologie
5

145
L’oeil de l’ethnographe / Fernanda Arêas Peixoto
1. Cadre général
Instut d’ethnologie et le Muséum d’histoire naturelle
Muséum d’histoire naturelle et le Musée du Trocadéro
Documents à la tête 6 Service
d’Organologie Musicale au Musée d’Ethnographie du Trocadéro
Documents
Documents
Musée d’Ethnographie du
TrocadéroDocuments
Minotaure etc.7
Documents, de par
6
au Musée d’Ethnographie du Trocadéro
7

146
Inscripons liéraires de la science
Trocadéro
meneur de jeu de la Philosophie dans le boudoir 8.
au Trocadéro, et par la suite au Musée des Arts et Tradions Populaires,
Musée des
Arts Décorafs
École des Chartes, Georges Bataille,
9
dur de Documents
10
Documents
11, la revue lui permet de tester
Musée du Trocadéro que Documents accompagne14,
e e
8 L’Homme
puis dans Zébrage
9 Les Cahiers de la République, des Sciences et des Arts
10 Documents
Leiris.

147
L’oeil de l’ethnographe / Fernanda Arêas Peixoto
Mythes of the origin of re
Documents
Les six images qui accompagnent L’œil de l’ethnographe
12
habbé13
habbé
Magic Island
Documents
Documents.
caput mortuum
13 Habbé
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%