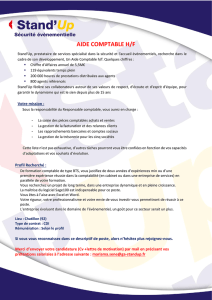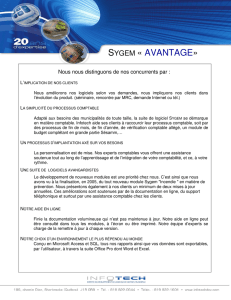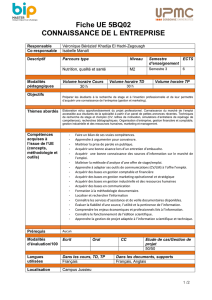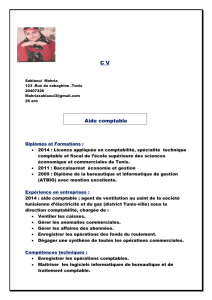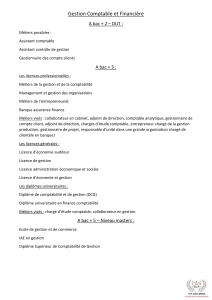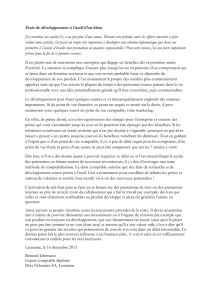Michel LASCOMBE et Xavier - Gestion et Finances Publiques

La Cour des comptes
Michel LASCOMBE Xavier VANDENDRIESSCHE
Professeur à l’IEP de Lille Professeur à l’Université de Lille-2
Retour sur la responsabilité du comptable assignataire et du régisseur ou la fin de la jurisprudence « Blémont »...
On sait que, depuis la jurisprudence Blémont, le Conseil d’Etat estime (et cette position a été réitérée à plusieurs reprises) que la respon-
sabilité du comptable assignataire reste engagée, alors même que le régisseur a obtenu décharge de responsabilité ou remise gracieuse.
Inutile de revenir ici sur les effets néfastes de cette jurisprudence (lesquels ont déjà fait l’objet de nombreux développements dans cette
Revue) ; qu’il nous soit simplement permis de nous féliciter qu’une fructueuse collaboration entre la Cour et la Direction générale de la
Comptabilité publique ait permis d’aboutir à une modification du décret nº 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs de manière à exonérer le comptable assignataire, hors le cas de faute, de toute responsabilité à
raison de la mise en cause de la responsabilité des régisseurs placés sous son autorité. En effet, le décret nº 2004-737 du 21 juillet 2004
modifiant l’article 12 du décret nº 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs (1) prévoit
désormais : « Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été
déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge
des comptes ou par le ministre sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à
l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. »
Résumés de jurisprudence
résumés
Cour des comptes, 7eChambre,
arrêt nº 36755, 18 juin et 24 juillet 2003,
Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse
Gestion de fait ; personnes pouvant être
déclarées comptables de fait ; comptable
patent (nomination irrégulière).
Nul ne peut échapper aux rigueurs de la
gestion de fait, pas même le comptable
public apparemment régulièrement
nommé et exerçant ses fonctions en
toute transparence. C’est le cas dans
l’espèce ci-dessous rapportée, un comp-
table public ayant été admis à faire valoir
ses droits à la retraite ayant été « réguliè-
rement » nommé comptable de l’Agence
de l’eau. Cet arrêt permet ainsi de rap-
peler les hypothèses dans lesquelles un
comptable patent peut être attrait dans
une procédure de gestion de fait.
On sait tout d’abord que, comme
n’importe quelle personne physique ou
morale, les comptables patents peuvent
être déclarés en gestion de fait : lorsqu’ils
y ont participé activement (C. comptes,
12 avril 1949, Bonnell et Cohen-Solal, Com-
mune mixte de Guergour,
Rec. C. comptes
25 ; GAJF, 4eéd., nº 41 et jurisprudence
citée p. 354. CRC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 29 juin 1993, Gestion de fait des
associations territoriales d’Arles,
La Revue
du Trésor
1996.508). Il en va de même s’ils
ne pouvaient ignorer les conditions
irrégulières de la gestion (CRC Basse-
Normandie, 25 février 1988, Commune de
Cormolain,
La Revue du Trésor
1993.703)
ou encore lorsque les agissements repro-
chés sont le fait des régisseurs dont le
comptable est assignataire (CRC Aquitaine,
29 novembre 1990, Association « Comité
d’organisation du festival international de
musique et d’art dramatique de Bor-
deaux »,
Rec. C. comptes
141).
Le comptable public pourra également
être déclaré comptable de fait lorsqu’il
s’ingère dans des opérations relevant de
la compétence d’un autre comptable
patent (C. comptes, 7 mai 1958, Bantas et
Moreau, régie départementale des pas-
sages d’eau de la Vendée,
Rec. C. comptes
69. CE, 4 octobre 2000, Ministre des
Finances c/ M. Pair,
Rec. CE
385 ;
La Revue
du Trésor
2001.122, concl. Seban [sol.
impl.]. C. comptes, 7 décembre 2000,
Communication du procureur général
nº 26626,
Rec. C. comptes
233 ;
RFD adm.
2003.592). C’est le cas par exemple d’un
trésorier-payeur général ayant continué
d’assurer la gestion comptable d’un syn-
dicat mixte regroupant des communes et
un département en contradiction avec les
dispositions des articles 54 et 56 de la loi
du 2 mars 1982 (CRC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 6 avril 1993, SYMIVAL,
La Revue du
Trésor
1994.118) ou de l’exécution par des
comptables d’établissements publics de
dépenses engagées par les services de
l’Etat, contraire au principe d’autonomie
de ces établissements (C. comptes,
21 novembre 1995, référé nº 8030,
Rec.
C. comptes
289. Voir également, ci-
dessous C. comptes, 7 avril et 7 juin 2004,
Lycée Jean-Rostand à Roubaix).
Il peut encore s’agir d’une personne qui
occupe la fonction de comptable public
sans y avoir été régulièrement habilitée
(C. comptes, 22 mars 1994, Syndicat mixte
pour l’aménagement et l’équipement du
plateau de Valbonne,
La Revue du Trésor
1994.517). Il en va de même lorsque la
nomination de l’agent comptable a été
annulée par le juge administratif
(C. comptes, 24 octobre 2002, Université
française du Pacifique,
AJDA
2003.1222).
La Cour ne se fie pas aux apparences et
n’hésite pas à qualifier de comptable de
fait un comptable, nonobstant sa nomina-
tion par arrêté préfectoral, son installation
et sa prestation de serment comme comp-
table et le versement d’un cautionnement,
toutes formalités dont il justifie par pièces
régulières, dès lors que c’est sans titre suf-
fisant qu’il s’est immiscé dans le manie-
ment des deniers publics (C. comptes,
15 juin 1982, Institut départemental de
sourds-muets et d’aveugles de Saint-
Médard-les-Soissons,
Rec. C. comptes
10.
V. aussi C. comptes, 2 juillet 1959, Receveur
irrégulier de l’OPHLM de Huningue,
Rec.
C. comptes
25).
Mais la Cour va plus loin encore dans la
présente espèce puisqu’elle élargit le péri-
mètre de la gestion de fait, d’abord au
trésorier-payeur général, en sa qualité de
supérieur hiérarchique et de responsable
du contrôle administratif du poste comp-
table en cause (art. 189 du RGCP). La Cour
estime en effet qu’il ne pouvait ignorer la
mise à la retraite de l’intéressé et qu’il a
(1)
JO
nº 173 du 28 juillet 2004, p. 13421.
38 85eannée - nº 1 - janvier 2005

ainsi toléré la gestion de fait. La Cour avait
déjà jugé que l’approbation par un tréso-
rier-payeur général d’une convention
mettant en place une gestion de fait et
l’ouverture dans ses écritures d’un
compte de fonds particuliers pour
retracer les opérations font entrer le tré-
sorier-payeur général dans le périmètre
de la gestion de fait dans l’exercice de ses
fonctions de contrôleur financier local
(C. comptes, 8 février 1996, Association
pour la promotion de l’information éco-
nomique et sociale,
La Revue du Trésor
1999.259). Plus largement, on sait que les
supérieurs hiérarchiques seront déclarés
comptables de fait « de longue main » dès
lors qu’ils ont ordonné ou connu et toléré
les faits (C. comptes, 8 février 1990, Régis-
seur d’avance du poste diplomatique
d’Accra et ambassadeur de France au
Ghana,
Rec. C. comptes
28 ;
La Revue du
Trésor
1995.767. C. comptes, 30 mars
2000, Association du comité social en
faveur du personnel communal de Villers-
les-Nancy,
La Revue du Trésor
2001.33). Si
les supérieurs ont approuvé, encouragé,
facilité voire simplement toléré les irrégu-
larités, ils seront déclarés en gestion de
fait lors même qu’ils n’ont pas pris l’initia-
tive de celles-ci (C. comptes, 11 octobre
1961, Laqueuille,
Rec. C. comptes
63.
C. comptes, 4 juillet 1985, Association
Média et vie sociale, Comiti et autres,
Rec.
C. comptes
105 ;
La Revue du Trésor
1992.50. CE, 9 juin 2000, Bergé,
La Revue
du Trésor
2001.122). Le même raisonne-
ment s’applique en l’espèce aux deux
signataires de l’arrêté de nomination du
comptable « retraité »...
Extrait
Attendu que par arrêt susvisé du
13 novembre 2002, la Cour a déclaré provi-
soirement comptable de fait des deniers de
l’agence de l’eau Rhône - Méditerranée -
Corse M. Vèque, au motif que ce dernier,
après avoir occupé régulièrement les fonc-
tions de comptable de l’agence d’abord
comme titulaire jusqu’à la date de son
admissionàlaretraitesurvenuele21mars
1993, puis comme intérimaire désigné dans
l’intérêt du service par le directeur de la
comptabilité publique jusqu’au 5 juillet 1993,
a été nommé par un arrêté en date du
6 juillet 1993 agent comptable titulaire de
l’agence, fonction qu’il a conservée jusqu’au
5 juillet 1996 à la veille de son remplacement
par Mlle Jean ; qu’en effet, l’arrêté du
6 juillet 1993, qui mentionnait lui-même la
qualité de trésorier principal « honoraire » de
M. Vèque, n’avait pu lui conférer la qualité
de comptable public puisque celui-ci avait
été admis à faire valoir ses droits à la retraite
par limite d’âge, celle-ci ayant eu pour effet
de priver M. Vèque de tout lien avec le ser-
vice ; que M. Vèque se trouvait donc
dépourvu de titre légal à manier les deniers
de l’agence pendant toute la période allant
du 6 juillet 1993 au 5 juillet 1996 ;
Attendu que dans sa réponse, M. Vèque
avance qu’il ne pouvait mettre en cause la
légalité d’un arrêté de nomination publié au
Journal officiel ;
Mais attendu que la simple publication d’un
acte de nomination au
Journal officiel,
qui
peut certes produire certains effets de
droit, ne saurait suffire à présumer de sa
légalité ni à lui permettre de constituer le
titre légal sans lequel un comptable ne peut
manier des fonds publics ;
Attendu que par l’arrêt susvisé, la Cour a
déclaré provisoirement comptables de fait
des deniers de l’agence de l’eau Rhône -
Méditerranée - Corse MM. Laurent et Pin-
guet, respectivement directeur de l’eau au
ministère chargé de l’Environnement et
sous-directeur à la Direction de la Compta-
bilité publique à l’époque des faits, tous
deux signataires de l’arrêté du 6 juillet 1993,
au motif qu’ils avaient rendu possible la
gestion de fait en désignant irrégulière-
ment comme comptable une personne qui
ne pouvait prétendre à ce titre ;
Attendu que dans sa réponse, M. Pinguet
indique que la nomination de M. Vèque,
pourtant admis à faire valoir ses droits à la
retraite par limite d’âge, serait la consé-
quence du fait que le poste comptable de
l’agence ne pouvait désormais plus être
occupé en adjonction de service et néces-
sitait l’emploi d’un comptable à temps
plein, emploi qui n’avait pas été prévu dans
le budget de l’agence pour l’année 1993 ;
Mais attendu que les éléments d’opportu-
nité mis en avant par M. Pinguet dans sa
réponse pour justifier le maintien dans ses
fonctions puis la nomination de M. Vèque
ne sont pas de nature à modifier l’appré-
ciation juridique de la Cour ;
Attendu que M. Laurent estime dans sa
réponse n’avoir eu aucune influence sur la
nomination de M. Vèque, qui était le fruit
d’une procédure interne à la Direction de
la Comptabilité publique, et fait valoir qu’il
n’a, en tout état de cause, pas manipulé les
deniers de l’établissement ;
Mais attendu qu’en dépit des circonstances
administratives alléguées par M. Laurent,
celui-ci n’en a pas moins signé l’arrêté de
nomination qui a rendu possible la gestion
de fait ; que l’absence de manipulation des
deniers de sa part ne fait pas obstacle à une
déclaration de gestion de fait de longue
main ;
Attendu que par l’arrêt susvisé, la Cour a
déclaré provisoirement comptable de fait
des deniers de l’agence de l’eau Rhône -
Méditerranée - Corse M. Drapé, trésorier-
payeur général de la région Rhône-Alpes et
du département du Rhône à l’époque des
faits, à ce titre supérieur hiérarchique de
M. Vèque et chargé du contrôle adminis-
tratif du poste comptable de l’agence de
l’eau, au motif qu’il n’avait pu ignorer que
la mise à la retraite de M. Vèque empêchait
que ce dernier pût être régulièrement
nommé à un poste comptable qu’il était
chargé de contrôler en application de
l’article 189 du décret susvisé du
29 décembre 1962 ; qu’en n’émettant
aucune réserve à l’encontre de cette nomi-
nation, il avait toléré les agissements qui
ont permis la gestion de fait ;
Attendu que M. Drapé affirme dans sa
réponse n’avoir eu aucun pouvoir pour
s’opposer à la nomination de M. Vèque, qui
était réglementairement de la responsabi-
lité des ministres chargés de l’Environne-
ment et du Budget ; qu’en outre, le
contrôle du trésorier-payeur général sur les
postes comptables des établissements
situés dans son ressort territorial se limitait
à la gestion administrative de ces derniers
et non à la nomination de leurs titulaires ;
Mais attendu que M. Drapé aurait dû
signaler au directeur de la comptabilité
publique l’impossibilité de nommer
M. Vèque au-delà de la limite d’âge, sur
laquelle il avait lui-même appelé l’attention
de sa hiérarchie peu auparavant en vue de
pourvoir à son remplacement à la tête de
la trésorerie de Lyon-Municipale ; qu’en
s’abstenant de le faire et en transmettant
sous son couvert la demande de M. Vèque
en date du 25 janvier 1993 sollicitant de la
Direction de la Comptabilité publique sa
nomination comme comptable de l’agence
à compter du 1er juillet 1993, M. Drapé a
bien toléré la gestion de fait et que, pour
ce motif, il peut être considéré y avoir par-
ticipé ;
Attendu enfin que M. Vèque argue qu’il n’a
nullement dissimulé la gestion des fonds en
cause, puisqu’il a agi de manière décou-
verte comme comptable patent de l’orga-
nisme ; que MM. Pinguet et Laurent met-
tent aussi en avant, dans leurs réponses
respectives, le caractère non occulte des
opérations ;
Mais attendu que si l’intention de dissi-
muler des opérations de gestion de fait est
une caractéristique fréquente de cette irré-
gularité, elle n’en est pas un élément
constitutif ; que la gestion de fait est
constituée à partir du moment où il y a
maniement de deniers publics par un
manutenteur dépourvu de titre légal ;
qu’en l’espèce, l’arrêté de nomination de
M. Vèque, survenu plusieurs mois après
l’admission de ce dernier à la retraite par
limite d’âge, ne constituait qu’une habilita-
tion apparente qui ne pouvait produire des
effets vis-à-vis du juge des comptes ; qu’à
défaut de titre légal pour manier des
deniers publics, M. Vèque doit donc être
déclaré comptable de fait, ainsi que ceux
qui ont rendu possible cette situation ;
Par ces motifs,
Ordonne :
Statuant définitivement,
MM. Vèque, Pinguet, Laurent et Drapé sont
déclarés conjointement et solidairement
comptables de fait des deniers de l’agence
de l’eau Rhône - Méditerranée - Corse pour
l’ensemble des opérations exécutées du
6 juillet 1993 au 5 juillet 1996.
Cour des comptes, 3eChambre,
arrêt nº 38655, 9 février 2004,
Université Paris-IX Dauphine
Dépenses ;
primes, indemnités, rémunéra-
tions accessoires ; enseignement supé-
rieur.
Dans l’espèce ci-dessous, la Cour reprend,
de manière particulièrement pédago-
gique, le raisonnement déjà tenu dans son
arrêt du 24 avril 2003, Université de Reims
(
La Revue du Trésor
2004.551) s’agissant
des rémunérations complémentaires
accordées par les universités aux ensei-
gnants chercheurs. Ceux-ci ne peuvent en
aucun cas bénéficier de rémunérations
fondées sur le décret nº 76-193 du
24 février 1976 fixant le régime de rému-
nérations pour travaux supplémentaires
administratifs et techniques susceptibles
d’être versées par les universités aux fonc-
tionnaires et agents de l’Etat qui les exclut
expressément de son champ d’applica-
tion. Les agents comptables des univer-
sités liront ainsi avec intérêt le présent
arrêt qui reprend l’énumération des
diverses primes dont peuvent bénéficier
les enseignants chercheurs des universités
chronique financière
39 85eannée - nº 1 - janvier 2005

(prime de charges administratives ; prime
de responsabilités pédagogiques ; prime
d’encadrement doctoral et de recherche).
Ne disposant pas de fondement régle-
mentaire pour le paiement des vacations
en cause, le comptable aurait dû sus-
pendre le paiement. En effet, les primes
et indemnités doivent être justifiées,
d’une part, par la décision octroyant la
prime ou l’indemnité et précisant soit
expressément, soit par référence à un
texte législatif ou réglementaire régissant
l’avantage en cause, s’il y a lieu, l’assiette
globale de la prime et son montant global,
les catégories de bénéficiaires, et ses
conditions particulières de versement,
l’assiette de la prime individuelle, son
montant ou les modalités de détermina-
tion de son montant, d’autre part, par un
décompte individuel comportant la réfé-
rence à la décision ainsi que les éléments
relatifs à l’assiette de la prime, sa liquida-
tion et son montant (CRC Nord - Pas-de-
Calais, 8 juillet 1992 et 6 janvier 1993,
Commune de Courcelles-lès-Lens,
Rec.
C. comptes
1993.7). S’agissant de primes
ou indemnités versées à des fonction-
naires, le comptable doit s’assurer qu’elles
sont bien autorisées par les textes en
vigueur (C. comptes, 5 mai 1988, ENS hor-
ticole de Versailles,
Rec. C. comptes
61).
Ont ainsi été considérées comme des
pièces insuffisantes une simple décision
ministérielle sans qu’un texte législatif ou
réglementaire autorise la prime
(C. comptes, 5 juillet 1967, Lycée
J.-Decour à Paris,
Rec. C. comptes
111 ;
9 mars 1998, Ancien payeur général du
Trésor,
La Revue du Trésor
1998.655) ou
des lettres signées par le directeur de
cabinet du ministre (C. comptes, 2 février
1989, note du Parquet nº 9061,
Rec.
C. comptes
186). En l’espèce, le comp-
table ne pouvait se retrancher derrière
une note du Parquet de la Cour (au sur-
plus antérieure au décret du 12 janvier
1990) ou une interprétation conjointe de
l’université et du ministère. En effet, dès
lors que le texte de référence encadre
précisément la prime dont s’agit, il n’est
pas possible de l’attribuer plus largement
et en particulier d’étendre une prime
prévue pour les agents des services infor-
matiques aux simples utilisateurs
(C. comptes, 15 mai 2003, Communauté
de communes du pays de Laval,
La Revue
du Trésor
2004.208 ;
RFD adm.
2004.208).
De même, les primes versées à des agents
contractuels sont irrégulières dès lors que
le décret les mettant en place ne prévoit
pas que ces agents puissent en bénéficier
(CRC Rhône-Alpes, 15 mai 2003, CHU de
Grenoble,
La Revue du Trésor
2004.117).
Extrait
Sur l’injonction nº 3 de l’arrêt nº 36262
du 24 avril 2003 :
Attendu que, par un mandat nº 7112 du
18 juillet 2000 imputé sur le compte 641-42,
des vacations administratives d’un montant
total de 219 199,23 F (33 416,71 c) ont été
payées sur le fondement du décret
nº 76-193 du 24 février 1976 fixant le
régime de rémunérations pour travaux
supplémentaires administratifs et techni-
ques susceptibles d’être versées par les uni-
versités aux fonctionnaires et agents de
l’Etat ; que ces rémunérations ont été
assorties d’un versement de taxe sur les
salaires par un mandat nº 7099 du 18 juillet
2000 imputé sur le compte 631 pour un
montant de 10 564,57 F (1 610,56 c) ; que
le décret nº 76-193 du 24 février 1976, sur
lequel sont fondées ces vacations, dispose,
dans son article 2, que « les personnels,
dont l’indice net de rémunération est infé-
rieur ou égal au plafond mentionné au
deuxième alinéa de l’article 3 du décret du
6 octobre 1950 susvisé, peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux sup-
plémentaires suivant les mêmes condi-
tions, plafonds et taux que ceux prévus par
ce texte » ; que le même décret ajoute,
dans son article 3, que « les personnels,
dont l’indice net de rémunération est supé-
rieur au plafond visé à l’article 2 ci-dessus,
peuvent percevoir des vacations horaires
dont les taux unitaires sont déterminés en
application du tableau ci-après » ; que le
décret nº 76-193 du 24 février 1976 se
réfère donc, pour le paiement des vaca-
tions horaires, à un plafond défini par
l’article 3 du décret nº 50-1248 du 6 octobre
1950 modifié relatif au nouveau régime des
indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires susceptibles d’être accordées
aux personnels civils de l’Etat ; que ce
décret nº 50-1248 du 6 octobre 1950
modifié est de surcroît visé par le décret
nº 76-193 du 24 février 1976 ; que
l’article 15 du décret nº 50-1248 du
6 octobre 1950 modifié dispose toutefois
que ce décret n’est pas applicable « aux per-
sonnels enseignants qui demeurent soumis
à une réglementation spéciale » ; que le
comptable ne disposait donc pas d’un texte
réglementaire pouvant fonder l’attribution
de ces vacations horaires pour travaux
supplémentaires administratifs à des ensei-
gnants ; qu’il a en conséquence été enjoint
au comptable de produire dans le délai de
deux mois la preuve du reversement dans
la caisse de l’université Paris-IX Dauphine de
la somme de 35 027,27 c(33 416,71 c+
1 610,56 c) ou, à défaut, toute autre justi-
fication susceptible de dégager sa respon-
sabilité ;
Attendu que le comptable a répondu qu’il
avait lui-même incité l’ordonnateur à uti-
liser le décret nº 76-193 du 24 février 1976
pour rémunérer les enseignants pour des
tâches administratives liées à la pédagogie
et qu’il s’était appuyé à cet effet sur des
recommandations de la Cour des comptes
dont il avait eu connaissance dans ses fonc-
tions antérieures d’agent comptable de
l’université Paris-IV - Paris-Sorbonne ;
Considérant que le comptable se réfère en
l’occurrence à une communication du pro-
cureur général de la Cour en date du
16 novembre 1983 qui critiquait le paie-
ment d’allocations forfaitaires mensuelles
calculées au taux des heures complé-
mentaires pour rémunérer des tâches telles
que la correction de copies, la participation
à des réunions et commissions pédagogi-
ques, le contrôle et le suivi des étudiants ;
que cette communication dénonçait à bon
droit des paiements effectués sous forme
d’heures complémentaires pour rému-
nérer des tâches qui ne relevaient pas de
l’enseignement en présence des étudiants ;
qu’en outre cette communication, qui
n’était pas une décision juridictionnelle,
était antérieure aux textes réglementaires
fondant le régime indemnitaire des ensei-
gnants chercheurs actuellement en
vigueur ;
Considérant en effet que le décret nº 90-50
du 12 janvier 1990 dispose, en son article 2,
qu’une prime de charges administratives
peut être attribuée aux enseignants cher-
cheurs qui exercent une responsabilité
administrative ; que le décret nº 99-855 du
4 octobre 1999 dispose, en son article pre-
mier, qu’une prime de responsabilités
pédagogiques est instituée dans les établis-
sements d’enseignement supérieur pour
les enseignants qui exercent des responsa-
bilités pédagogiques spécifiques en sus de
leurs obligations de service ; que le décret
nº 90-51 du 12 janvier 1990 dispose enfin,
en son article 2, que des primes d’encadre-
ment doctoral et de recherche peuvent
être attribuées pour une période de quatre
années universitaires aux enseignants cher-
cheurs qui exercent une activité spécifique
en matière de formation à la recherche et
par la recherche en plus de leurs obligations
statutaires ; qu’en application de ce régime
indemnitaire, des primes non cumulables
peuvent rémunérer des responsabilités soit
administratives, soit pédagogiques, soit de
formation dans le domaine de la recherche,
lorsqu’elles sont exercées par des ensei-
gnants au-delà des obligations de service ;
qu’aucune disposition ne précise en
revanche que le décret nº 76-193 du
24 février 1976 se surajoute à ce dispositif
indemnitaire qui rémunère en outre déjà
les responsabilités administratives assurées
par les enseignants chercheurs ; que de
surcroît le décret nº 50-1248 du 6 octobre
1950, qui fixe le seuil d’attribution des vaca-
tions horaires relevant de l’article 3 de ce
décret nº 76-193 du 24 février 1976, précise
lui-même qu’il ne s’applique pas, de façon
explicite, aux enseignants chercheurs ;
Considérant au surplus que l’état de liqui-
dation sur le fondement duquel a été payé
le mandat nº 7112 du 18 juillet 2000
indique, sous l’intitulé « qualité justifiant de
l’attribution des vacations » les mentions :
directeur adjoint, directeur des études
(2 enseignants), responsable informatique
(4 enseignants), responsable de budget,
responsable langues, tuteur des relations
internationales, responsable de filières
(19 enseignants), responsable de diplôme
(15 enseignants), responsable de 1er cycle,
tuteur de stage (4 enseignants), etc. ; que
ces mentions correspondent à des respon-
sabilités pédagogiques permanentes ; que
l’indication portée sur l’état de liquidation,
selon laquelle la qualité des bénéficiaires
justifiait de l’attribution des vacations, était
dès lors en tant que telle contradictoire
avec l’attribution de vacations horaires rela-
tives à des travaux administratifs et techni-
ques qui devaient nécessairement revêtir
un caractère ponctuel ; que le comptable,
constatant une contradiction entre les
mentions portées sur l’état de liquidation
et l’article 3 du décret nº 76-193 du
24 février 1976 sur lequel se fondait le
mandat, aurait dû suspendre le paiement ;
Considérant que cet état de liquidation
montre par ailleurs que, parmi les bénéfi-
ciaires, neuf enseignants ont bénéficié de
38 vacations, sept de 6 vacations, quatre de
21 vacations, quatre de 30 vacations... ; que
ces répétitions du même nombre de vaca-
tions ne peuvent correspondre à des tra-
vaux administratifs et techniques qui doi-
vent revêtir un caractère ponctuel et dont
la durée est par nature variable ; qu’en
outre, par l’effet des taux horaires applica-
bles aux différents indices de rémunéra-
tion, l’état de liquidation aboutit au total à
chronique financière
40 85eannée - nº 1 - janvier 2005

sept vacations de 8 096,13 F exactement,
six de 4 048,06 F, cinq de 1 065,27 F, quatre
de 4 108,95 F, trois de 4 474,18 F, etc. ; que
ces montants identiques montrent que
l’université a entendu rémunérer de façon
forfaitaire, sous le couvert de « vacations
horaires », des fonctions pédagogiques
exercées sur la durée de l’année universi-
taire ;
Attendu qu’en conséquence ni le décret
nº 76-193 du 24 février 1976, ni l’état de
liquidation ne pouvaient justifier le paie-
ment de vacations horaires pour travaux
supplémentaires administratifs à des ensei-
gnants.
Conclusions nº 7889
du 2 décembre 2003
(extrait)
Sur l’injonction nº 3 :
Cette injonction visait le paiement à des
enseignants de primes fondées sur le
décret du 24 février 1976 ;
Elle peut paraître sévère d’autant qu’en
l’espèce le comptable excipe d’une inter-
prétation ministérielle favorable à sa thèse
et même d’une communication, il est vrai
fort ancienne, de la Cour laissant entendre
que ledit décret pourrait permettre la
rémunération de charges administratives ;
Il n’en reste pas moins que juridiquement
le décret du 24 février 1976 vise le décret
nº 50-1248 du 6 octobre 1950 qui définit
de manière limitative, en son article 15, les
agents susceptibles de bénéficier de vaca-
tions horaires pour travaux supplémen-
taires en excluant explicitement les ensei-
gnants ;
Or, comme Nous l’avons rappelé dans Nos
conclusions nº 7378 du 24 mars 2003 sur
l’université de Reims : « La Cour est en effet
parfaitement en droit d’exiger d’un comp-
table qu’il s’assure de la régularité du paie-
ment d’une indemnité en confrontant la
situation individuelle des bénéficiaires
aux conditions limitatives posées par un
décret seulement visé par le texte régle-
mentaire sur la base duquel l’indemnité est
versée (Conseil d’Etat, 8 décembre 2000,
Mme Kammerer) » ;
La juridiction pourrait certes tenir compte
des circonstances de l’espèce et notam-
ment, même si elles ne s’imposent pas à
elle, des interprétations dont se prévaut le
comptable ;
Une telle attitude ne serait toutefois guère
équitable car elle aboutirait à renoncer à
tout reversement à Paris-IX alors qu’ils ont
été demandés et obtenus à Reims dans un
contexte juridique identique ;
Il y aurait donc lieu, à Notre sens, de réfuter
les arguments du comptable et de main-
tenir l’injonction de versement de la
somme de 35 027,27 c.
Cour des comptes, 2eChambre,
arrêt nº 38665, 18 février 2004,
Ecole nationale supérieure
d’ingénieurs de constructions
aéronautiques (ENSICA)
Gestion de fait ;
non-lieu à gestion de fait ;
cessation des irrégularités ; considérations
d’opportunité.
L’arrêt ci-dessous rapporté constitue, on
l’espère, une espèce isolée. En effet, la
Cour prononce ici un non-lieu à gestion
de fait alors que tout démontre son exis-
tence ; la Cour relève la « bonne volonté »
des dirigeants de l’Ecole qui avaient
engagé, dès 1999, des démarches de
régularisation ; elle souligne la faible
importance des sommes en jeu et indique
que les faits générateurs de la gestion de
fait ont cessé au 31 décembre 2002, soit
postérieurement à la déclaration provi-
soire du 22 février 2002.
On sait qu’en principe le reversement des
fonds n’a pas pour effet d’exclure la ges-
tion de fait dès lors que la Cour constate
qu’il n’est intervenu qu’à la suite, par
exemple, d’un contrôle opéré par la Tré-
sorerie générale (C. comptes, 21 février
1963, Dame George,
GAJF,
4eéd., p. 287)
ou qu’après une injonction adressée par
la Cour au comptable patent (C. comptes,
5 février 1971, De Lachomette et Frétet,
Conseil supérieur de la chasse,
Rec.
C. comptes
62). En l’espèce, rien ne
permet d’affirmer que les opérations irré-
gulières auraient cessé sans l’intervention
de la Cour...
Il est vrai que la juridiction financière avait
déjà pu justifier sa décision par le simple
défaut d’intérêt pratique de la procédure
en particulier lorsque les irrégularités
avaient cessé (C. comptes, 26 février 1996,
CROUS de La Réunion,
Rec. C. comptes
9,
concl. contraires du procureur général ;
La Revue du Trésor
1996.596. C. comptes,
8 août 1994, Université de Nancy-II,
Rec.
C. comptes
94. C. comptes, 25 mars 1999,
Université Claude-Bernard - Lyon-I
(CURAIO),
La Revue du Trésor
1999.770 ;
RFD adm.
2000.1117. C. comptes, 14 juin
1999, Office de protection contre les
rayonnements ionisants,
La Revue du
Trésor
2000.215 ;
RFD adm.
2000.1117).
Ce sont parfois des considérations de
pure opportunité qui conduisent le juge
à prononcer le non-lieu comme par
exemple l’état de santé du comptable de
fait présumé (C. comptes, 26 janvier 1977,
Bibliothèque du Musée de l’homme,
La
Revue du Trésor
1977.26).
Certes, le Conseil d’Etat a estimé que
« dans le cas où il y a reversement de la
totalité des sommes extraites irrégulière-
ment avant que n’intervienne la déclara-
tion définitive de la gestion de fait, il y a
non-lieu à déclaration de gestion de fait
en raison de la régularisation ainsi inter-
venue » (CE, 23 février 2000, Ministre des
Finances c/ Association des conseillers
régionaux de Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
Rec. CE
99 ;
La Revue du Trésor
2000.459 ;
RFD adm.
2000.1117). Il n’en
reste pas moins vrai que l’office du juge
des comptes, en gestion patente comme
en gestion de fait, est d’ordre public et,
une fois encore, qu’il ne dispose pas de
l’opportunité des poursuites (voir égale-
ment ci-après, notre note sous l’arrêt
nº 39089 des 10 mars et 23 mars 2004,
Ecole nationale supérieure des techniques
industrielles et des mines [ENSTIM] d’Alès).
Extrait
Attendu que, antérieurement à la transfor-
mation de l’ENSICA en établissement public,
la formation continue était confiée par le
biais d’une convention à l’« association des
amis de I’ENSICA » (AME) ;
Attendu que l’article 9 du décret créant
l’établissement public ENSICA donne au
directeur la mission de diriger l’Ecole, et
notamment d’ordonner les recettes et les
dépenses ; que l’article 2 de ce même
décret confie à l’ENSICA la mission d’orga-
niser des cours de formation continue ;
qu’il faisait dès lors obligation à la direction
de l’Ecole d’assumer les missions antérieu-
rement dévolues à l’AME ;
Attendu que les formations continues, au
sens classique, n’ont pas été organisées par
l’établissement public ; que I’ENSICA a
continué à confier à l’association AME
l’organisation de cours de formation
continue ; que ce fait apparaît clairement
dans les documents de l’association,
notamment dans sa plaquette de présen-
tation ; que l’association a poursuivi son
activité dans les locaux de l’ENSICA ; que le
site internet de l’ENSICA présente l’AME et
a créé un lien avec elle ; que le dossier de
présentation de l’ENSICA à la commission
des titres d’ingénieurs, rédigé en 1998,
déclare que « l’offre de formation continue
est maîtrisée par l’Ecole, mais prise en
charge pour sa commercialisation et sa réa-
lisation proprement dite par l’AME » ;
Considérant que l’AME n’a cependant signé
aucune convention visant à organiser l’acti-
vité de formation continue ; que l’instruc-
tion n’a pas fait apparaître que l’AME dis-
pose d’un titre juridique pour recevoir les
sommes payées à la suite de la facturation
de cours de formation continue au lieu de
l’ENSICA, alors qu’il s’agit d’actions de la res-
ponsabilité de l’Ecole ;
Considérant dès lors que l’AME n’a pas été
habilitée à percevoir et à encaisser les
revenus de l’activité de formation continue
de l’ENSICA ;
Considérant que le directeur de l’ENSICA est
statutairement président d’honneur de
l’association ;
Considérant que l’association des amis de
l’ENSICA a payé sans titre légal des
dépenses qui ne pouvaient être acquittées
que par le comptable de l’Ecole, notam-
ment une plaquette de présentation du
Mastère Hélicoptère, les frais de stand de
l’ENSICA chaque année au Salon du
Bourget, des frais de voyages d’études (fac-
ture du transporteur, prise en charge du
coût de personnes invitées...) ;
Considérant que les directeurs successifs de
l’ENSICA, MM. Jean-Louis Freson (depuis la
création de l’établissement public jusqu’en
septembre 2001), Bertrand Michaut (depuis
septembre 2001) ont partagé avec l’AME,
personne morale, la responsabilité des opé-
rations irrégulières en organisant et en tolé-
rant l’encaissement par l’AME des recettes
de formation continue et le paiement par
I’AME de dépenses incombant à l’établisse-
ment, et ce jusqu’au 31 décembre 2002,
date à laquelle l’AME a cessé toute activité
de formation ;
Considérant, dès lors, que l’AME et
MM. Freson et Michaut se sont ingérés sans
titre légal dans le recouvrement de recettes
et le paiement de dépenses destinées à un
organisme public doté d’un poste comp-
table, au sens de l’alinéa XI de l’article 60 de
la loi nº 63-156 du 23 février 1963 susvisée
et, qu’en application de cette même loi, ils
doivent rendre compte au juge financier de
l’emploi des fonds qu’ils ont irrégulière-
ment détenus ou maniés ;
Considérant que les faits relevés dans l’arrêt
provisoire du 22 février 2002 constituaient
bien l’infraction susvisée ;
Considérant toutefois que les dirigeants de
l’ENSICA avaient engagé des démarches
chronique financière
41 85eannée - nº 1 - janvier 2005

auprès de la tutelle de l’établissement
public pour faire cesser dès 1999 les faits
générateurs de la gestion de fait et en par-
ticulier pour pallier l’absence d’habilitation
écrite de l’ENSICA autorisant l’AME à perce-
voir des recettes de formation continue ;
Considérant que l’instruction a mis en
lumière la faible importance des sommes
en cause (reversement de l’ENSICA à l’AME)
qui serait globalement inférieure à 3 000 c
sur toute la période ;
Considérant que l’instruction a également
établi que les faits générateurs de la gestion
de fait avaient cessé au 31 décembre 2002 ;
l’AME ne déploie, depuis cette date, aucune
activité de formation continue ;
Par ces motifs,
Statuant définitivement,
Dit qu’il n’y a pas lieu à déclaration de ges-
tion de fait dans les affaires ci-dessus déve-
loppées et relatives à l’ENSICA et l’AME et
que de ce fait, l’injonction et les réserves
prononcées dans l’arrêt nº 32071 du
22 février 2002 sont levées.
Cour des comptes, 1re Chambre,
arrêt nº 38744, 19 février 2004,
Trésorier-payeur général
de la Côte-d’Or
Dépenses ;
primes, indemnités, rémunéra-
tions accessoires.
Circonstances atté-
nuantes ou exonératoires ;
approbation
par les autorités supérieures.
La lecture de l’arrêt ci-dessous (2) se suffit
à elle-même, tant la solution retenue par
la Cour est l’expression de sa jurispru-
dence constante. On relèvera toutefois
que le comptable indiquait, en substance,
qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de sa
hiérarchie. En effet, alors même que le
montant de la prime attribuée excédait le
plafond réglementaire, la prime avait été
attribuée par décision du ministère de
l’Equipement, visée par le contrôle finan-
cier central et appuyée d’une lettre de la
Direction du Budget et de la secrétaire
d’Etat au Budget. C’est très logiquement
que la Cour écarte ces « documents »
comme ne pouvant constituer le fonde-
ment légal du paiement. Or, l’on sait que
si les ministres et le directeur de la Comp-
tabilité publique sont en droit d’inter-
préter la réglementation à l’usage des
comptables, cette interprétation ne peut
s’imposer au juge des comptes
(C. comptes, 20 octobre 1994, Centre
départemental de gestion de la Fonction
publique de la Seine-Maritime,
La Revue
du Trésor
1995.280. C. comptes, 2 mars
1995, Commune de La Ferté-Saint-
Samson,
La Revue du Trésor
1995.546.
C. comptes, 4 mai 1995, Commune de
Canteleu,
Rec. C. comptes
37, concl. du
procureur général ;
La Revue du Trésor
1995.545. C. comptes, 12 octobre 1995,
Commune du Cateau-Cambrésis,
La
Revue du Trésor
1996.28. C. comptes,
1er octobre 1997, Lycée Yves-Thépot à
Quimper,
La Revue du Trésor
1998.165).
En clair, si le ministère des Finances veut
pouvoir attribuer la prime à un montant
supérieur à ce que prévoient les textes,
qu’il fasse modifier ceux-ci...
Extrait
Injonction nº 1 de l’arrêt nº 31 210 du
5 décembre 2001 :
Attendu qu’au cours de l’exercice 1997, le
comptable avait payé une prime de rende-
ment pour la période du 1er janvier 1997 au
31 décembre 1997 au bénéfice de M. Pierre
Debeusscher, inspecteur général de l’équi-
pement en poste à la Direction départe-
mentale de l’équipement de la Côte-d’Or,
pour un montant de 17 020,17 c;
Attendu que l’article 47 du décret du
29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique dis-
pose que les opérations de dépenses sont
appuyées de pièces justificatives prévues
dans des nomenclatures établies par le
ministre des Finances ;
Que la nomenclature, alors en vigueur, des
pièces justificatives de l’Etat diffusée par
circulaire nº CD 1326 du 12 avril 1995 du
ministère du Budget a prévu dans sa partie
annexe que pour les indemnités de rende-
ment, les pièces sont « la décision d’attri-
bution » et « l’état liquidatif et nominatif
faisant référence au texte institutif de
l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en
vigueur » ;
Attendu que l’article 2 du décret nº 45-1753
du 6 août 1945 dispose que les primes de
rendement « essentiellement variables et
personnelles sont attribuées [...] dans la
limite de maxima fixés pour chaque caté-
gorie d’agent et ne pouvant excéder, en
aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé
du grade » ;
Attendu que le décret nº 50-196 du
6 février 1950 a étendu les dispositions du
décret nº 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux
primes de rendement aux corps d’adminis-
tration centrale ; que l’arrêté d’application
du 4 juillet 1974 rend les dispositions pré-
vues par le décret nº 50-196 du 6 février
1950 applicables aux inspecteurs généraux
de l’équipement ;
Que le traitement le plus élevé afférent au
grade d’inspecteur général de l’équipe-
ment est fixé par rapport à l’indice hors
échelle C, 3echevron ; que M. Debeusscher
était dans cette situation et qu’il percevait
la prime de rendement instituée par le
décret du 6 août 1945 ; que le traite-
ment brut établi en référence à l’échelle C,
sur une base annuelle, s’établissait à
57 378,87 c; que dans ces conditions le pla-
fond réglementaire de 18 % s’établissait,
sur une base annuelle, à 10 328,20 c;
Que M. Debeusscher a perçu pour l’année
1997, au titre de la prime de rendement,
un montant de 17 020,17 c, soit un dépas-
sement de 6 691,97 c;
Attendu que, par l’injonction nº 1 de l’arrêt
susvisé, la Cour avait enjoint à M. Dejean
d’apporter la preuve du reversement de la
somme de 6 691,97 cou toute justification
à décharge ;
Attendu, qu’en réponse, les ayants droit du
comptable indiquent que la prime de ren-
dement a été payée à M. Debeusscher au
vu des décisions d’attribution émanant du
ministère de l’Equipement, visées du
contrôleur financier central et conformé-
ment aux termes d’une lettre du
18 décembre 1973 de la Direction du
Budget qui prévoit pour cette prime un
taux plafond de 33 % du traitement le plus
élevé du grade ;
Qu’ils font valoir qu’une lettre de la secré-
taire d’Etat au Budget en date du 6 mai
2002 confirme les bases des versements
effectués en 1997 et demande de
maintenir le régime indemnitaire au béné-
fice des inspecteurs généraux de l’équipe-
ment ;
Attendu que ces documents ne constituent
pas le support législatif ou réglementaire
publié dans les formes légales, postérieu-
rement à l’arrêté du 30 juillet 1974 et anté-
rieurement au paiement, justifiant celui-ci
et qu’ils ne sont donc pas de nature à
dégager la responsabilité du comptable ;
Considérant qu’en vertu des articles 12
et 13 du décret du 29 décembre 1962 por-
tant règlement général de la comptabilité
publique, le comptable payeur est tenu de
s’assurer avant paiement, au titre du
contrôle de la validité de la créance, de
l’exactitude des calculs de liquidation ;
Considérant qu’en l’espèce le contrôle de
l’exactitude des calculs de liquidation
consistait à vérifier que l’indemnité
accordée et payée à M. Debeusscher res-
pectait le plafond réglementaire prévu par
le décret nº 45-1753 du 6 août 1945 ; que
le comptable n’a pas exercé ledit contrôle.
Cour des comptes, 2eChambre,
arrêt nº 39089, 10 mars et 23 mars 2004,
Ecole nationale supérieure
des techniques industrielles
et des mines (ENSTIM) d’Alès (3)
Gestion de fait ;
non-confirmation de la
déclaration provisoire ; absence de rétablis-
sement des formes budgétaires et comp-
tables ; éléments de nature exceptionnelle ;
considérations d’équité.
Défaut de titre légal
Comme on le sait, l’intervention d’asso-
ciations dans la gestion d’activités de ser-
vice public n’est nullement proscrite par
principe par le droit public financier. Elle
suppose seulement que l’association en
cause dispose d’un titre légal l’habilitant à
recouvrer les recettes et à exécuter les
dépenses de l’organisme public
(C. comptes, 24 octobre 1991, Commune
d’Antony,
La Revue du Trésor
1992.136.
C. comptes, 9 juillet 1992, Compagnie des
eaux de l’ozone, Syndicat intercommunal
des eaux de Damazan-Buzet,
Rec.
C. comptes
71 ;
La Revue du Trésor
1992.815. C. comptes, 19 juin 1985,
2 octobre 1985, Cephyten,
La Revue du
Trésor
1986.261).
Ainsi, il n’y a pas gestion de fait s’agissant
d’une association qui organise des ensei-
gnements complémentaires, mais avec
un personnel qu’elle rémunère, l’occupa-
tion des locaux de l’établissement public
ayant fait l’objet d’une convention qui
assure en contrepartie la gratuité de ces
enseignements pour les élèves en cours
de scolarité (C. comptes, 12 mars 1992,
Association des anciens élèves de l’ENPC,
RF fin. publ.
1993, nº 43, p. 146.
C. comptes, 11 septembre 1996, ENSTA,
Rec. C. comptes
84, concl. du procureur
général).
C’est donc bien le défaut de titre légal qui
entraîne l’irrégularité des opérations et la
déclaration de gestion de fait. C’est le cas
par exemple s’agissant de l’encaissement
(2) V. aussi C. comptes, 5 février 2004, Trésorier-payeur
général du Rhône, arrêt nº 38718.
(3) V. aussi, aux mêmes dates, arrêts nº 39091 (Ecole natio-
nale supérieure des techniques industrielles et des mines
de Douai-Armines), 39093 (Ecole nationale supérieure des
techniques industrielles et des mines de Nantes) et 39095
(Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et
des mines d’Albi-Carmaux).
chronique financière
42 85eannée - nº 1 - janvier 2005
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%