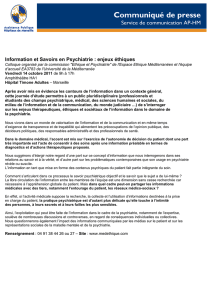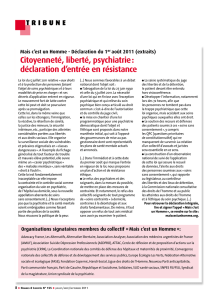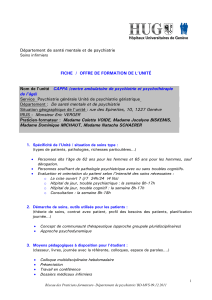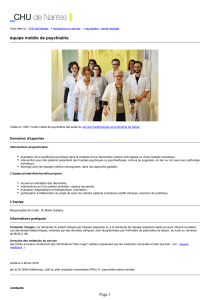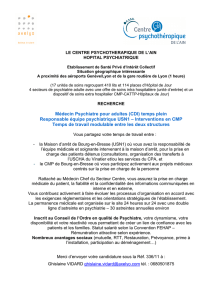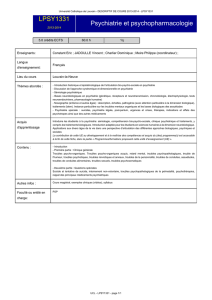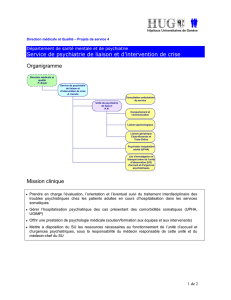Pour une démarche de qualité en psychiatrie appliquée aux

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Pour une démarche de qualité en psychiatrie
appliquée aux pratiques professionnelles...
et aux référentiels de prise en charge
Marie-Christine Hardy-Baylé*
RÉSUMÉ
L’évaluation des pratiques professionnelles ne pose problème en psychiatrie que dans la mesure où les référentiels dits de bonne
pratique proposés par l’Anaes ne sont pas, à ce jour, reconnus comme une « norme » de comparaison acceptable par l’ensemble
de la profession. L’enjeu est donc de faire de l’obligation législative d’évaluation des pratiques professionnelles une opportunité
pour la discipline psychiatrique de structurer le savoir sur les soins sur lequel se fonde sa crédibilité comme discipline médicale
en élaborant des « standards » de prise en charge dans lesquels les praticiens se reconnaîtraient. L’élaboration de tels standards se
heurte à l’absence, propre à la psychiatrie, d’une « épistémologie du soin » contrastant avec une épistémologie clinique d’une très
grande richesse. La qualité des référentiels qui seront finalement retenus comme « norme » de comparaison est désormais sous la
responsabilité des praticiens. Sans leur engagement, ceux-ci pourraient se voir imposer des normes de qualité dont l’élaboration
se fera en dehors d’eux, sans doute, « faute de mieux », par l’application des données de la littérature la plus scientifique.
Mots clés :évaluation des pratiques professionnelles, psychiatrie
ABSTRACT
Quality control in psychiatry as applied to professional practice... and to the care reference framework.
Assessing
professional practice in psychiatry raises only one problem: namely that the reference framework for “proper practice”
proposed by ANAES (French agency for accreditation and health evaluation) is not, to date, recognised as being an
acceptable standard by the entire profession. The challenge is therefore to turn the legal obligation for assessing
professional practices into an opportunity for the psychiatric discipline to organise the knowledge on which its credibility
as a medical discipline is based by elaborating “standards” for treatment which practitioners can identify with. The
elaboration of such standards comes up against the absence, proper to psychiatry, of any “care epistemology” (in contrast
with a very rich clinical epistemology). Responsibility for the quality of the reference frame finally selected as a “standard”
for comparison lies with practitioners. If they do not participate in the process, they risk seeing the imposition of “default”
quality standards elaborated without their advice, by application of data from scientific literature.
Key words:evaluation of professional practice, psychiatry
RESUMEN
Por una mejora de la calidad en psiquiatría aplicada a las prácticas profesionales... y a los referenciales de tratamien-
to.
La evaluación de las prácticas profesionales no supondría un problema en psiquiatría si no fuera porque los referenciales
llamados ″de buenas prácticas″propuestos por laAgencia Nacional de Acreditación y de Evaluación de la Salud (ANAES)
no son, por ahora, reconocidos como una ″norma″de comparación aceptable por la totalidad de la profesión. Lo que está
en juego es que esta obligación legislativa de evaluación de las prácticas profesionales se convierta en una oportunidad para
que la psiquiatría estructure sus conocimientos terapéuticos, sobre los que se funda su credibilidad en tanto que disciplina
médica, a partir de la elaboración de ″estardars″de tratamiento consensuales. La elaboración de dichos estardars es dificil
dado que en psiquiatría no existe una ″epistemología terapéutica″, lo que contrasta con una epistemología clínica de una
gran riqueza. La calidad de los referenciales que, a fin de cuentas, se escogerán como ″norma″está, a partir de ahora, bajo
la responsabilidad de los propios médicos. Sin su implicación se les podrían imponer unas normas de calidad elaboradas sin
ellos, sin duda como ″un mal menor″a partir de la aplicación de los datos de la literatura científica.
Palabras clave :evaluación de las prácticas profesionales, psiquiatría
* Professeur, Chef de service, service hospitalo-universitaire de psychiatrie, hôpital André-Mignot, 177, rue de Versailles, 78150 Le Chesnay.
L’Information psychiatrique 2006 ; 82 : 29-37
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 29
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

La psychiatrie, pour peu qu’elle souhaite rester inscrite
dans le champ des disciplines médicales (ce qui est ici posé
comme un préalable), n’a plus à se questionner sur son
engagement dans l’évaluation de ses pratiques de soin. La
loi l’y oblige aujourd’hui.
Le temps est passé d’une opposition à toute forme d’éva-
luation en psychiatrie. Mais il est essentiel de se convaincre
que le temps est aussi passé d’une implication dans l’EPP
(évaluation des pratiques professionnelles) réduite à une
critique facile de la notion de référentiels de prise en
charge, limitée à l’application de l’evidence based medi-
cine, puisque l’ensemble du monde de la santé, à commen-
cer par la Haute Autorité de Santé (HAS) elle-même, en
reconnaît les limites. Des réponses à ces limites ont
d’ailleurs déjà été apportées. Il s’agit maintenant
d’« inventer » une modalité d’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles adaptée à notre discipline.
Le monde de la santé a continué à tourner sans nous et
l’évaluation des pratiques professionnelles est en passe de
se structurer une fois de plus sans les psychiatres.
La psychiatrie aurait tort de prêter le flanc à une remise
en cause de sa crédibilité comme discipline médicale en
s’opposant à toute démarche de formalisation et d’évalua-
tion de ses pratiques.
L’enjeu aujourd’hui est peut-être de faire de l’obligation
législative d’évaluation des pratiques professionnelles une
opportunité pour la discipline psychiatrique de structurer le
savoir thérapeutique sur lequel se fonde sa crédibilité
comme discipline médicale.
L’évaluation, selon les termes de la HAS [1], impose
une comparaison de la pratique de chaque professionnel, de
chaque structure ou dispositif, avec une pratique considé-
rée comme une pratique de référence : « analyse de la
pratique professionnelle en référence à des recommanda-
tions et selon une méthode élaborée ou validée par la
HAS incluant une mise en œuvre et le suivi d’action
d’amélioration des pratiques ».
La question posée à la psychiatrie est celle du contenu de
ce qui sera posé comme la pratique de référence et de la
méthode de validation des propositions émises.
À ce jour, l’evidence based medicine, qui a représenté la
méthode pour élaborer le contenu des pratiques de réfé-
rence, a montré ses limites.
Les leçons à tirer de cette démarche reposent autant sur
les limites rencontrées que sur les principes qui ont permis
de poser l’évaluation dans un cadre méthodologique pré-
cis :
– l’application de propositions thérapeutiques issues de la
recherche appliquée, en situation réelle, ne va pas de soi,
mais il est nécessaire d’intégrer les données de la recherche
appliquée pour élaborer des standards de prise en charge ;
– ni la justification d’une pratique par la seule théorie ni la
notion d’« accord professionnel » ne constituent une
« preuve » de la pertinence de cette pratique, ce qui est trop
souvent la règle aujourd’hui. Pourtant la nécessité s’impose
d’offrir une validation des stratégies thérapeutiques consti-
tuant « la norme », mais celle-ci ne peut se satisfaire d’une
modalité de validation du type « situation de laboratoire ».
Les référentiels de prise en charge qui seront posés
comme cadre thérapeutique de comparaison sont l’enjeu de
toute cette démarche d’évaluation.
Mais la psychiatrie, plus que toute autre discipline médi-
cale, montre à ce jour d’importants obstacles à la constitu-
tion d’un savoir thérapeutique unifié, qui pourrait consti-
tuer ce cadre thérapeutique de comparaison. Ces obstacles
sont pour partie liés à son histoire. Ils ne pourront pas être
levés sans une volonté et un engagement de tous les acteurs
de la discipline.
Mais, pour relever cet enjeu, il est important de ne pas
diaboliser cette notion de « pratique de référence », dont la
principale vertu, en effet, est d’imposer au praticien
d’expliciter ses choix thérapeutiques. Dans la démarche de
qualité qui convient à l’EPP, l’essentiel est moins d’inscrire
sa pratique dans le cadre fermé d’un quelconque référentiel
que d’inviter les praticiens à argumenter leurs choix théra-
peutiques et, ainsi, de contribuer à améliorer les référentiels
eux-mêmes.
Cette proposition permet de poser le caractère évolutif
que doit garder le référentiel, c’est-à-dire que si, dans une
démarche de qualité, les pratiques professionnelles doivent
être comparées à une « norme », dans ce même souci de
qualité, les « référentiels » eux-mêmes doivent être validés
par la pratique réelle, sous peine d’enfermer les pratiques
professionnelles dans des cadres fixés contrevenant à la
notion même de qualité.
Après avoir rappelé l’importance que prennent,
aujourd’hui, les référentiels, nous évoquerons certains des
obstacles à la constitution d’un savoir thérapeutique en
psychiatrie, consensuel, préservant les acquis de la disci-
pline et validé, et nous ferons quelques propositions pour
que la mise en forme de ce savoir soit adaptée à la pratique
psychiatrique.
Place des « référentiels »
dans la structuration de l’offre de soins
Il est essentiel aujourd’hui de mesurer la place capitale
que les référentiels « de bonnes pratiques » sont en passe de
prendre.
Les praticiens hospitaliers ayant déjà participé ou parti-
cipant à la deuxième vague de l’accréditation (V2) peuvent
constater l’introduction encore timide mais réelle de l’éva-
luation des pratiques professionnelles.
L’enjeu de la V3 est cette mise en conformité des prati-
ques avec une pratique de référence à l’aune de laquelle les
pratiques des professionnels seront évaluées.
La notion de parcours coordonné, fer de lance de la
réforme de l’assurance-maladie, a pour projet de formaliser
les soins proposés (et remboursés !) au patient grâce à des
référentiels de prise en charge adaptés.
M.-C. Hardy-Baylé
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200630
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Il faut souligner par ailleurs que les référentiels de prise
en charge sont amenés à remplir d’autres offices qui, de
manière indirecte, contraindront les pratiques profession-
nelles.
Dès aujourd’hui, la formation professionnelle (forma-
tion médicale continue) réintègre le sein de la HAS. Elle
sera désormais structurée autour des référentiels de bonnes
pratiques et permettra de ce fait de diffuser ceux-ci auprès
des praticiens.
Enfin, l’information au grand public s’appuiera large-
ment sur le contenu dit « scientifique » des référentiels. À
ce titre, le public pourra apprécier la qualité des prestations
qui lui seront proposées et participer, comme acteur des
soins, à sa propre prise en charge.
Ainsi, la question n’est plus aujourd’hui d’être « pour ou
contre » l’existence de référentiels de prise en charge en
psychiatrie. L’enjeu est de construire des référentiels qui
soient adaptés à notre discipline et qui conservent un aspect
évolutif.
Mais la construction de référentiels doit être distinguée
d’une démarche de recherche. J.-M. Danion souligne bien
cette différence dans un article paru dans le Quotidien du
Médecin en date du 9 mai 2005. Dans cet article, il distin-
gue « les recommandations qui visent à mettre en place
des standards de pratiques définissant ce qu’il est appro-
prié et inapproprié de faire dans une situation clinique
donnée, et le recueil et la critique des données scientifi-
ques et médicales disponibles que se donne pour objectif
les expertises collectives ». Nous reviendrons sur cette
distinction essentielle en suggérant que l’évaluation des
pratiques professionnelles est à la pratique ce que la recher-
che appliquée est à la théorie.
Obstacles à la constitution d’un savoir
thérapeutique unifié en psychiatrie
Les théories en psychiatrie ont toujours privilégié une
épistémologie clinique, théorie de l’homme malade, plutôt
qu’une théorie des pratiques de soins, c’est-à-dire une
épistémologie du soin. Les tentatives de certains auteurs,
comme H. Ey, d’élaborer une théorie générale de la psy-
chiatrie, regroupant l’ensemble des données acquises de
manière régionale pour les subsumer dans une théorie inté-
grative, ont certes offert une théorie de l’objet psychiatri-
que mais n’ont pas permis d’offrir à la pratique psychiatri-
que un modèle satisfaisant pour guider les pratiques.
Il se pourrait bien que l’enjeu de la psychiatrie, pour
demain, réside dans sa capacité à poser le cadre d’une
épistémologie du soin, fixant les conditions de possibilité
d’un savoir thérapeutique unifié.
À ce jour, à chaque théorie du fait psychiatrique répond
une clinique spécifique et une approche thérapeutique dont
la seule visée est de s’étendre en se « montrant supérieure »
aux autres. Malheureusement, dans beaucoup d’études, au
nécessaire usage de la méthode comparative ne répond pas
la pertinence clinique des variables à prendre en compte
pour réellement démontrer l’efficacité des techniques étu-
diées.
Mais l’évaluation des pratiques professionnelles se situe
en dehors du cadre strict de l’évaluation des techniques de
soins (quelles soient médicamenteuses ou psychologiques)
et des méthodes ad hoc pour en confirmer l’efficacité,
c’est-à-dire pour prétendre figurer dans l’arsenal thérapeu-
tique de la psychiatrie.
L’EPP permet de répondre de nos prises de décisions et
d’assurer à l’ensemble des patients une prise en charge que
la discipline admet comme la norme, c’est-à-dire la straté-
gie de soins à ce jour la plus pertinente en regard du savoir
mais également de l’expérience acquise.
Ce passage d’approches théoriques de la clinique à une
clinique du soin imposera sans doute, aux différents savoirs
constitués, une redéfinition des concepts de base d’une
théorie de la psychiatrie orientée vers la prise de décision
thérapeutique.
Toute discipline médicale pose son identité sur ses tech-
niques de soins et son influence s’appuie sur l’importance
de son arsenal thérapeutique et d’une bonne connaissance
de l’usage qui doit en être fait. L’acte de naissance de la
psychiatrie dans le champ de la médecine se confond ainsi
avec ce qui l’inscrit dans sa mission : soigner.
Il est classique de dire que la psychiatrie, à l’inverse des
autres disciplines, a accumulé des outils de traitement en
l’absence de toute connaissance sur l’origine des troubles
qu’elle avait à traiter. Mais la psychiatrie n’est pas la seule
discipline médicale dans laquelle l’origine des troubles
reste mystérieuse. Cette méconnaissance n’a pas empêché
l’accumulation de savoirs techniques, dans les autres disci-
plines, selon une approche pragmatique du soin.
À cette position pragmatique de la médecine, visant à
accumuler les savoirs thérapeutiques, la psychiatrie, sou-
vent trop fascinée par une visée plus philosophique que
praticienne, s’est éloignée d’une épistémologie du soin qui
définit, pourtant, toute discipline médicale.
Aujourd’hui encore, le traitement est plus souvent uti-
lisé comme prétexte pour construire et étayer diverses théo-
ries du sujet plutôt que comme un levier thérapeutique
possible imposant de se comparer aux autres pour trouver
sa juste place dans l’arsenal thérapeutique de la discipline.
Si les débats au sein de la psychiatrie ont fait en partie sa
richesse, ils l’ont éloignée de son objet strictement médical,
la pratique des soins. Les risques sont pourtant majeurs, en
l’absence d’un engagement plus radical des praticiens dans
la construction de leurs références en matière de pratiques
de soins, de se voir imposer des normes de qualité dont
l’élaboration se ferait en dehors des praticiens, c’est-à-dire
se réduirait à l’application des données de la littérature la
plus scientifique. Nous retrouvons là la nécessaire distinc-
tion entre l’EPP, reposant sur l’élaboration de « normes
évolutives » de pratiques, et la recherche clinique.
Démarche de qualité en psychiatrie
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 31
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Il faut rappeler que l’evidence based medicine a été, en
son temps, la seule méthode visant à imposer un consensus
là où les professionnels résistaient à le faire. S’appuyant sur
des arguments scientifiques, donc non contestables, cette
approche a permis d’imposer l’idée d’une norme, même si,
du laboratoire à la situation réelle, l’écart a rapidement pu
être souligné.
Mais l’enjeu pour la psychiatrie ne se limite pas, à
l’instar des autres disciplines médicales, à tenter de passer
d’une evidence based medicine à une practice based medi-
cine. L’enjeu est également de ne pas se laisser aveugler par
l’importance des données susceptibles d’être recueillies
grâce à une approche biomédicale des troubles et de préser-
ver, dans une approche globale du soin, l’ensemble des
acquis de la discipline. Cela signifie qu’il importe tout
autant de situer les données biomédicales dans la prise en
charge psychiatrique que de situer l’apport des données
issues de la théorie psychanalytique ou des autres courants
théoriques. À cet égard, une position psychanalytico-
centrée serait tout aussi incapable de résumer les pratiques
en psychiatrie qu’une position neurobio-centrée.
Le risque est de retomber dans la constitution de stan-
dards de prise en charge sur des querelles de chapelle. La
meilleure garantie pour échapper à ce risque est d’inscrire
l’élaboration de référentiels dans une concertation pluri-
professionnelle autour de prises en charge réelles de
patients et de se doter de mesures de validation des « stan-
dards » proposés dans un suivi de leur devenir intégrant
l’ensemble des acteurs y participant.
L’évaluation des pratiques professionnelles doit avant
tout se doter de rationnels de prise en charge adaptés à la
pratique réelle qui puissent constituer des « fondamen-
taux » du soin en psychiatrie. Dans une démarche de qua-
lité, l’évaluation de leurs pratiques impose aux profession-
nels de formaliser et d’argumenter leur prise en charge et
d’en suivre plus rigoureusement les effets, et, à la construc-
tion de « standards » de prise en charge, de s’ajuster aux
données issues de la pratique réelle. L’élaboration de réfé-
rentiels en psychiatrie, comprise comme l’application
d’une démarche de qualité, doit se penser comme un
« retour sur décision de soins ».
Quelques préalables...
L’absence de formalisation des pratiques
en psychiatrie nuit à la crédibilité de la discipline
Il importe d’en connaître les conséquences sur notre
place au sein des disciplines médicales et sur les moyens
qui seront, dans l’avenir, alloués à un pan de la santé dont
l’appartenance au champ sanitaire est loin de s’imposer en
l’absence d’une assise thérapeutique solide, c’est-à-dire
consensuelle et validée.
Nous pouvons faire de l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles une opportunité de lever certaines confusions
pour nous inscrire dans une épistémologie du soin dont
rendraient compte des référentiels adaptés, en acceptant
une certaine forme de réductionnisme, non dans notre
manière de penser et de faire notre métier, mais dans la
formalisation de nos pratiques.
En l’absence de formalisation et d’une validation « en
situation réelle » de nos pratiques, nous risquons bien de
voir les seules pratiques les plus techniques, c’est-à-dire les
plus faciles à expliciter et à valider, être reconnues.
Toute formalisation s’accompagne d’un certain réduc-
tionnisme. Plutôt que de s’y opposer, il importe de s’enten-
dre, au moins sur la nature de la réduction la plus accepta-
ble lorsqu’il s’agit de pratiques professionnelles, au plus
sur le fait que même les faits les plus complexes peuvent,
sans perte d’informations, être explicités. Il s’agit alors
d’élaborer des « marqueurs » de processus, signalant
l’existence des mécanismes d’intérêt thérapeutique, plutôt
que de tenter de proposer des « critères » supposés rendre
compte du processus lui-même.
L’élaboration de référentiels est à la pratique
ce que la recherche appliquée est à la théorie
Un référentiel adapté à la pratique, crédible pour le
praticien, serait composé d’un ensemble de propositions
résumant les connaissances acquises sur lesquelles le pra-
ticien pourrait s’appuyer dans la relation singulière avec
son patient pour choisir pour lui « le meilleur soin ». Car,
aucun clinicien ne peut prétendre à ce jour pouvoir répon-
dre à la question « quel est le meilleur choix thérapeutique
pour ce patient ? » là où une théorie du soin fait défaut. Si
l’ensemble des praticiens peut s’entendre sur un modèle de
description du sujet incluant l’ensemble des lectures que
les théories nous ont léguées, il est laissé à l’appréciation de
chacun, en fonction de ses connaissances propres de tel ou
tel outil de soins, de juger du « meilleur soin ». Ainsi, sur
quels arguments choisira-t-il d’hospitaliser le patient, de lui
prescrire un traitement médicamenteux plutôt que psycho-
thérapique ? Quelles informations lui donner, en fonction
de quel objectif de soins ? Quel type de traitement psycho-
logique lui proposer d’une approche psychanalytique,
cognitivocomportementale ou systémique ? Quel levier de
la relation médecin-malade choisir d’utiliser ? Aucun
modèle ne permet à ce jour de rendre compte de l’influence
mutuelle de ces pratiques, de leurs cibles d’action spécifi-
ques, de leur interaction ou d’effets négatifs potentiels de
certaines associations d’approches thérapeutiques, laissant
ouverte la possibilité d’associer des leviers de soins sans
répondre à la question de leur synergie ou de leur incompa-
tibilité.
Il se pourrait bien que la pratique psychiatrique confron-
tée à la nécessité de situer la place des différentes appro-
ches thérapeutiques soit plus inventive pour le faire que les
théories et ré-invente, dans un au-delà des théories disjoin-
tes, sa propre théorie du soin. Car l’enjeu est bien d’inscrire
M.-C. Hardy-Baylé
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200632
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

la psychiatrie dans le champ des disciplines médicales en
s’appuyant sur une épistémologie du soin qui lui soit pro-
pre.
L’élaboration de référentiels, premier temps d’une éva-
luation des pratiques professionnelles, constitue une oppor-
tunité de renouer avec une clinique « de la pratique quoti-
dienne » pour produire un savoir sur les soins qui puisse
constituer une référence évolutive.
Mais l’élaboration de tels référentiels ne peut pas procé-
der des mêmes exigences que celles de la recherche clini-
que. Le cadre de la recherche clinique se conçoit selon le
schéma classique de toute recherche et, en matière d’éva-
luation d’impact thérapeutique, impose l’utilisation de la
méthode comparative. Le cadre de l’essai clinique rando-
misé peut tout aussi bien être appliqué à l’évaluation du
médicament qu’à celle de techniques psychothérapiques,
pour peu que le cadre méthodologique général pose les
variables pertinentes pour une « juste » évaluation des pra-
tiques comparées. De plus en plus d’études de grand intérêt
introduisent d’ailleurs, à ce jour, dans le cadre d’essais
randomisés, un « bras » psychothérapique.
Nous sommes, dans le cadre d’une démarche de qualité,
bien loin des exigences de la recherche appliquée, qu’elle
soit pharmacoclinique, psychanalytique, cognitivocompor-
tementale ou systémique. Si l’élaboration de référentiels
adaptés intègre certaines des données issues de cette
recherche appliquée, elle procède d’une tout autre démar-
che, que Peterson (cité dans Études pragmatiques de cas,
D.B. Fishman, 2004) qualifie, dès 1991, d’« investigation
contrôlée ».
En matière de recherche appliquée, la théorie neurobio-
logique ne procède pas autrement que la théorie psychana-
lytique, la théorie cognitivocomportementale ou la théorie
systémique (pour ne prendre que les plus renseignées) pour
valider la technique de soins qu’elle propose. Cependant,
même si toute technique de soin spécifique doit apporter la
preuve et les conditions de son efficacité pour figurer dans
l’arsenal thérapeutique de la psychiatrie, l’évaluation de
ces différentes techniques de soins ne procède pas du même
schéma. C’est dans le cadre de la théorie qui lui a donné
naissance qu’une technique de soin peut élaborer sa propre
méthode de validation. En réalité, si, dans tous les cas, il
s’agit d’une recherche appliquée qui doit se soumettre à
démonstration et intégrer à un moment de ce processus de
validation la méthode comparative, le cadre méthodologi-
que général, c’est-à-dire les variables prises en compte, le
délai attendu de la réponse, la nature de l’objectif à attein-
dre, le périmètre du contexte renseigné ou
l’« encadrement » de la technique de soin effectivement
mise en œuvre, sera très variable d’une technique à l’autre.
Nous sommes là dans le cadre de la recherche clinique
appliquée à telle ou telle théorie qui prétend relever du soin
en psychiatrie. L’évaluation des psychothérapies trouve sa
place dans ce type de recherches cliniques.
La construction de référentiels adaptés à l’évaluation
des pratiques professionnelles en psychiatrie devrait procé-
der d’une autre démarche, plus proche de ce que la HAS
nomme la « démarche de qualité ». Cette démarche porte
en elle l’idée d’une norme évolutive et d’un ajustement
permanent entre les données de la pratique et l’évolution du
rationnel de prise en charge. Ce qu’il s’agit de renseigner
dans les stratégies de prise en charge qui, à un moment
donné de la démarche, seront posées comme « norme », est
issu à la fois de l’expérience acquise des différents profes-
sionnels, acteurs du soin, et des données issues de la recher-
che appliquée. Cette démarche impose à la fois d’expliciter
nos rationnels de prise de décision, de formaliser la nature
des pratiques réellement mises en œuvre et de procéder à
une validation de nos prises de décisions de soin (sur le
mode du « retour sur décision ») par un suivi du devenir du
patient. Nous renouons là avec une épistémologie du soin.
Si l’objectif poursuivi par la HAS, élaborer des prati-
ques dites de référence pour l’ensemble des disciplines
médicales, relève bien de l’intention de constituer un savoir
thérapeutique et, à ce titre, s’inscrit dans une épistémologie
du soin, la méthode choisie pour en élaborer les contours ne
répond pas aux principes d’une épistémologie unifiée,
visant à rassembler l’ensemble des savoirs thérapeutiques
issus des regards théoriques divers qui ont chacun enrichi la
discipline psychiatrique.
Cette méthode privilégie le savoir biomédical au détri-
ment des autres connaissances acquises en privilégiant les
données recueillies selon les normes du savoir scientifique.
En cela, elle se comporte comme une recherche appliquée
et non comme une investigation contrôlée des stratégies
thérapeutiques. Elle construit un modèle des soins réduit à
l’application des seules données biomédicales, dont le
niveau de preuve répond aux exigences de cette seule
démarche scientifique. Par ailleurs, ces données ont été
obtenues selon une méthode bien différente de celle de
l’acte thérapeutique en situation naturelle, la méthode
expérimentale, dans laquelle le cadre construit artificielle-
ment une clinique adaptée à sa recherche. En somme, la
démarche dite de l’evidence based medicine s’oppose, par
principe, à une démarche « centrée par le patient ». Cette
dernière, pour se construire, doit adopter une méthode
adaptée à son objet, pour définir des « généralisables » ne
négligeant aucun des facteurs pris en compte par la disci-
pline et s’inscrivant dans une théorie de la décision qui est
celle qu’adopte le psychiatre lorsqu’il se comporte en pra-
ticien.
Si recherche et démarche qualité méritent d’être distin-
guées, ce n’est pas seulement parce qu’elles procèdent
d’une démarche de validation très différente et que les
objectifs visés ne sont pas comparables.
Cette distinction se justifie aussi par le fait que l’adop-
tion, par la discipline, d’une réelle démarche d’améliora-
tion des pratiques imposera, en retour, à la recherche appli-
quée de répondre à des questions que la pratique lui
Démarche de qualité en psychiatrie
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 33
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%