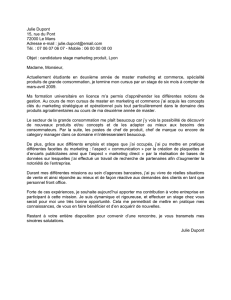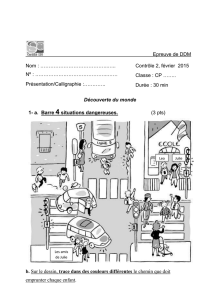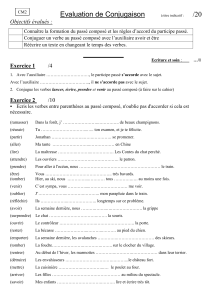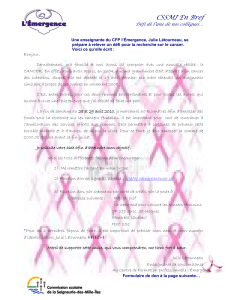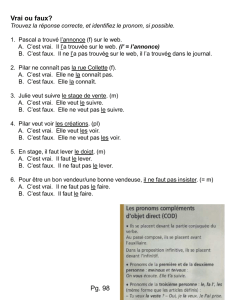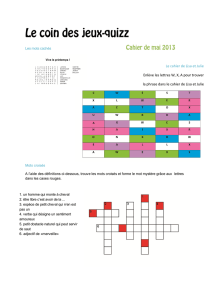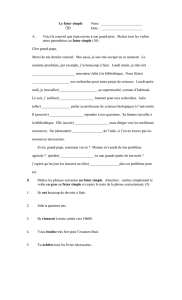pacamambo - Agence SINE QUA NON

L’Explique-Songe présente
PACAMAMBO
DE WAJDI MOUAWAD
Mise en scène : Valérie Castel Jordy
L’Explique-Songe
Directrice artistique : Valérie Castel Jordy
06 84 84 66 19 / expliquesonge@yahoo.fr

2
PACAMAMBO
de Wajdi Mouawad
Projet de mise en scène pour la saison 2011/2012
Production : L’Explique-Songe
Spectacle Jeune Public destiné aux collégiens
Mise en scène : Valérie Castel Jordy
Costumes : Angélique Calfati
Lumière : Christine Mame
Avec :
Aurélie Babled… (distribution en cours)
« Il existe un lieu, un pays où tout nous ressemble. »
« La Lune est la grande lampe allumée dans le ciel,
Pour que ceux qui savent lire le ciel
Puissent découvrir la route qui conduit à
Pacamambo.
Et Pacamambo, c’est vraiment le lieu de toutes les
lumières. (…)
C’est le pays de l’empathie générale.
C’est ce qu’elle dit toujours, ma grand-mère.
A chacun de décider. (…)
Pacamambo, c’est le pays où l’on n’arrive jamais.
Ca encore, Marie-Marie me le disait.
Dans la vie, on y n’arrive jamais, on y rêve ! »

3
SYNOPSIS
Julie, jeune adolescente de douze ans, a été retrouvée après une disparition de trois semaines.
Elle a perdu sa grand-mère. Le psychiatre use de douceur et de fermeté envers elle pour
comprendre pourquoi elle s’est cachée avec son chien au pied du corps de sa grand-mère loin
de tout regard, de tout bruit, dans la cave. Julie est muselée par la colère, mais peu à peu la
parole se libère et la douleur laisse place à l’apaisement. Julie est du côté du rêve, celui que sa
grand-mère lui a légué dans la mort, le rêve de Pacamambo…
Le deuil, sujet ambitieux et délicat à aborder pour un public d’enfants et d’adolescents. La mort
si difficile à dire et qui se montrera ici sous son plus beau jour, celui de l’amour. Loin d’un
paysage de désolation, nous ferons sonner la rage de Julie avec des airs de jazz et la lourdeur
apparente de la situation deviendra légère comme une plume, le poids de l’âme nous guidera…
Proche de la mort, la vie se révèle claire et pleine d’humour, cocasse dans les replis du rituel et
des gestes de tendresse.
PROPOS DE L’AUTEUR
« Toute écriture prend sa source dans des imaginaires qui l’ont précédée. La petite histoire de
Pacamambo s’abreuve à plusieurs écritures. À ceux qui aiment lire et qui ont lu ou vont lire, je
tiens à dire que pour construire cette histoire je me suis inspiré de deux textes principalement.
Tout d’abord, d’un roman gigantesque qui m’a transformé et profondément bouleversé : Mort à
crédit de Louis-Ferdinand Céline. Ceux qui connaissent ce roman reconnaîtront probablement le
personnage de Caroline dans le personnage de la grand-mère de Julie.
Ensuite, il y a la fin du roman La Vie devant soi de Romain Gary où le petit Momo se réfugie dans
la cave de l’immeuble avec le cadavre de Madame Rosa, qu’il parfumera et maquillera. C’est de
ce roman que l’idée d’enfermer Julie avec le corps de sa grand-mère me vint.
Pour le reste, c’est-à-dire la révolte et la colère de Julie, je dirais qu’elles me furent inspirées
par une autre sorte d’écriture : la guerre du Liban. »
CITATIONS
Extraits de La Vie devant soi de Romain Gary
« Madame Rosa et moi, on peut pas sans l’autre. C’est tout ce qu’on a au monde. Elle voulait
pas me lâcher. Même maintenant, elle ne veut pas. Encore hier, j’ai dû la supplier. Madame
Rosa, allez dans votre famille en Israël. Vous allez mourir tranquillement, ils vont s’occuper de
vous, là-bas. Ici, vous êtes rien. Là-bas, vous êtes beaucoup plus. »
« Elle n’avait pas bonne mine même dans l’obscurité et j’ai allumé toutes les bougies que je
pouvais, pour la compagnie. J’ai pris son maquillage et je lui en ai mis sur les lèvres et les joues
et je lui ai peint les sourcils comme elle aimait. Je lui ai peint les paupières en bleu et blanc et
je lui ai collé des petites étoiles dessus comme elle le faisait elle-même. J’ai essayé de lui coller
des faux cils mais ça tenait pas. Je voyais bien qu’elle ne respirait plus mais ça m’était égal, je
l’aimais même sans respirer. »
« Je suis redescendu et je me suis enfermé avec Madame Rosa dans son trou juif. Mais j’ai pas
pu tenir. Je lui ai versé dessus tout le parfum qui restait mais c’était pas possible. Je suis
ressorti et (…) j’ai acheté des couleurs à peindre et puis des bouteilles de parfum (…). Je ne
voulais rien manger pour punir tout le monde mais c’était même plus la peine de leur adresser
la parole (…). »
« Quand ils ont enfoncé la porte pour voir d’où ça venait et qu’ils m’ont vu couché à côté, ils se
sont mis à gueuler au secours quelle horreur mais ils n’avaient pas pensé à gueuler avant parce
que la vie n’a pas d’odeur. »

4
EXTRAITS DE LA PIÈCE
« JULIE : Je crois que la Mort est passée, le Gros.
Je crois que la Mort,
Avec sa grosse face ronde,
Sa face de citrouille, est passée !
Le Gros,
Je crois que la Mort est arrivée avec ses gros sabots.
Et c’est elle qui laisse derrière elle ce grand bruit de galop.
Sans dire « ouf » Marie-Marie est partie !
La Mort a gagné,
Mais on va pas laisser faire !
Viens avec moi, le Gros.
On va lui jouer un tour, à la Mort.
On va la prendre par la peau du cou, tu vas voir.
On va lui dire notre façon de penser.
Tu veux ? »
- - - - -
« JULIE : Viens ici, que je te mette du parfum.
LE GROS : Wgrrrrrrrr ! Hrwaff ! Hrwaff ! GRRRRRRRR ! (…)
JULIE : Sage, le Gros. (…)
LE GROS : Yeark ! ça pue !
JULIE : Hummmmm, ça sent bon par exemple !
On en essaye une autre ? »
- - - - -
« MARIE-MARIE : Julie,
Il y a tant et tant de choses que je voudrais te dire :
Retourner à la lumière,
Retrouver tes jeux d’enfants,
Retrouver ton cœur d’enfant !
Mais je peux juste continuer à te regarder,
Incapable de te parler.(…)
Je voudrais te dire aussi tous les pétales de rose qu’il a fallu
Pour faire les parfums que tu as entre les mains aujourd’hui.
Tu me regardes et tu pleures,
Et c’est Pacamambo qui te coule des yeux.
Et tu m’asperges de ton amour. »
- - - - -
« LA MORT : Julie, un jour toute chose me suivra,
L’une après l’autre.
Un jour l’univers lui-même me connaîtra.
Les planètes, les étoiles, la terre
Et tous les animaux. (…)
JULIE : Vous parlez comme mon prof de chimie,
Et ça me gonfle !
Moi, la Mort, je vous dis d’aller vous faire cuire un œuf ! »

5
NOTE D’INTENTION
Je souhaite m’adresser aux adolescents. Pacamambo est une pièce pour eux, une langue qui
parle à tous et à l’adolescent en particulier. Wajdi Mouawad trouve l’endroit juste pour parler de
cet âge entre deux âges. Le franc-parler de Julie en est le signe. On oublie vite cette période, on
en parle peu quand on est adulte comme si c’était gênant ou peu glorieux d’y revenir. L’âge
ingrat, qu’est-ce que cela veut dire ?
Julie a des idées à l’emporte-pièce et c’est cela qui fait son charme, mais son regard s’affine au
fur et à mesure de la progression de la pièce et de sa compréhension du monde. Quand la mort
est passée et a emporté Marie-Marie, Julie est prise d’une colère qui la dépasse. Cette rage
devant la perte de sa grand-mère est sa première réaction, une révolte face à la condition
humaine. Elle n’en fait qu’à sa tête et souhaite rencontrer la mort pour la vaincre. Ce combat
impossible l’empêche de vivre. Son chemin au fil des mots sera d’accepter la réalité de
l’existence et de pouvoir à nouveau vivre et grandir forte de cette acceptation.
Le peuple noir a une importance vitale pour Julie. Cela lui a été transmis par Marie-Marie. Julie
est maladroite dans ses propos, mais on voit bien où elle veut en venir quand elle s’insurge
contre le racisme. Elle reprend les idées de sa grand-mère à sa façon, fougueuse et emportée.
La pièce retranscrit bien le décalage entre la pensée mesurée d’une vieille dame et la façon dont
une jeune fille la dynamite. Sa pensée va dans tous les sens et répond à un besoin urgent d’être
dite à voix haute. Une fois que la digue a cédé, Julie ne peut plus arrêter le flot de paroles et
cette énergie brutale et instinctive, nous la porterons à la scène.
« C’est le pays de l’empathie générale ». Pacamambo est une façon pour Marie-Marie
d’apprendre à sa petite-fille l’importance de la compassion. Pour Julie, ressentir de la
compassion, c’est avoir la peau noire. Le deuil conduit Julie à prendre des décisions
importantes, comme ne plus avoir la même couleur de peau. Changer de peau devant la mort
d’un être cher, c’est s’inscrire dans le flux des générations et devenir dépositaire de sa propre
enfance. Les tissus même de la peau changent et palpitent violemment. Le corps tout entier de
Julie crie comme le peuple noir outragé.
Marie-Marie a légué le mystère de Pacamambo à Julie pour lui dire de regarder « de face, de
côté, et de biais, par au-dessus et par-dessous ». Elle lui a appris à regarder autrement et c’est
cet autre regard qui sera le moteur de la mise en scène. « Dans la vie, on n’y arrive jamais, on y
rêve ! ». Pacamambo, c’est une façon de nommer le royaume du ciel avec un air de jazz. Le
royaume du ciel est déjà en chemin, il peut être ici et maintenant. C’est à nous d’y rêver, de
l’inventer. Le discours de Martin Luther King prononcé en 1963 sur les marches du Lincoln
Memorial n’en est-il pas un symbole ardent ?
« Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo :
“Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux.”
Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des
propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. (…)
Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront
pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne. Je fais ce rêve
aujourd'hui ! (…)
Je fais le rêve qu'un jour chaque vallée soit glorifiée, que chaque colline et chaque montagne
soit aplanie, que les endroits rudes soient transformés en plaines, que les endroits tortueux
soient redressés… »
Aux pays de Pacamambo, on ne se demande pas si un homme est un homme. Tout le monde
mange « à la table de la fraternité » et le sol ne se dérobe pas sous les pieds. Pacamambo est
une histoire, un conte pour s’endormir ou une foi en la vie qui ne s’éteint pas. Chacun est libre
de voir son étoile. Pacamambo est une pièce de théâtre qui parle de la mort et du deuil sans
détours et sans fioritures avec l’humour, la pudeur et la distance qui caractérisent bien
l’écriture de Wajdi Mouawad. Pacamambo est l’ailleurs rêvé qui permet à la jeune fille de rester
vivante et joyeuse dans ce monde. Que pourrions-nous sans l’imagination et l’espoir ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%