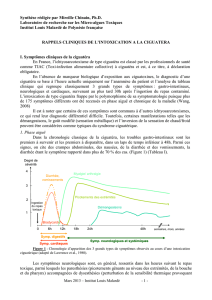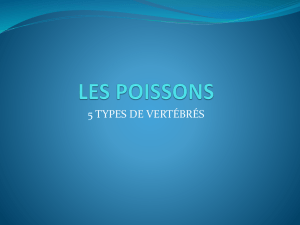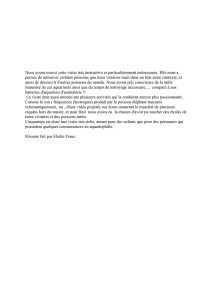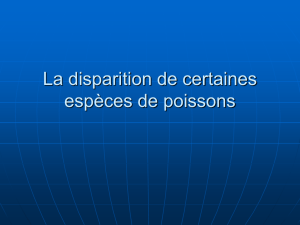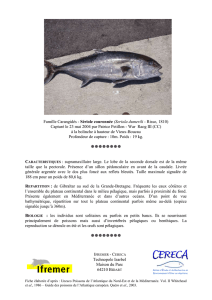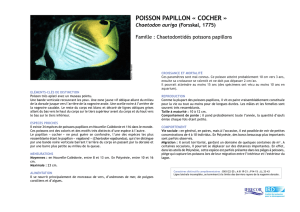La ciguatera : un état des lieux en France et dans l`Union européenne

La ciguateraest l’intoxicationliéeàlaconsommationdepoissons
la plus fréquemment rapportéedans le monde avec 10000 à50000cas
estimés paran. D’après le Center of DiseaseControl,2à10%descas
sontrapportés(Efsa, 2010). La ciguateratoucheprincipalementles
habitants desrégions endémiques: OcéanPacifique, OcéanIndien
et Caraïbes. Certains cas sontliésàlaconsommationdepoissons
importésdeces zones.
La ciguatera:généralités
La ciguatera, dontleterme aété défini par Poey en 1866,existedepuis
dessiècles (Marcaillou-Le Baut et al. 2001). Le syndrome clinique
associedes symptômesgastro-intestinaux(nausée,vomissements,
douleursabdominales, diarrhées),neurologiquesimpliquant des
troubles de la sensibilité(hyperesthésie,paresthésie,dysesthésie),
musculaires, articulaires, cutanées(prurit,d’oùl’appellation de gratte
dans certaines régions), cardiovasculaires(bradycardie, hypotension),
d’intensitévariableetapparaissanten30minutes à48h selon
la gravitédel’atteinte. Lessymptômesgastro-intestinaux disparaissent
généralementenunàquatrejours sans traitementparticulier mais
certainssymptômes, principalementneurologiques, peuventperdurer
pendant plusieurssemaines, voire mois.Des cas de ciguaterachez des
femmesenceintes ontmontréque lestoxines passentlabarrière
transplacentaire.Elles passentégalementdans le lait.Par ailleurs
dans certains cas,unphénomène de sensibilisationaété observé
avec réapparitiondesymptômesaprès consommationdepoissons
n’entraînantpas d’effets chez d’autres consommateurs. Desdifférences
régionales ontété notées dans la clinique et peuventêtreattribuées
àlaprésence de ciguatoxines différentes. Lesdécès sontrares
(Bagnis et al. 1979, Ruff et al. 1994). Aucun antidote n’est disponible;
le traitementrestesymptomatique. L’administrationintraveineuse
de mannitol entraîne unerégressiondes symptômess’ilest administré
dans les48h,voire plus,après intoxication(Palafox et al. 1988,Blythe
et al. 1994). La médecine traditionnelleest cependant très utilisée,
notammentenPolynésie (Rossi et al. 2012).
L’espècedemicro-algue unicellulaire benthique Gambierdiscustoxicus
aété identifiée en 1977 comme étantl’agent causal de la ciguatera
(Figure1)et depuis, dixautresespèces ontété décrites(Yasumoto et
al. 1977,Bagnis et al. 1980,Litaker et al. 2009). Le genre Gambierdiscus
coexiste souventavecd’autresdinoflagellés toxinogènesdes genres
Ostreopsis,Prorocentrum,Coolia et Amphidinium,cequi pourrait
contribuer aussiaucocktailtoxinique associé àlaciguatera.En2003,
Gambierdiscus sp.aété mis en évidenceenMéditerranéesur la côte
crétoise et en 2004,enAtlantiquedans lesarchipelsdes Canaries.
La présencedepoissons contenantdes composés ciguatoxines-like
aété miseenévidenceenIsraël (Bentur et al. 2007). En 2011,l’espèce
La ciguatera :
un
état deslieux
en France et dans l’Union
européenne
Virginie Hossen (virginie.hossen@anses.fr)(1),PierreVelge (2), Jean Turquet (3), Mireille Chinain(4),DominiqueLaurent(5),Sophie Krys (1)
(1)UniversitéParis-Est, Anses, Laboratoire de sécuritédes aliments,Laboratoire national de référencepourlecontrôledes biotoxinesmarines,
Maisons-Alfort,France
(2)Directiongénéraledel’alimentation,Bureau desproduitsdelamer et d’eau douce,Paris,France
(3)Agencepourlarecherche et la valorisationmarines, La Réunion, France
(4)Institut Louis Malardé,Laboratoire de recherchesur lesmicro-alguestoxiques, Papeete,Tahiti, France
(5)Institut de recherchepourledéveloppement, Papeete,Tahiti, France
Résumé
La ciguatera estune intoxication alimentaireliéeàla
consommation de poissons inféodés auxmassifscoralliens
ayantaccumulédes ciguatoxines.Lesyndrome clinique
associedes signes digestifs, neurologiques,cutanés, cardio-
vasculaires et respiratoiresd’intensitévariable.
La réglementation européenneinterditlamisesur le
marchédepoissons contenantdes ciguatoxines mais ne
précisepas de seuil réglementaire. Or,laFrance estundes
pays européens lesplustouchés parcette problématique
parlasurvenued’intoxications régulièrementrapportées
dans certainsdépartements et régions d’outre-mer.En
PolynésieetàLaRéunion,des programmesdesurveillance
ontété misenplace depuisplusieurs annéesetpermettent
d’acquérirdes données épidémiologiques tout en gérant
au mieuxlerisquelocalement. Jusqu’alorscantonnés aux
régions endémiques dans l’OcéanPacifique, l’OcéanIndien
et lesCaraïbes, descas de ciguatera ontété misenévidence
depuis2004après consommation de poissons toxiques
pêchésdans leseauxatlantiques subtropicales européennes
(archipelsdeMadèreetdes Canaries), montrantune
extensiondes zonesciguatérigènes, peut-être favorisée
parleréchauffementclimatique. La problématique de la
contamination desproduitsdelapêche parles ciguatoxines
doit doncêtreprise en compte notammentsur lespoissons
en provenancedeces archipelsappartenant l’Union
européenne, et lesscientifiques doiventsemobiliserpour
faireavancer la connaissancesur le sujet.
Mots clés
Ciguatera, poissons,intoxicationalimentaire, zone tropicale,
surveillance
Abstract
Ciguatera,anupdate in France and theEuropeanUnion
Ciguatera is ahuman poisoning duetothe consumption
of fish usuallylivingincoral reef environment, contaminated
with ciguatoxins. Clinical syndrome is characterized
by gastrointestinal, neurological,cutaneous, cardiovascular
and respiratorydisturbances, of variable intensity.
EU regulation statesthatchecksare to take place to ensure
that fisheryproductscontainingtoxinsincludingciguatoxins
arenot placedonthe market butdoesnot precise any
regulatory limit.
France is oneofthe most concerned European countriesdue
to thefrequent outbreaksreporting in itsoversea territories.
InPolynesiaandLaRéunion,monitoringprogramsareinplace
since severalyearstocollect epidemiological data andbetter
managethe risk locally.
Ciguatera used to be presentinthe Caribbean,Indo-Pacific
islands, and theIndian Ocean,but since 2004,outbreaks
linked to contaminated fish fished in subtropical Atlantic
European waters (Madeiraand Canariesarchipelagos)have
been reported,suggestinganextensionofciguaterigenic
areaspossiblylinkedtoglobalwarming. Thus,ciguatoxins
contaminated fisheryproductsissue should be taken into
account, particularlyonfishes fromarchipelagoesbelonging
to theEU, and scientists should makeevery efforttoconduct
research on this subject.
Keywords
Ciguatera fish poisoning, tropical area,monitoring
Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentationn
o56 3

(1)Guadeloupe, Saint-Martin,Guyane, MartiniqueetRéunion. Mayotteau1
er janvier2014.
(2)Les Açores et Madère.
(3)IlesCanaries.
Gambierdiscusexcentricus sp.nov.présente dans lesCanariesaété
décrite pour la première fois et pourrait être àl’originedes cas de
ciguaterarapportés (Fraga et al. 2011).
Gambierdiscus se fixe sur lesalguesmacrophytes quisontbroutées
par despoissons herbivores. Lestoxines produitess’accumulent
ainsidans leursmuscles et viscères, puis sonttransféréeslelongde
la chaînetrophique despoissons;les carnivores en bout de chaîne
sont lesplussusceptiblesdecontenirdes quantitésélevées de toxines,
d’autant plus s’ilssontgrosetâgés. Lespoissons contaminés ne sont
pasvisuellementdétectables.Plusde425 espèces de poissons ontété
associées àdes cas de ciguatera.
Gambierdiscus est capabledeproduire plusieurstoxines, notamment
desgambiertoxines quisontles précurseursdes ciguatoxines (CTXs),
et desmaïtotoxines. Cesdernières, hydrophiles, sontpeu susceptibles
d’induire uneintoxicationchez l’Homme, carelles ne sontpas
bioaccumuléesetlacomparaison desdoses aigües (DL50) parvoie
intra-péritonéaleetperossuggèreune très faible absorption.Les CTXs,
lipophilesetbioaccumulées, agissentenmodifiant la perméabilité
membranaire descanauxsodiquesvoltage-dépendantsetaltèrent
la transmissionneuromusculaire.
Il existe plusieursgroupes de CTXs,classés en fonction desrégions
dans lesquels ilssontprésents:P-CTXs(Pacifique),C-CTXs(Caraïbes)
et I-CTXs (Océan Indien). Lesstructures desdifférentsanaloguesn’ont
pastoutesété élucidées. LesCTXssontdes polyétherspolycycliques
(Figure2)thermostables;elles ne sontdétruites ni parlacuisson ni par
la congélation despoissons.
Actuellement, le diagnostic descas de ciguateraest fondésur
la clinique et,dans certainscas,sur la détectiondes CTXdans lesrestes
de poissons àl’originedel’intoxication.
La difficulté analytique tientàlamultiplicitédes toxinessusceptibles
de contaminer lespoissons.Ilexisteplusieurs méthodesd’analyse
utilisant différents principes(Krys et al. 2001,Caillaud et al. 2010):
•lesméthodes biologiques, en particulierlebioessaisur souris,
quiconsiste àinjecterunextrait de poissons par voie intra-
péritonéalepuisàobserverles symptômeset/ou la mortalitéaprès
24 h. Il permet de détecter unetoxicitéglobalesans nécessiter
l’utilisationdesolutionétalon, maisal’inconvénientd’êtrepeu
sensible et peuspécifique ;
•le test de cytotoxicitéfondé sur leseffetsdes toxinessur la viabilité
de lignéesneuronalesneuro2Aenculture;
•le test fonctionnelRBA (ReceptorBinding Assay),utilisant la
reconnaissanceentre le ligand-CTX et son récepteur-canal sodium
desmembranesdes cellules nerveusesetmusculaires, exploitant
ainsilavoie neuro-pharmacologiquedes CTXs.Les méthodes
fonctionnelles informentsur l’activité biologiquedes composés;
•lestestsimmunologiques, utilisantlareconnaissanceentre lesCTXs
et desanticorpsanti-CTX;
•lesanalyseschimiques notammentlaLC-MS/MSqui permettent
d’obtenirleprofiltoxinique.
Hormis le bioessaisur souris, la plupartdeces techniquesrestent
compliquées àmettreenœuvre et l’analysechimiquenécessite
en outreunappareillage coûteux. Acejour, aucuneméthoden’est
validée.L’absencedestandardspourlagrandemajoritédes analogues
constitueunfrein pour la miseenplace et la validationdeces tests.
L’Agenceeuropéenne de sécuritédes aliments arendu un avis en 2010;
lesexperts n’ontpuproposerdevaleurtoxicologique de référenceen
raison du peudedonnées expérimentalesetépidémiologiques mais
ontnéanmoinsconcluqu’unedosede0,01µgéquivalentP-CTX1/kg
ne devraitpas induire d’effets chez lesindividusles plus sensibles(Efsa,
2010).
Surveillance et réglementation
Au sein de l’Unioneuropéenne (UE),seuls la France (1),lePortugal (2)
et l’Espagne(3) possèdentdes régions ultrapériphériques(RUP),situées
en zonestropicales très largementendehorsducontinenteuropéen.
Dans l’UE,cesontessentiellementles habitants desRUP quisont
exposés àlaciguatera.Par ailleurs, trois grands territoiresautonomes,
associésàlaFrance, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et
Wallis &Futuna sontdes zonesoùsévit la ciguatera, posant dans
certaines de ceszones de réelsproblèmes de santépublique.
L’UE n’apas mis en placeàcejourdeseuil réglementaire ni afortiori
défini de méthode(s) analytique(s) applicable(s) pour lesCTXs,
bienque le règlement(CE)No854/2004 du 29 avril2004précise que
«des contrôlesdoivent être effectués[parl’autoritécompétente] pour
veilleràceque […]les produits de la pêchecontenant desbiotoxines,
telles que la ciguateraoud’autrestoxines dangereuses pour la santé
humaine, ne soient pasmis surlemarché».
En l’absencededirectives européennessur lesCTXs, la Franceaprisdes
mesures pour protéger lespopulations desRUP parlebiais d’arrêtés
Figure1. Observationd’une cellulede
Gambierdiscustoxicus
au microscope électronique àbalayage
PhotoDr. MariaA.Faust, DepartmentofBotany, NMNH,
SmithsonianInstitution,WashingtonD.C., USA
Figure2. Structurechimiquedes ciguatoxines
Source:Efsa
4Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentationn
o56

préfectoraux. Ceux-ciinterdisentlamisesur le marché de certaines
espèces de poissons endémiquessusceptiblesdecontenir desCTXs
(Figure3).Ces listes sontmises àjourrégulièrement, en particulier quand
unenouvelleespèceest identifiée comme responsabled’une intoxication
alimentaire collective (TIAC) accompagnée de symptômesciguatériques.
CesTIACsontsystématiquementsuivies par lesagentsencharge
de la sécuritésanitaire desaliments afin de confirmer la présence
de CTXs.Les restes de poissons consommés, s’il yena,sontenvoyés
pour analysepar bioessai sur souris dans l’un desdeuxlaboratoires (4)
agréés parleministère en charge de l’agriculture.
En Guadeloupe depuisdébut2012, 30 intoxications ontété
rapportées (5),occasionnant57malades;l’analyse desneufrestes
de repasayant pu être récupérésaconfirmélacontamination.
Enfin, ce dispositif seracomplété en 2013 parlarecherchedes CTXs
parbioessaisur souris sur leslotsprésentésàl’importation au niveau
desPostesd’inspection frontalier(PIF) (6) en Francemétropolitaine.
Ce plan de surveillance (7) concerne lesespèces de poissons faisant
partied’aumoinsune deslistesd’espèces àrisques desRUP.
Leslotssoumis àprélèvementserontchoisis sur unebasealéatoire
en utilisantune grille de tirageausort. Ce dispositif apportera une
sécuritéalimentaire supplémentaire.
Certains départements et territoires ontmis en placeunsystème
de surveillancelocal;c’est le cas de l’îledeLaRéunion, de Mayotteet
de la Polynésie française.
Casdel’île de La Réunion
Dans l’OcéanIndien, la ciguateraaété identifiée historiquementàl’île
MauriceauXIXesiècle(Halstead et al. 1973). Si la zone d’endémicité
reconnue est bienl’archipel desMascareignes, lesdonnées
épidémiologiques restentfragmentaires.
ÀLaRéunion, le recueil de cesdonnées s’est fait au traversdequatre
enquêtes coordonnées par l’AgencepourlaRechercheetlaValorisation
Marinesetcouvrant la périodede1986à2010(Quod et al. 1996,
Sève et al. 2011). L’analyseépidémiologiquemontrequ’au coursdes
années1986-1999,484 cas de ciguateraont étérecenséset150 cas
sur 2000-2010. La ciguaterareprésente 80 %des cas d’intoxication
alimentaire parles poissons.
Le taux d’incidence (TI) annuelest variableetreste faible
par rapportàd’autresrégions d’endémicitécigua-tériquecomme
la Polynésie française. Entre1986et1999,ilest estiméà0,8 cas
pour 10000 habitants,età0,2 entre2000 et 2010.Lacomparaison
desTIentre lesrégions est cependantdifficile.Cette difficulté peut
être dueàune différencedeniveaux de consommationdepoissons.
En 2009,suite àune vague d’intoxications,lasurveillance épidémiologique
aété réactivée.Ainsi la veille est réalisée parlaCelluledeveille d’alerte
et de gestionsanitaire de l’Agencerégionale de santéocéan indien
quiréceptionne lessignalements de TIAC et participeaveclacellule
de l’Institut de veille sanitaire en région océanindienàleurs investigations.
Sur le plan clinique, la symptomatologie typiquementobservée
àLaRéunionregroupedes signesdigestifs(diarrhée), neurologiques
(paresthésie,dysesthésie,myalgie)puisgénéraux(asthénie résiduelle).
Le plus évocateur est l’inversiondelasensationchaud/froid.
La majeure partie desfoyers d’intoxicationest dueàdes poissons pêchés
sur lesbancs de pêcheSoudan, Saha de Maya,deRodriguesoudel’île
Maurice. Seul 10 %des cas sontdus àdes poissons pêchés sur lescôtes
réunionnaises.L’originedes poissons responsables resteindéterminée
dans plus de 30 %des foyers.Dans l’OcéanIndien, unetrentained’espèces
étaitreconnueàrisque(Quod et al. 1994). Entre1986et1999,les
famillespisciaires lesplussouvent incriminéessontles Serranidae (53%),
Lethrinidae (12%), Lutjanidae (8 %) et Carangidae (6 %).Les espèces les
plus souventmises en cause étaientleVariolalouti et le Lutjanus bohar.
Uneréglementation locale spécifique existe depuis1966etévolue
régulièrementenfonction de l’état desconnaissances,delasituation
épidémiologiquelocaleetrégionale.Une révisionmajeure aété entreprise
en 1999,afindeprendreencompte la situation épidémiologiqueà
Madagascaroùdenouvelles formes d’intoxications sévèresmettant en
cause destoxines d’origineméconnue ontété observées(clupéotoxisme,
intoxicationpar certaines sardines et carchatoxisme,par certains
requins) (Champetier et al. 1997). L’arrêtépréfectoral intègre ainsi les
espèces de sardines et de requinsles plus souvent mis en cause dans
cesfor-mes d’intoxications.Depuislarévisiondel’arrêtépréfectoral
de 1999,une surveillanceaux frontières est réalisée au traversdu
dispositif de contrôle au PIFsur lesespèces importéesdes pays tiers.
Annuellementune trentained’analysesdecontrôleest effectuéesur les
espèces lesplusàrisques en fonction desorigines.
CasdelaPolynésiefrançaise
La Polynésie est l’un desrares étatsduPacifiqueàdisposer d’un
programme de surveillanceépidémiologique, mis en placeaudébut
desannéessoixante(Bagnis et al. 1985).
Jusqu’en2006, cette base de donnéesétait alimentéed’une part via la
Directiondelasanté chargéederecueillirlenombredecas répertoriés
mensuellementpar 61 structures situées dans lescinqarchipels et
d’autrepart via l’Institut LouisMalardé (ILM), dans le cadred’un
programme de rechercheassociant àchaquepatient déclaré unefiche
clinique standardisée.Ces fiches fournissentdes indications sur l’île
de résidence,l’âge du patient, lessymptômesdéveloppés, le sitede
pêche, l’espèceetlapartieconsommée et le nombred’intoxications
antérieures.Depuis2007, la base de donnéesest géréepar l’ILM (8).
L’ensembledes données recueillies afaitl’objet de trois étudessur les
périodes1960-1984 (Bagnis et al. 1985), 1992-2001(Chateau-Degas et
al.2007)et2002-2008 (Chateau-Degas etal.2009). Leur analyseindique
quelaciguatera est unemaladie très fréquenteenPolynésie française.
Bien queladynamique observéedepuis1973soit en faveur d’une
stabilisationdutauxd’incidence(TI)annuelàl’échelledupays, l’analyse
fine desdonnées révèle quecetauxpeutvarierconsidérablementd’un
archipel àl’autre (par ex.en2009entre 2et1800cas pour 10 000 hab.
àTahitietRapa, respectivement).Enparticulier, on observeungradient
d’éloignementauniveaudes TI,les archipelsles plus éloignésmontrant
lesTIles plus élevées. Cesvariations s’expliquentprincipalementpar les
différences de régimes alimentairesobservées d’un archipel àl’autre,les
habitants de Tahitiétant sans contestemoinsdépendantsdelaressource
alimentaire quereprésentent lespoissons, et donc moinsexposés au
risque de ciguatera, queceuxdes archipelséloignés. Parailleurs, on
constate queleTIaugmenteavecl’âge et la saison chaude (Chateau-
Degat et al. 2007 ;2009).Une autredonnéemarquante concerne
l’augmentation préoccupante du nombred’intoxications auxAustrales
depuis2009, archipel pourtant considérécommelemoinsàrisquede
ciguaterajusqu’en1984 (Tableau1).En2010, unevingtained’archipels
affichaientunTIannuelsupérieur à100 cas pour 10 000 habitants,seuil
àpartir duquel la situation sanitaire est considérée comme préoccupante
selonl’OMS (Figure4).Enfin,l’incidenceest sans doute sous-estimée;
plus de la moitié despatientsrecensésdéclare avoir partagé le repas
(4)Lelaboratoirenationalderéférencepourlecontrôledes biotoxines marines-ANSES,Maisons-Alfort,etl’ARVAM,Réunion.
(5)http://daaf971.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CP121126_DAAF-ARS_appel-vigilance-CIGUATERA_consolide_cle8743ed.pdf.
(6)LePoste d’inspectionfrontalier(PIF) de l’aéroportdeRoissy fait partiedes dixplusimportantsPIF européens en termes de nombredelotscontrôlés (environ45%des
contrôlesdes lotsprésentésàl’importation en France).Les deux autres PIFmajeursenFrancesontcelui du HavreetdupôleMarseille-Fos/Mer.
(7)Conformémentàladirective97/78/CEfixantles principesrelatifsàl’organisationdes contrôlesvétérinairespourles produits en provenancedes pays tiersintroduits
dans la Communauté, ainsi qu’aurèglement (CE) n° 136/2004 de la Commissiondu22janvier 2004 fixant lesprocéduresdes contrôlesvétérinaires auxpostes
d’inspectionfrontaliers de la Communautélorsdel’importation desproduitsenprovenancedepaystiers.
(8) www.ilm.pf/Déclaration d’intoxicationpar biotoxines marines.
Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentationn
o56 5

Figure3. Annexe de l’arrêté préfectoral de la Guadeloupe(n° 2002/1249du19/08/2002)
6Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentationn
o56

toxiqueavecd’autresconvivesayant développédes symptômes
(Chateau-Degas et al. 2009), ce manqued’exhaustivité pouvantêtre
attribuableaupraticien ou au patient (Chateau-Degat et al. 2007).
Sur le plan clinique, la symptomatologie resterelativementstable
avec cependantl’absencedebradycardie et uneapparitionmarquée
de l’hypertensionces dernièresannées. Lessymptômesrelevéssont
surtout gastro-intestinaux(diarrhées),neurologiques (paresthésie,
inversiondelasensationchaud/froid),systémiques (douleurs
articulairesetdes membres)etles signescardiaques restentmodérés
(Chateau-Degat et al. 2007 ;2009).Enoutre,onnoteque le degréde
sévérité de l’intoxicationest accruchez lespatientsayant consommé
la tête et/oules viscères d’où l’importancedemaintenir voire
renforcerlemessage de santépubliquedéconseillant formellementla
consommationdeces partiesconnuespourêtredes réservoirspréfé-
rentielsdetoxines.
En Polynésie,plusdecentespèces de poissonssontpotentiellement
contaminéespar desCTXs(Bagnis et al. 1985). Entre2007et2011, les
famillesles plus souventincriminéesétaient les Scaridae (16%), Serranidae
(15%), Lutjanidae (8 %), Acanthuridae (7 %) et Carangidae (6 %).
En plus de permettre l’identification quasientempsréeldenouveaux
foyers d’émergenceetorienterainsi le choixdes îles où descampagnes
de prévention du risque sontnécessaires, le programme aura
égalementpermis la miseenévidenceaux Australesdenouvelles
formes d’intoxicationpar consommationdebénitiers et d’oursins,
vraisemblablementliées àlaprolifération de cyanobactéries marines
benthiquesdontl’activité cytotoxiquesur cellules neuro2Aest
de même natureque descomposés CTX-like (Pawlowiez et al. 2013).
Casdes archipelsdeMadère
et desCanaries
Si la ciguateraest connue depuisdenombreusesannéesdans l’Océan
Pacifique, l’OcéanIndienetles Caraïbes, on note uneextensiondes
zonesciguatérigènesces dernièresannées auxeauxAtlantiques
subtro-picales, peut être favoriséepar le réchauffementclimatique.
En effet, depuis2004, plusieurscas de ciguateraliésàlaconsommation
de poissons du genre Seriola pêchésdans leseauxdes archipels
de Madèreetdes Canariesont étérapportés, alorsqu’elles n’étaientpas
connuescommezones endémiquesjusqu’à présent (Figure5).
Figure5. Distribution mondialedelaciguatera
En gris,zonesderécifs corallienssituées entreles latitudes
35°N et 35°S;enbrun, zonesendémiques de la ciguatera;Îles
Canaries indiquéespar un pointrouge
Source:Perez-Arellano et al.2005. Ciguaterafishpoisoning,
Canary Islands.Emerg. Infect.Dis.11(12): 1981-2
En janvier2004, cinq personnesont étéintoxiquées après consommation
d’unesériole Seriolarivoliana capturée le long descôtes canariennes.
L’analysed’unéchantillon de poisson, partest Neuro-2a et LC-MS/MS,
apermis de confirmer la présence de C-CTX-1àune teneur estimée
à1,0 µg/kgetdedeuxanaloguesdestructures nonélucidées(Perez
Arellano etal.2005).Enjuillet 2008,onzepersonnes ontété intoxiquées
après consommationdesériolespêchées autour de l’îledeSelvagens
(Madère) et dontl’analyse LC-MS/MSarévélélaprésencedeP-CTX1
(Otero et al. 2010). En novembre2008, uneTIACimpliquant vingt-cinq
personnesaété rapportéeàTenerife,après consommationd’une sériole
achetéesur un marché local. Depuis 2009,une surveillanceaété mise
en placedans lesîlesCanariesaveclacréation du SVEICC.Cedernier
enregistrechaquecas de ciguaterasuspecté (poisson àrisqueassociéàla
présencedesymptômescliniques)etinclutles informations relativesaux
dateetlieudecapture, origine, poids, taille et lieu de venteoudistribution
du poisson consommé.Laprioritéest donnéeàlalocalisationdulot afin
de réaliser desanalysesainsi queleretrait du marché pour éviter de
nouveauxcas. Le SVEICC arapporté neuf foyers impliquant 68 personnes
entrenovembre2008etmai 2012.Pourtrois foyers, la présencedeCTX
aété confirmée(Nunez et al. 2012).
Casdeciguatera liéàla
consommation de poissons importés
Parailleurs, il ne fautpas exclureles casdeciguatera liés à
la consommationdepoissons péchés en zonesendémiques
et responsablesd’intoxicationhorsdeces régions,parce qu’ils yont
ététransportés par lesconsommateursouparce quel’importation
de poissons exotiquesaugmente le risque.
Dès2001, l’Institut national de veille sanitaire évoquait la possible
intoxicationciguatériquemême en l’absencedevoyage, suiteàla
survenued’une TIAC concernant deux jeunes adultesayant manifesté
dessymptômesévocateursaprès consommationdesushis dans un
restaurantàParis (Vaillant et al. 2001).
Parailleurs, en février 2011,deuxTIACont étérapportées en région
parisienne.Lepremier foyer impliquait quatre personnesdonttrois ont
Tableau1.Nombre de casd’intoxication répertoriés
en Polynésie, pararchipel et paran, et taux d’incidence
correspondant (ennombredecas pour 10 000 habitants)
Année 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de cas/an
Polynésiefrançaise 420572 615571 500
Archipel de la Société 63 137140 159206
Archipel desMarquises 57 108916475
Archipel desTuamotu 187208 164162 143
Archipel desGambier7269717941
Archipel desAustrales 41 50 149107 35
Année20072008200920102011
Population estimée
(Polynésie française) 259596*262737 265916 269 107272 283
Taux d’incidence annuel:nombredecas/10000 hab**
Polynésiefrançaise 16 22 23 21 18
Archipel de la Société 36679
Archipel desMarquises 66 124103 72 83
Archipel desTuamotu 121133 103101 88
Archipel desGambier539 510518 570 292
Archipel desAustrales 65 78 231164 53
*Source: Institut de la statistiquedePolynésie française (recensement2007)
** Source: Institut Louis Malardé-Directiondelasanté
Figure4. Principauxpoints-chauds de la ciguatera observés en
Polynésieen2010
Source:Institut LouisMalardé
Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentationn
o56 7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%