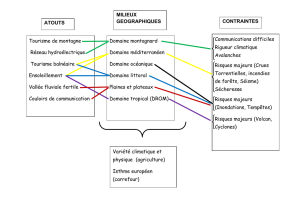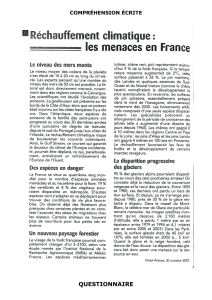Les acteurs non-gouvernementaux dans la diplomatie - GIP

Acteurs étatiques et non étatiques
dans la politique climatique
Une analyse comparée des acteurs et des expertises multiples dans les
processus décisionnels de la diplomatie climatique en France, en
Grande-Bretagne et en Allemagne
Les acteurs non-gouvernementaux
dans la diplomatie climatique
Marie Christine Kessler
Benoit Faraco
Raphaëlle Gauthier
Emmanuelle Mühlenhöver
RAPPORT FINAL
JANVIER 2008
Programme Gestion et Impact
du Changement Climatique
CONVENTION 0410C0031
ADEME / CNRS, CERSA

Acteurs étatiques et non étatiques
dans la politique climatique
Une analyse comparée des acteurs et des expertises multiples dans les
processus décisionnels de la diplomatie climatique en France, en
Grande-Bretagne et en Allemagne
Bibliographie
Marie Christine Kessler
Benoit Faraco
Raphaëlle Gauthier
Emmanuelle Mühlenhöver RAPPORT FINAL
JANVIER 2008
Programme Gestion et Impact
du Changement Climatique
CONVENTION 0410C0031
ADEME / CNRS, CERSA

Bibliographie
Acteurs étatiques et non étatiques dans la politique climatique 2
ARTICLES DE REVUES
Abbott, Kenneth W., Keohane, Robert O., Moravcsik, Andrew, Slaughter, Anne-Marie,
Snidal, Duncan, (2000), The concept of legalization, International Organization 54, 3,
Summer 2000, pp.401-419, MIT Press
Abbott, Kenneth W., Snidal, Duncan, (2000), Hard and Soft Law in International Governance,
International Organization 54, 3, Summer 2000, pp.421-456, MIT Press
Alfsen, Knut H., Skovdin, Tora, (1998), The Interngovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) and scientific consensus, CICERO Policy Note 1998:3, CICERO, Oslo,
Arts, Bas, (2002), Green Alliances' of Business and NGOs. New styles of self-regulation or
'dead-end roads'?, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 9,
n°1, March 2002, 26-36,
Arts, Bas, (2005), Non-State actors in global environmental governance: New arrrangements
beyond the state, Global Governance, Palgarve,
Arts, Bas, (2000), Regime, Non State Actors and the State System, European Journal of
International Relations, Vol. 6, n°4, 515-544,
Athanasiou, T. & Baer, P., (2001), Climate Change After Marrakech: Should
Environmentalists Still Support the Kyoto Protocol?, Foreign Policy in focus, Discussion
Paper 5, décembre 2001,
Auer, Mattew R., (1998), Colleagues or Combattants? Experts as Environmental Diplomats,
International Negociations, 1998 (3), 267-287, Kluwer Law International,
Bernauer, Thomas, (1995), The effect of environmental institutions: how we might learn
more, International Organization 49, 2, Spring 1995, pp. 351-377, IO Foundation of the
Massachussetts Institute of Technology
Birnbaum, P., (1973), Le pouvoir local : de la décision au système, Revue Française de
Sociologie, Vol.14, N°3, pp. 336-351, JSTOR
Buccholz, R. A., (1996), Private Management en Public Policy, Business and Society, vol. 35
n°4,
Butzengeiger, Sonja, Michaelowa, Axel, Bode, Sven, (2003), Europe - a Pioneer in
Greenhouse Gas Emissions trading, Intereconomics, July/August 2003,
Carpenter, Chad, (2001), Business, green groups and the media: the role of non-
governmental organizations in the climate change debate, International Affairs 77, 2 313-
328,
Carr Donald A., Thomas, William L., (1998), The Kyoto Protocol and US Climate Change
Policy: Implications for the American Industry, RECIEL, Vol. 7 issue 2, Blackwell Publishing,
FIELD, Oxford (UK),
Cass, Loren, (2005), Norm Entrapment and Preference Change: The Evolution of the
European Union Position on International Emissions Trading, Global Environmental Politics
5:2, May 2005, MIT Press, Massachussetts Institute of Technology
Christiansen, A.C., Wettestad, J., (2003), The European Union as a frontrunner on GHG
emission trading: how did it happen and will the European Union succeed?, Climate Policy 3
(2003) 3-18,
Conca, Ken, (1995), Greening the United Nations: environmental organisation and the UN
system, Third World Quarterly, Vol.16, n°3, 441-457,
Corell, Elisabeth, Betsill, Michele M., (2001), A Comparative Look at NGO Influence in
Internaitonal Environmental Negociations: Desertification and Climate Change, Global
Environmental Politics 1:4, November 2001, MIT Press,

Bibliographie
Acteurs étatiques et non étatiques dans la politique climatique 3
CRO Forum, (2006), Climate Change and Tropical Cyclones in the North Atlantic, Caribbean
and Gulf of Mexico, CRO Emerging Risk Initiative, Position Paper, Zurich,
Damro, Chad, Luaces Mendes, Pilar, (2003), Emissions Trading at Kyoto: From EU
Resistance to Union Innovation, Environmental Politics, Vol. 12, No. 2, Summer 2003, pp.
71-94, Londres, Frank Cass
De Perthuis, Christian, (2006), Protocole de Kyoto: Les enjeux post-2012, La revue
internationale et stratégique, n°60, 128-139, IRIS, Paris,
Dessai, S., (2001), The climate regime from the Hague to Marrakech: saving or sinking the
Kyoto Protocol?, Document de travail 12, Décembre 2001, Tyndall Center for climate change
research
Dessai, S., (2001), The climate regime from the Hague to Marrakech: saving or sinking the
Kyoto Protocol?,
Dolsak, Nives, (2001), Mitigating Global Climate Change: Why are some Countries More
Commited than Others? , Policy Studies Journal, Vol. 29, N°3, 2001 (414-436),
Duwe, Matthias, (2001), The Climate Action Network: A Glance behind the Curtains of a
Transnational NGO Network, RECIEL, Vol. 10 issue 2 Blackwell Publishing, FIELD,
Ecofys , (2003), Evolution of commitment under the UNFCCC: involving newly industrialized
economies and developping countries, Climate Change 01/03,
Eden, Sally, (2004), Greenpeace, New Political Economy, Vol. 9, n°4, December 2004,
Carfacs Publishing,
Entreprises Pour l'Environnement, (1999), Changement Climatique, Propositions des
"Entreprises pour l'Environnement" pour un dispositif efficace de réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans le secteur productif, Entreprise Pour l'Environnement,
Faraco, B., (2006), Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique,
Ecologie et Politique, 33/2006, Paris, Editions Syllepses
Faraco, Benoit, (2004), L’impact des ONG environnementales sur la prise de décision : une
analyse des rapports entre ONG et Etat dans la construction des politiques climatiques
française , Mémoire pour l'obtention du DEA de science Politique, IEP de Grenoble, France,
Grenoble,
Finnemore, Martha & Sikkink, Kathryn, (1998), International Norm Dynamics and Political
Change, International Organization 52, 4, Autumn 1998, pp. 887-917, IO Foundation of the
Massachussetts Institute of Technology
Giorgetti, Chiara, (1999), From Rio to Kyoto: A study of the involvement on non-
governmental organizations in the negociations on climate change, New York University
Environmental Law Journal, Vol. 7, New York,
Godard, O., (2002), Le développement durable et les entreprises, Revue des Deux Mondes,
oct-nov 2002, Revue des Deux Mondes
Godard, Olivier, (2000), "Droits à polluer" : où est le virage ? , Le Monde, 27 janvier 2000,
page 13, Paris, SA Le Monde
Godard, Olivier, (1997), Les enjeux des négociations sur le climat. De Rio à Kyoto : pourquoi
la Convention sur le climat devrait s'intéresser à ceux qui ne s'y intéressent pas, Futuribles,
n° 224,
Godard, Olivier & Hourcade, J.-C., (1997), La négociation de Kyoto sur l'effet de serre :
lecture économique et propositions stratégiques, Papier préparé pour le Conseil d'Analyse
Economique, Groupe de Travail : Fiscalité de l'environnement,
Godard, Olivier, Hommel, Thierry, (2006), Les multinationales, un enjeu stratégique pour
l'environnement et le développement durable, La revue internationale et stratégique, n° 60,
101-111, IRIS, Paris,

Bibliographie
Acteurs étatiques et non étatiques dans la politique climatique 4
Goldstein, Judith, Kahler, Miles, Keohane, Robert O., Slaughter, Anne-Marie, (2000),
Introduction: Legalization and World Politics, International Organization 54, 3, Summer 2000,
pp.385-399, MIT Press
Gough, Claire, Shackley, Simon, (2001), The respectable politics of climate change: the
epistemic communities and NGOS, International Affairs 77, 2 329-345,
Grubb, Michael (dir), (2003), A strategic assesment of the Kyoto-Marrakech System, Briefing
Paper, The Royal Institute of International Affairs, Londres,
Guzzini, Stefano, (2000), A Reconstruction of Constructivism in International Relations,
European Journal of International Relations, Vol. 6, n°2, 147-182, European Consortium for
Political Research, SAGE Publications
Haas, P., (1989), Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution
Control, International Organization, vol.43 n°3, Cambridge, Cambridge University Press
Haas, P., (1992), Introduction: Epistemic communities and international policy coordination,
International Organization, 46:1, Cambridge University Press
Hallstrom, Lars K., (2004), Eurocratising Enlargement? EU Elites and NGO Participation in
European Environmental Policy, Environmental Politics, Vol.. 13, No. 1, Spring 2004, pp.
175-193,
Hecht, Alan D. & Tirpak, Dennis, (1995), Framework agreement on climate change: a
scientific and policy history, Climate Change 29: 371-402, Kluwer Akademic Publishers
Hourcade, J. C. & Fortin, E., (2000), Impact économique des politiques climatiques : des
controverses aux enjeux de coordination, Economie Internationale N°82, Paris, La
Documentation Française
Hourcade, J. C. & Ghersi, F., (2002), The economics of a lost deal: Kyoto - The Hague -
Marrakesh, The Energy Journal, vol. 23 n°3, OSTI
Hourcade, J.-C. , (2002), Dans le labyrinthe de verre. La négociation sur l'effet de serre,
Critique Internationale n°15, Paris, Presses de Sciences Po
Hourcade, J.-C. & Guersi, F., (1997), Les enjeux des "Qelros" : entre logique économique et
logique de négociation, Revue de l'énergie, n° 491,
Hugon, Philippe, (2006), Environnement et développement économique: les enjeux posés
par le développement durable, La revue internationale et stratégique, n°60, 112-127, IRIS,
Paris,
Jagers, Sverker C., Stripple, Johannes, (2003), Climate Governance Beyond the State,
Global Governance 9 (2003), 385-399 ,
Josselin, Daphné & Wallace, William, (2001), Non-State Actors in World Politics,
Kahler, Miles, (2000), Conclusion: The Causes and Consequences of Legalization,
International Organization 54, 3, Summer 2000, pp.661-683, MIT Press
Keohane, Robert O., Moravcsik, Andrew, Slaughter, Anne-Marie , (2000), Legalized Dispute
Resolution: Interstate and Transnational, International Organization 54, 3, Summer 2000,
pp.457-488, MIT Press
Kiss, Alexandra, (2006), Du régional à l'universel: la généralisation des préoccupations
environnementales, La revue internationale et stratégique, n° 60, 85-91, IRIS, Paris,
Koh, Harold Hongju, Why do Nations obey International Laws?, The Yale Law Journal, Vol.
106, 2599-2659, Yale,
Kolk, Ans, Levy, David, (2001), Winds of Change: Corporate Strategy, Climate Change and
Oil Multinationals, European Management Journal Vol.19, No. 5, pp. 501-509, October 2001,
Elsevier Science Ltd
Le Treut, H., (2006), Le diagnostic scientifique : de l'alerte à l'éclairage des choix, Ecologie et
Politique, 33/2006, Paris, Editions Syllepses
Leggett, J. , (1993), Climate Change and the Insurance Industry, European Environment 3,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
1
/
338
100%