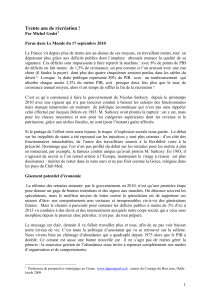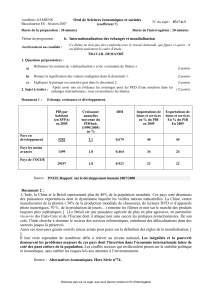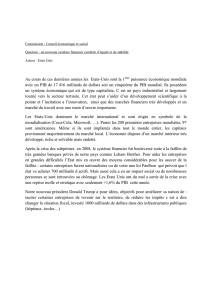LES DÉTERMINANTS À LONG TERME DES COMPTES

LES DÉTERMINANTS À LONG TERME DES COMPTES EXTERNES BRÉSILIENS
103
* Directeur de recherche, Bradesco.
** Économiste, Bradesco.
LES DÉTERMINANTS À LONG TERME
DES COMPTES EXTERNES BRÉSILIENS
OCTAVIO DE BARROS *
FERNANDO HONORATO BARBOSA **
Les transactions courantes d’un pays représentent les flux de biens
et de services qui sont négociés avec le reste du monde. Bien
que le Brésil soit une économie relativement fermée, sa dyna-
mique économique tout le long des années a toujours été liée à
des restrictions de la balance des paiements qui mesure, outre le
compte courant, les flux financiers exprimant le financement externe
disponible.
Jusqu’à la modification du régime cambiaire en 1999, les crises
externes généraient systématiquement des restrictions de financement
à l’économie brésilienne, ce qui se reflétait dans l’économie réelle. Ceci
se produisait, entre autres raisons, parce que le régime cambiaire était
basé sur le taux de change contrôlé et que le passif externe était élevé, ce
qui faisait en sorte que la dynamique des indicateurs externes ait
toujours été défavorable. Cette situation a commencé à changer en 1999
et s’est intensifiée en 2002 avec la forte dépréciation du taux de change
(incertitude politique à l’époque) et, à partir de ce moment-là, l’effet
décalé du taux de change et la reprise de la croissance mondiale, avec les
prix des commodities en hausse, ont contribué à la réduction substantielle
de la vulnérabilité externe brésilienne. Malgré l’intense cycle de consom-
mation et les investissements domestiques à partir de 2004, les comptes
BARROS 2/11/09, 14:52103

REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
104
externes ne sont redevenus déficitaires qu’en 2008, ce à quoi l’on peut
s’attendre d’un pays qui a un taux d’épargne bas, comme le Brésil, et
qui croissait substantiellement au-dessus de son potentiel. Ce déficit
des transactions courantes augmente le bien-être des ménages, permet
un cycle d’investissements plus intense et, en outre, amenuise le
processus inflationniste que l’on aurait s’il n’y avait pas un tel déficit.
Nombreux sont ceux qui attribuent au processus d’appréciation
du taux de change, qui est en cours depuis 2003, le fait que le Brésil
ait de nouveau présenté des déficits externes. Bien que le taux de
change puisse temporairement définir la taille du compte courant,
particulièrement dans des régimes administrés, le change réel est
endogène et reflète la plus ou moins grande insuffisance de financement
externe pour un déficit des transactions courantes donné. Celui-ci est
déterminé, à son tour, par l’excès de demande portant sur l’offre
domestique. De ce fait, l’existence de déficits des transactions courantes
est une chose usuelle dans les pays pauvres ou de revenu moyen, avec un
faible stock de capital et une épargne faible. La condition préalable pour
l’existence d’un déficit externe est la présence de financements et, par
conséquent, aussi longtemps qu’il y aura des entrées de capitaux dans un
pays, les déficits élevés pourront être financés pendant longtemps si la
politique macroéconomique est consistante. Quand le déficit sera perçu
comme étant insoutenable, le taux de change s’ajustera, ce qui pourra
entraîner des conséquences indésirables pour l’économie.
Reconnaissant alors que le déficit externe est un phénomène
endogène qui dépend de la disposition de financement du monde et de
l’excès de demande portant sur l’épargne d’un pays, que les politiques
cambiaires sont inefficaces pour modifier la trajectoire des comptes
externes à long terme, quelle est la logique de consacrer un article à
des recommandations pour l’avenir du Brésil en ce qui concerne ses
comptes externes ? La logique réside dans la compréhension des facteurs
déterminants de déficits récurrents dans des pays comme le Brésil, dans
l’identification de niveaux de risque pour le déficit externe et dans la
recommandation de politiques économiques qui évitent l’entrée du
pays dans une trajectoire de déficits insoutenables.
C’est cet ensemble de questions que cet article tente de traiter.
L’idée proposée est de penser la trajectoire future des comptes externes
brésiliens dans le contexte de la nécessité d’élargir le taux d’inves-
tissement domestique, de la découverte brésilienne des réserves du
pré-sal (gisements maritimes de pétrole dans les eaux profondes sous
une épaisse couche de sel) et des alternatives de politique économique
qui sont mises en œuvre pour éviter des déficits qui peuvent augmenter
à la longue. Outre cette introduction, la deuxième partie de cet article
traitera des déterminants macroéconomiques des transactions courantes
BARROS 2/11/09, 14:52104

LES DÉTERMINANTS À LONG TERME DES COMPTES EXTERNES BRÉSILIENS
105
brésiliennes, alors que la troisième partie établira quelques comparaisons
internationales relatives à la dimension « soutenable » du déficit des
transactions courantes dans un pays. La quatrième partie simulera
quelques scénarios pour les transactions courantes dans les prochaines
années, étant donné les expectatives de la hausse continue du PIB, des
investissements et, par conséquent, de l’augmentation du PIB potentiel
et de la découverte des réserves de pétrole du pré-sal. Finalement, la
cinquième partie exposera de brèves conclusions.
LES DÉTERMINANTS MACROÉCONOMIQUES
DES COMPTES EXTERNES BRÉSILIENS
Un pays ne peut investir que s’il a de l’épargne. Si le pays investit plus
que sa capacité d’épargne domestique, il devra être temporairement
financé par l’étranger, encourant un déficit. Une augmentation de la
consommation des ménages, ou des dépenses du gouvernement, qui se
situe au-dessus de la croissance du PIB, réduit l’épargne domestique
comme proportion du revenu national, élevant, de ce fait, le déficit
externe, étant donné le niveau des investissements par rapport au PIB.
Une augmentation des investissements comme proportion du PIB exige
une source de financement qui peut provenir de dépenses inférieures des
ménages ou du gouvernement par rapport à l’accroissement du PIB, ce
qui augmente l’épargne domestique, ou provenir de l’étranger, on se
sert alors de l’épargne accumulée dans d’autres pays.
Le Brésil est un pays qui a une faible épargne domestique (environ
17 % du PIB, d’après des données de 2008) et, par conséquent, à
chaque fois que la demande domestique augmente beaucoup plus que le
PIB, le pays en vient à présenter un déficit des transactions courantes et
le taux de change réel finit par s’apprécier pour accommoder cet excès
de demande. Ce processus est mis en œuvre, à condition qu’il y ait
une disponibilité de financement externe, moyennant la modification
des prix relatifs entre les biens transactionnables et non transactionnables
à l’étranger qui sont plus chers par rapport aux premiers. La réduction
relative des prix des biens transactionnables à l’étranger rend les
importations moins chères et renchérit les exportations, menant au
déficit externe.
Ce qui gère la croissance à long terme dans n’importe quel pays,
c’est l’augmentation des investissements et non pas celle de la consom-
mation. Si toute l’épargne externe (déficit des transactions courantes)
devient consommation de biens et de services, le pays n’augmentera
pas sa capacité de croissance à long terme. De l’autre côté, si le déficit
externe devient augmentation des investissements, l’économie
augmente sa capacité potentielle de croissance, offrant à l’avenir plus
BARROS 2/11/09, 14:52105

REVUE D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE
106
de biens et de services et diminuant sa nécessité d’importations liquides
par la suite.
Dans le graphique 1 qui illustre toutes ces questions à partir de
l’économie brésilienne, on note que, malgré la fluctuation cambiaire de
1999, le Brésil a seulement commencé à présenter un excédent des
exportations liquides à partir du quatrième trimestre 2002.
Graphique 1
Absorption domestique et absorption externe
(en % du PIB)
Source : IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Institut brésilien de géographie et de
statistique).
Après toute cette discussion, le lecteur ne devrait plus être surpris
que pendant la période de majeure absorption domestique (troisième
trimestre 1997, cf. tableau 1 ci-après), l’absorption externe a été la
plus négative de toute cette période, se situant à 2, 3 % du PIB. Le
graphique 1 montre bien clairement que le grand changement survenu
dans les comptes externes - le passage de déficits élevés à des excédents -
ne s’est produit qu’à partir de 2002, après la forte dépréciation cambiaire
de cette année-là qui résulte, entre autres raisons, de l’accumulation de
déficits excessifs par le passé. La dépréciation cambiaire de 1999 avait
aussi été substantiellement forte, mais elle a eu lieu à un moment de
basse croissance mondiale, de chute des prix des commodities et des prix
des exportations brésiliennes, mais de flux de financement externe
encore élevés, de rentrées d’investissements élevées pour la privatisation,
et, par conséquent, l’ajustement de la demande n’a pas été aussi intense
qu’en 2002.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
T4-2008
T2-2008
T4-2007
T2-2007
T4-2006
T2-2006
T4-2005
T2-2005
T4-2004
T2-2004
T4-2003
T2-2003
T4-2002
T2-2002
T4-2001
T2-2001
T4-2000
T2-2000
T4-1999
T2-1999
T4-1998
T2-1998
T4-1997
T2-1997
T4-1996
T2-1996
T4-1995
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Absorption domestique
(échelle de gauche)
Absorption externe
(exportations liquides)
(échelle de droite)
102,3 102 3,9
99
0,2
96,1
- 2
- 2,3
BARROS 2/11/09, 14:52106

LES DÉTERMINANTS À LONG TERME DES COMPTES EXTERNES BRÉSILIENS
107
Tableau 1
Composantes du PIB brésilien
(en % du PIB)
Trimestres Consommation Investis- Consommation Absorption Exportations
sélectionnés des ménages sements du domestique liquides
et années gouvernement
T3-1997 65,2 16,9 20,2 102,3 -2,3
T2-2001 64,5 18,5 19,2 102,2 -2,2
T4-2004 59,8 17,1 19,2 96,1 -3,9
T4-2008 60,7 18,9 20,2 99,8 -0,2
Source : IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Institut brésilien de géographie et de
statistique).
Ce fut seulement avec la crise cambiaire de 2002, qui a littéralement
tari toutes les sources de financement externe au Brésil en vertu de la
crainte d’un default brésilien et aussi d’un scénario externe présentant
une croissance et des flux bas, que l’ajustement externe s’est opéré,
faisant en sorte que le pays passe d’importateur d’épargne externe à
exportateur, réduisant l’absorption domestique comme proportion
du PIB de 5,9 % entre le début de l’année 2001 et la fin de l’année 2004.
Nous voulons démontrer qu’en dépit des variations du taux de
change, de la dynamique des prix internationaux des commodities
et de la croissance mondiale, la relation entre absorption domestique
et externe est dictée par la disponibilité du financement externe, ce qui
déterminera combien nous pouvons consommer et investir au-dessus
de notre capacité de production domestique de biens et de services.
Finalement, il convient de discuter la composition de la demande
domestique. Le tableau 1 nous montre quelques points concernant la
dynamique macroéconomique du Brésil. En premier lieu, les deux
épisodes de forte dépréciation cambiaire (1999 et 2002) ont eu lieu
quand l’absorption domestique, en particulier la consommation des
ménages, était proche du maximum historique et, en raison de cela, le
déficit externe atteignait aussi des niveaux records. L’excès d’absorption
domestique est la cause des déséquilibres externes qui peuvent entraîner
des ajustements cambiaires. Ces crises se produiront au cas où la
dynamique du passif externe liquide serait perçue comme insoutenable
ou qu’il y ait un arrêt subit de capitaux pour le pays, faisant en sorte
que les investisseurs ne soient pas disposés à financer le déficit observé
ou qu’il n’y ait pas de ressources disponibles étant donné le taux de
change et le risque pays en vigueur1.
Le deuxième point que révèle le tableau 1 est que le grand ajustement
des comptes externes brésiliens entre 1997 et 2004 s’est fait dans la
BARROS 2/11/09, 14:52107
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%