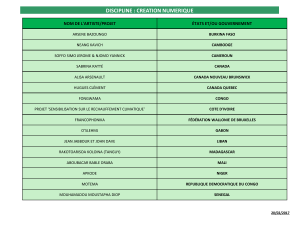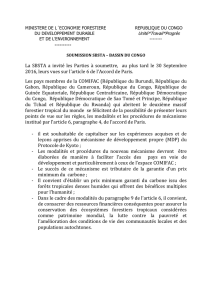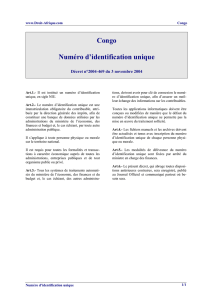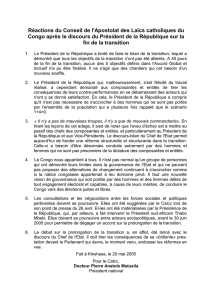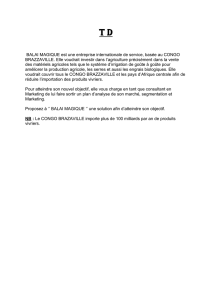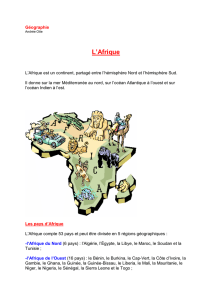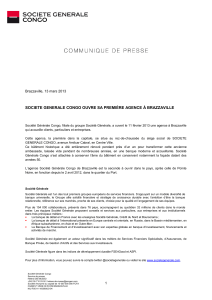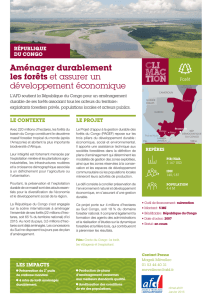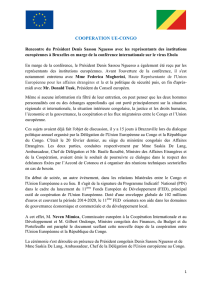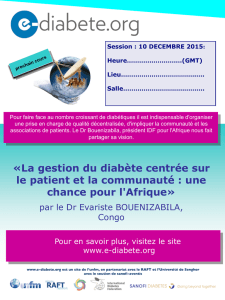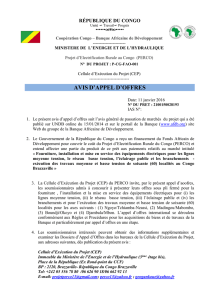mission - Le Grand T

1
Licences spectacles 1-142915 2-142916 3-142917
2013/14
photo © koen Broos
MISSION
TexTe DaviD van ReybRouck
Mise en scène Raven Ruëll
en co-réalisaTion avec angers nanTes opéra
27 - 29 JAN - ThéâTre GrAsliN
02 51 88 25 25 / leGrandT.fr

2
MISSION
THÉÂTRE GRASLIN
JAN LU 27 20:30
MA 28 20:00
ME 29 20:00
CONTACTS PÔLE PUBLIC ET MÉDIATION
Manon Albert
albert@leGrandT.fr
02 28 24 28 08
Florence Danveau
f.danveau@leGrandT.fr
02 28 24 28 16
LE GRAND T
84, rue du Général Buat
B P 30111
44001 NANTES Cedex 1
DURÉE : 1h50 sans entracte
PUBLIC : à partir de 14 ans
SOMMAIRE
Présentation 3
Note d’intention 4
Entretien avec David Van Reybrouck 5
Raven Ruëll, metteur en scène 8
David Van Reybrouck, auteur 9
Mission
, extraits 10
La presse en parle... 12
© 26000 COUVERTS

3
PRÉSENTATION
Mission
Texte David Van Reybrouck
Mise en scène Raven Ruëll
Scénographie Leo de Nijs
Lumière Johan Vonk
Création son Donald Berlanger
Dramaturgie Ivo Kuyl
Vidéo Bart Visser
Assistante à la mise en scène Monique Wilsens
Réalisation décor KVS-atelier
Avec Bruno Vanden Broecke
Production Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)
Mission est publié aux éditions Actes-Sud Papiers

4
« Si le théâtre, c’est avant tout un texte, un acteur et
un public, alors Mission est du grand théâtre. Il n’y a ni
décor, ni suspense, ni scènes de groupe, ni nouvelles
technologies dans ce spectacle […]. Pendant deux
heures, il n’y a qu’un acteur (mais quel acteur : Bruno
Vanden Broecke, impressionnant de vérité), racontant
à une tribune d’orateur de paroisse devant le rideau
noir fermé sa vie de missionnaire. Rien d’autre qu’une
conférence, mais quelle conférence ! On reste
« scotché » à ce récit, écrit par David Van Reybrouck. »
La Libre Belgique, 2007
Ce monologue théâtral est constitué essentiellement
de témoignages recueillis récemment au Congo et en
Belgique par David Van Reybrouck. En s’appropriant
ces paroles multiples, le personnage principal restitue
l’histoire de ces oubliés, ces héros dont personne
ne parle. Il raconte comment au Congo, dans la
brousse, le métier de missionnaire est exaltant mais
aussi complexe et dérisoire face à l’immense tâche.
Il parle aussi de sa vocation, de ses doutes sur la
foi, des souffrances des Africains et de l’arrogance
des occidentaux. De la guerre aussi et de son
cortège d’horreurs quand les humanitaires ont fui.
Et puis, quand le récit aborde le retour au pays -
qu’il avait quitté pauvre et catholique et retrouve
riche et matérialiste - le ton de la confidence laisse
place au coup de gueule ou à l’ironie, pour mieux
ridiculiser « nos gadgets inutiles ».
Pour David Van Reybrouck, il s’agit du troisième
monologue sur les blancs âgés en Afrique. Après le
scientifique dans Die Siel van die Mier (L’Âme des
termites, présenté au Maillon en décembre 2006) et
l’encyclopédiste dans N, c’est maintenant le tour du
missionnaire, un rôle interprété par Bruno Vanden
Broecke totalement habité par le personnage.
NOTE D’INTENTION
EN IMAGES
Entretien de Bruno Vanden Broecke par Genevieve Chapdeville Philbert : http://www.dailymotion.com/
video/xjln8l_bruno-vanden-broecke-itv-genevieve-chapdeville-philbert_creation

5
Décidément, l’auteur David Van Reybrouck est attiré
par l’Afrique. Il a créé avec Josse de Pauw
Die Siel van
die Mier
(
L’Âme des termites
), un monologue dont la
majeure partie se déroule en Afrique. Récemment, il
s’est impliqué de diverses manières dans le Trajet-Con-
go du KVS. Le journal
De Morgen
a publié les repor-
tages de ses voyages au Congo, dans le cadre du KVS
ou non. David va rédiger un livre sur l’histoire du Congo
et se prépare à écrire
Missie
, une pièce de théâtre sur
les missionnaires. Notre entretien a lieu à son retour
d’un périple bouleversant de six semaines en Afrique,
pendant lequel il a interviewé des missionnaires pour
collecter du matériel.
Les missionnaires. Un sujet chargé. Quand les gens
entendent ce mot, ils pensent souvent à « gagner des
âmes ». Ils voient dans les missions passées et pré-
sentes un avant-poste de l’impérialisme occidental,
aujourd’hui encore, à l’heure où la plupart des pays
européens ont perdu leurs anciennes colonies.
« Depuis les quinze dernières années, nous avons
pris l’habitude de remettre en question toutes sortes
d’implication et d’engagement - d’amour du prochain
dans le cas des missionnaires - et de supposer qu’il y a
toujours un autre plan, un agenda caché. C’est une es-
pèce de méfiance systématique à l’égard des convic-
tions, certainement de nobles convictions. L’amour du
prochain devient alors un prétexte pour imposer des
valeurs occidentales, catholiques ou pour coloniser les
esprits et les corps ou même compenser en quelque
sorte une vie sexuelle frustrée. Avec comme grand dé-
savantage qu’on jette le bébé avec l’eau du bain. Bien
sûr, il est crucial de rester critique, mais nous devons
aussi nous garder d’ériger cette critique en finalité. La
plupart des missionnaires avec lesquels j’ai parlé ont
complètement intégré cette critique postcoloniale. Ce
serait donc parfaitement erroné de juger l’œuvre des
missionnaires en l’an 2007 sur la base d’une docu-
mentation qui concerne le mode des missions entre
1900 et 1950.
Et c’est exactement ce qui se passe constamment,
donc la plupart des critiques sont anachroniques.
Et faciles. J’ai écouté ces gens et j’ai été impressionné
par leur quête et aussi par leur sérénité, malgré le fait
qu’ils sont confrontés, dans une très large mesure, à la
souffrance et au chagrin. Les missionnaires avec qui j’ai
parlé ont une humilité et une patience à laquelle nous
pouvons à peine prétendre avec notre mode de pen-
sée axé sur le résultat. Certains missionnaires disaient :
nous n’y sommes pas encore, mais peut-être y serons-
nous dans cinq cents ans. Avoir une foi qui permet de
concevoir un délai de cinq cents ans doit procurer un
calme énorme en cas de revers. Quand les dix-quinze
dernières années de votre vie semblent sans valeur, il
n’y a pas vraiment de raison de désespérer.
Dans quels lieux as-tu été et quelles personnes as-tu
rencontrées ?
J’ai parlé avec une quinzaine de personnes de divers
ordres catholiques : des Jésuites, des Pères Blancs,
des Pères de Scheut, des Oblats, des Capucins, des
Franciscains, des Salésiens, etc. Partout au Congo : à
Kinshasa, Kikwit, Bukavu, Goma, Kalima, Kamina, Lu-
bumbashi et Likasi. Mais les entretiens cruciaux pour
moi se sont passés dans l’Est - ce n’est pas un hasard -
à Bukavu et à Goma, le territoire entre le Nord-Kivu
et le Sud-Kivu, qui a souffert le plus pendant la toute
dernière guerre et qui baigne toujours dans une atmos-
phère de guerre. Pour moi, ce contexte était crucial : je
ne voulais pas obtenir le monologue d’un missionnaire
qui vit ici dans une maison de repos, mais de quelqu’un
sur place qui a vécu la guerre et se débat avec la
souffrance de cette guerre. Toutefois, ce n’est ni cette
guerre ni le contexte historique du Congo pendant les
15 dernières années qui m’intéressent avant tout. Mais
cela m’aide pour mener ma réflexion sur l’engagement
du missionnaire. Comment peut-on encore réfléchir
sur son Dieu quand on a vu quelqu’un passer avec un
seau rempli d’yeux d’êtres humains ; comment peut-on
encore croire en la bonté de l’être humain, quand on a
été soi-même plusieurs fois plaqué au sol de son poste
de mission et qu’on a crié: « Mais tirez donc ! »
« Engagement » est donc un mot-clé pour toi.
Avec cette pièce, je veux sonder les conditions qui per-
mettent l’engagement aujourd’hui. Pas seulement reli-
gieux, mais aussi artistique. Et pour moi, le missionnaire
est une sorte d’aune : quelqu’un qui a choisi de vivre
selon ses convictions et qui est parfois prêt à assumer
ENTRETIEN AVEC DAVID VAN REYBROUCK
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%