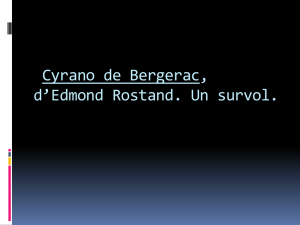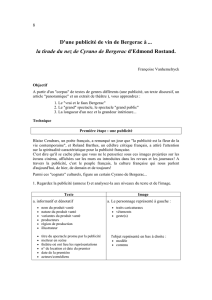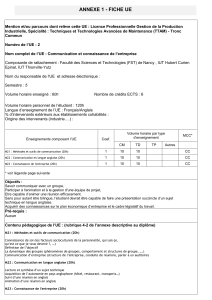gary sous la plume et la voix de joann sfar le blues est partout où

OD ON
LES BIBLIOTHÈQUES DE L'ODÉON
GARY SOUS LA PLUME ET
LA VOIX DE JOANN SFAR
Dialogue d’«Exils»
LUCKY PETERSON / PHILIPPE PETRUCCIANI / AHMAD JAMAL
LE BLUES EST PARTOUT
OÙ JOUE UN BLUESMAN
Deux concerts exceptionnels
Lettre No10
Odéon-Théâtre de l’Europe mai 2014
CYRANO DE BERGERAC / DOMINIQUE PITOISET
«CYRANO ME TOUCHE
ENCORE PLUS QU'ALCESTE»
Entretien avec Philippe Torreton

2 3
UN MIROIR
IMPLACABLE
CYRANO DE BERGERAC SELON
PHILIPPE TORRETON
© Brigitte Enguérand
sur... comment dire... un curseur «psy-
chiatrique», mais cela veut tout dire et ne
rien dire. Je savais qu'on serait plongés
dans une ambiance moderne, que les
personnages seraient vraiment analy-
sés du point de vue clinique. J'ai décou-
vert le décor et la réalité des costumes
lors des répétitions, en même temps
que les autres interprètes, alors que
pendant des semaines j'avais demandé
à Dominique: «Fais-moi voir des trucs,
quelque chose...» Et j'ai compris pour-
quoi il avait refusé de me montrer quoi
que ce soit!... Ce en quoi il avait tort,
car j'étais vraiment prêt à travailler avec
lui quel que soit l'angle d'attaque de la
pièce. Et donc, après cette phase, moi,
j'ai été absolument – ah, je ne sais pas
comment dire ça. Cet objet drama-
turgique, je l'ai tout de suite absorbé,
assimilé sur le plan émotionnel. J'ai été
bouleversé d'imaginer ces gens, ce petit
aréopage d'êtres humains, qui noient
leur détresse et arrivent à faire pas-
ser le temps en réveillant parmi eux ce
monstre de premier degré, ce porteur
de moustache qui prétend s'appeler
Cyrano. Ce point de départ déclenche
des tas de micro-histoires dans l'his-
toire. Pendant les répétitions, on est
passé par des moments absolument
dingues. Aussi bien des passages à
vide, où on ne savait plus où on en était
vraiment, que des moments d'une émo-
tion, d'une beauté, avec des proposi-
tions d'acteurs folles... On ne pouvait
pas tout mettre. Le spectacle qu'on voit
là n'est qu'un résumé incroyablement
bref de tout ce par quoi on est passés
en répétitions, et qui continue à nous
nourrir. Il y aurait de quoi faire plusieurs
mises en scène avec tout le matériau
qu'on a inventé et que Dominique a sus-
cité. Ca m'a touché au plus haut point.
Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait
un paradoxe entre l'immense popularité
de cette pièce, donc du personnage, et
la réalité des sociétés dans lesquelles
nous vivons.
D. L. – Quel paradoxe?
P. T. – Avec Cyrano, nous applaudissons
un héros intransigeant, autonome, refu-
sant le compromis, qui va au bout de ses
fidélités amicales, esthétiques, amou-
reuses, alors que nous vivons quand
même dans un monde assez veule,
assez lâche. Ça ne date pas d'hier, d'ail-
leurs... La promiscuité humaine entraîne
forcément des comportements de cour,
de salon, et limite nos ambitions de
pureté. Le voilà, le paradoxe: le public
réserve tous les soirs un triomphe à ce
gars-là, mais en quittant le théâtre cha-
cun se replonge dans un monde de pré-
jugés, de compromis, de lâchetés, de
sottises.
D. L. – Vous semblez rapprocher Cyrano
du Misanthrope, comme le fait Pitoiset...
P. T. – Mais oui, bien sûr! Sauf que sur
un point, Cyrano me touche encore plus
qu'Alceste. Cyrano se tient en-dehors
de la cour. Alceste dénonce la cour alors
qu'il est en plein dedans. On a envie de
lui crier: «Mais casse-toi, arrache-toi
de là, va-t'en dans ton désert!»Cyrano,
lui, est déjà parti, déjà ailleurs, dans une
autre vie très loin des boudoirs et des
salons, une vie où d'une certaine façon
Alceste continue à se complaire. C'est
d'ailleurs un personnage que j'aimerais
jouer, justement pour cette contradic-
tion qu'il porte. Pour son côté crache-
dans-la-soupe alors qu'il y patauge,
dans cette soupe... Cyrano, pas du tout.
C'est quand même une des très rares
pièces, je trouve, où le personnage tire
sa révérence en disant son fait au public
qui le regarde! Je ne peux pas m'empê-
cher de penser que quand il dit «Qu'est-
ce que c'est que tous ceux-là! Vous êtes
mille?», il parle des sept cents ou mille
personnes, de la masse des specta-
teurs qui sont en train d'assister à sa
mort. C'est à ce genre de détails que
je sens que cette pièce est vraiment
géniale, contrairement à ce que croient
encore certains qui la considèrent au
mieux comme une bluette historique
en vers de mirliton pas trop mal écrits.
Je trouve que c'est une grande pièce et
bien plus encore – oui, elle est vraiment
Daniel Loayza – Vous revenez à Cyrano
après six mois d'interruption. Comment
se passe cette reprise?
Philippe Torreton – L'accueil est extraor-
dinaire, comme à la création. Et comme
on défend quand même des options de
mise en scène très fortes, c'est toujours
une joie énorme de voir à quel point ça
marche, et combien les spectateurs
sont enthousiastes devant cette pièce
qu'ils disent avoir l'impression de redé-
couvrir. En fait, ce spectacle, c'est un
peu chaque soir la rencontre de deux
belles surprises : celle du public, qui
entre dans un Cyrano très inattendu, et
puis la nôtre, celle de la troupe, devant
l'accueil qu'on nous fait. À chaque fois,
les gens accompagnent la représenta-
tion, acceptent de jouer le jeu de cette
dramaturgie et se laissent totalement
embarquer. Ce qu'ils voient n'est pas ce
qu'ils attendaient, c'est complètement
autre chose et ça les transporte. Je suis
content que Dominique Pitoiset ait eu
cette audace-là, et qu'on ait tous pris
ce pari avec lui, en fonçant tête baissée.
D. L. – C'est un Cyrano assez inédit... De
l'intérieur, quel effet vous fait-il ?
P. T. – Oh là là ! C'est beaucoup de
choses en même temps. J'ai commencé
avec très peu d'éléments sur la philo-
sophie du spectacle que recherchait
Dominique. Je savais qu'il se réglait
géniale. Beaucoup plus profonde, grave,
tragique qu'on ne croit. Ce héros-là, ce
n'est pas seulement une «force qui va»,
comme disait Hugo, mais une force qui
s'en va, qui meurt, en n'étant pas dupe
de ces gens qui vont l'applaudir dans
deux secondes quand il aura dit son der-
nier mot, le mot «panache».
D. L. – Vous le voyez comme une sorte
de bouc émissaire?
P. T. – Oui, ou d'alibi. Nous autres, nous
pouvons continuer à vivre ici-bas dans
notre monde, puisqu'on a été capable
d'y écrire Cyrano. Il rachète quelque
chose de notre médiocrité, donc ce n'est
pas mal... On a Cyrano, ça va! Souvent
ces personnages-là nous permettent de
nous défausser un peu... Normalement,
c'est un type d'homme qui devrait nous
déranger. Son intransigeance devrait
nous renvoyer à nos lâchetés, à nos com-
promissions, à nos vies dans tous ces
petits microcosmes, quels qu'ils soient
d'ailleurs – oui, ce gars-là devrait être
un sacré gêneur ! D'ailleurs une excel-
lente façon de l'assimiler, de le digérer
pour nous permettre de nous accom-
moder de ce qui est si dérangeant chez
lui, c'est de le porter aux nues. Et de ne
pas écouter le message. Quand j'entends
parfois certaines personnes me parler
de cette pièce, y compris des gens de
théâtre, je suis très étonné qu'on me
cite quasiment toujours les mêmes vers.
sommaire
p. 2 à 5
«CYRANO ME TOUCHE
ENCORE PLUS QU'ALCESTE»
CYRANO DE BERGERAC
Edmond Rostand
Dominique Pitoiset
p. 6
LUCKY PETERSON
PHILIPPE PETRUCCIANI
AHMAD JAMAL
DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS
p. 7 à 10
LES BIBLIOTHÈQUES
DE L'ODÉON
ROMAIN GARY PAR JOANN SFAR
ET DAVID BELLOS
p. 11 à 12
TRANSMETTRE :
UN PROJET POUR L'AVENIR
ENTRETIEN AVEC AURÉLIE FILIPPETTI,
ministre de la Culture et de la Communication
p. 13
THÉÂTRE,
UN CHOIX D'EXCELLENCE
L'ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE,
CARREFOUR DE PRATIQUES
p. 14
AVANTAGES ABONNÉS
Invitations et tarifs préférentiels
p. 15
ACHETER ET RÉSERVER
SES PLACES
p. 16
LANCEMENT DE SAISON
2014-2015
LE CAFÉ DE L'ODÉON
OUVERTURE
© Brigitte Enguérand
Ce monstre
de premier
degré, ce
porteur de
moustache...
Cyrano
me touche
encore plus
qu'Alceste.
Une force
qui s'en va
sans être
dupe...
SUIVEZ-NOUS
Twitter @TheatreOdeon
Facebook «Odéon-Théâtre de l'Europe»

4 5
Je voudrais revenir sur une courte réplique, une entre mille, d'un héros dont on sait
désormais combien il est cher à mon cœur. «Au manteau de Thespis je ne fais pas de
trous», clame Cyrano dès l'acte I, superbe, tout en lançant sur la scène une bourse
pleine d'or. Pour faire son entrée en scène, on s'en souvient, le héros doit d'abord
faire place nette, chasser des planches un prétendant de Roxane, l'usurpateur Mont-
fleury, l'histrion qui vocifère et massacre l'alexandrin en accaparant l'attention des
spectateurs. Pour cela, il faut bien que Cyrano recoure un peu au scandale, inter-
rompe la représentation. Pas moyen de faire autrement s'il veut intervenir dans l'es-
pace public. Il s'y emploie, et avec quel brio ! mais il assume aussi d'en payer le prix
et se dépouille lui-même pour dédommager les acteurs : Cyrano restera donc les
poches vides et l'estomac creux.
Quelle morale en tirer ?
La première crève les yeux. Ce n'est pas qu'un artiste doive toujours consentir à se
ruiner pour se faire entendre, ce serait plutôt l'inverse, car toute peine mérite salaire
– après tout, même le médiocre Montfleury et sa bande y ont droit... Non. Cette
morale, c'est que le théâtre, art du temps et de l'air du temps, ne se fait pas tout seul.
Il est sans doute une magie, mais une magie où il n'y a pas de miracle. Pour ma part,
je n'ai cessé de répéter cette évidence, au risque de paraître importun. Les finances
sont une condition nécessaire, sinon suffisante. Cyrano le sait bien. Alors il paie, et
largement, en grand seigneur, lui qui est bien loin d'en être un – mais voilà, lui, il sait
ce qu'il veut: on n'accueille pas des artistes chez soi pour les réduire à raccommo-
der les trous au manteau de Thespis.
Cela étant, il est une autre morale, plus secrète, à déchiffrer dans cette histoire.
Une morale non pas pour le mécène, mais pour l'artiste qu'est aussi et d'abord mon
cher Cyrano. Le fait est que le don de l'art, le cadeau que le créateur tente de faire
à la communauté, entraîne pour lui, et plus souvent qu'on ne croit, un certain coût.
Regardez ce que fait Cyrano. Il ne se contente pas de rémunérer la compagnie qu'il
expulse du théâtre : il le fait en donnant à sa largesse même une valeur esthétique. On
peut estimer qu'il entre un peu de vanité ostentatoire dans un tel procédé, mais je ne
crois pas que ce soit là l'essentiel. En jetant son or sur scène, Cyrano éblouit l'assis-
tance, mais à ses propres dépens, puisant dans ses ressources intimes pour régler
un problème public. Et son geste est tout à la fois si naturel et si spectaculaire – oui,
ce geste lui ressemble tellement! – que tous ou presque n'y voient que du feu. Telle
est la pudeur de Cyrano. D'ailleurs, à l'en croire, il ne s'agit pas de lui : c'est au nom
de Thespis qu'il se voue en une seconde à des semaines à venir d'obscure pauvreté.
Qui est Thespis ? Le père fondateur du théâtre. Figure à demi légendaire, il parcou-
rait, dit-on, les bourgades de l'Attique en traînant après lui un chariot contenant ses
accessoires, ses masques et ses costumes. Le théâtre n'a jamais tout à fait oublié
son père. Il reste précaire, exceptionnel, fragile, passager comme un cortège de
fête. D'un côté, il est institution, et demeure désormais dans la cité; d'un autre, n'a
jamais cessé de voyager de ville en ville. Un pied dans le grand rituel, l'autre chez les
saltimbanques, et c'est ainsi qu'il marche. Voyez Shakespeare. Voyez Molière, que
Cyrano admirait tant.
Il faut donc voyager, quand on aime le théâtre. Ce n'est pas si facile. Parfois il vous en
coûte. Il faut savoir tantôt rester, tantôt partir. Pour que le voyage se prolonge sous
d'autres climats, avec d'autres, vers d'autres buts.
Mais toujours, si possible, avec panache.
Dominique Pitoiset, Bordeaux, juin 2013
«AU MANTEAU DE THESPIS
JE NE FAIS PAS DE TROUS»
Cyrano entre artiste et mécène
J'en parlais aux élèves du Théâtre
national de Bordeaux-Aquitaine la
semaine dernière. Tout le monde me
cite la tirade des «non merci». Ou plu-
tôt les «non merci» en eux-mêmes. Je
vois bien pourquoi: la même formule
revient plusieurs fois, en anaphore, et
elle est mémorable. Donc, on se rap-
pelle le geste de refus. Mais ce qui est
formidable dans ce texte, ce ne sont
pas les «non, merci!». Ce sont les rai-
sons que donne Cyrano pour rester tel
qu'il est, refuser de subir l'influence
d'autrui, ne pas être asservi à des
pouvoirs quels qu'ils soient. C'est cet
argumentaire, cette liste des motifs
pour repousser toute compromis-
sion, qui est d'une puissance extraor-
dinaire. Le cœur de ce que dit Cyrano
n'est pas si connu que ça. De ce point
de vue, le parti-pris du spectacle, qui
est de plonger tous ces personnages
dans un monde interné, un univers
psychiatrique, nous autorise juste-
ment un premier degré incroyable. On
peut tout se permettre, on peut tout
jouer avec le code que semble récla-
mer l'écriture. Parce qu'il y a diffé-
rentes écritures dans cette pièce,
comme dans beaucoup de chefs-
d'œuvre. Il y a des moments de farce,
du comique, de la tragédie, du lyrisme,
du grandiloquent. C'est comme dans
Shakespeare: le tragique ne doit pas
l'emporter, y compris dans Hamlet.
Même là, il y a des scènes qui doivent
être drôles – sinon, c'est plat. Shake-
speare l'avait compris: le jeu de mots
peut être un condensé de sens, un rac-
courci stupéfiant. Un gag peut résu-
mer toute une vie. Quelqu'un qui se
trompe, quelqu'un qui trébuche, dans
le bon contexte – ça dépend qui tombe
et sur quoi – un geste d'une seconde
peuvent valoir trois volumes de com-
mentaire. Rostand connaît cette pro-
fondeur d'écriture-là, ce télescopage
des tons et des genres. Notre parti-
pris nous permet de prendre tout ça à
bras le corps, d'une façon très franche.
D. L. – Vous le jouez à fond tous les
soirs...
P. T. – C'est la moindre des politesses
à l'égard d'un tel personnage. Il faut
s'engager, vraiment, dans l'écriture,
dans les mots, il faut les faire son-
ner, les faire entendre. Un acteur qui
se contenterait de débiter un texte
pareil, ce serait un outrage. Cyrano
veille avec tellement d'égards sur la
langue, il prend tellement de soin à
dire son fait à l'autre, et à s'expliquer
sur ses pulsions, sur ses envies, sur
ses principes… «Se battre ou faire
un vers», comme il dit. Un tel être de
batailles et d'écriture, un énergumène
qui place si haut l'absolu de l'amour,
mérite qu'on s'y attelle sans réserve et
qu'on fasse tout pour lui, qu'on fasse
tout entendre, tout voir, tout rebondir.
Y compris ses failles, ses contradic-
tions, ses faiblesses.
D. L. – Par exemple?
P. T. – Je pense à un des derniers vers,
quand il dit à Roxane: «Non, non, mon
cher amour, je ne vous aimais pas!»,
quand il se trahit...
D. L. – Comment le comprenez-vous?
P. T. – C'est plus fort que lui. C'est un
lapsus de mourant. Il ne peut pas tenir,
il ne peut plus nier, parce qu'il est par-
tagé, déchiré. D'un côté, il veut proté-
ger la croyance de Roxane, préserver
le mythe sur lequel elle a vécu: elle se
figure que celui qu'elle aime, l'auteur de
ces lettres sublimes, c'est Christian. Et
en même temps elle presse à ce point
Cyrano qu'il est finalement forcé de
réaliser que sous prétexte de la pro-
téger il est en train de lui mentir, et que
la plus haute forme de respect pour
elle, c'est peut-être de lui avouer cette
vérité qu'il ne peut pourtant pas énon-
cer. Et donc, il doit dire sans dire: «oui,
vous avez raison, je vous aime» – pro-
noncer et biffer ces mots, les raturer
à l'instant même où ils résonnent...
C'est un lapsus de quelqu'un qui ne
peut plus cacher ni se cacher – face à
la mort, face à la bien-aimée, face aux
questions qu'elle pose.
D. L. – Mais il ne peut lui dire la vérité
que parce qu'il va mourir...
P. T. – Voilà. C'est la fêlure de la pièce:
s'il avoue son amour, il meurt. C'est
comme si c'était la condition du pacte
de Cyrano avec Christian. S'il dévoile
le truc, il est mort. Il lui avait dit, à l'acte
II: «Je serai ton esprit, tu seras ma
beauté». C'est quasiment faustien...
Cyrano ne peut pas croire qu'il puisse
être aimé. Il a grandi dans la certitude
qu'il n'était pas beau. Et quand on n'est
pas beau, on n'est pas aimable. C'est
ce qu'il confie finalement à Roxane,
mais il ne peut le lui dire qu'à l'ex-
trême fin : «Vous ?... Au contraire !
J'ignorais la douceur féminine. Ma
mère / ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai
pas eu de sœur. / Plus tard, j'ai redouté
l'amante à l'œil moqueur.» D'où son
silence avec la bien-aimée. Il ne veut
pas lui avouer qu'il l'aime, parce qu'il
est convaincu que lui-même ne peut
pas être un objet d'amour. C'est ce
silence qui le fait exister ailleurs, qui le
pousse à inventer la figure de Cyrano...
Il s'est construit sur ce désespoir-là,
sur cette parole retenue. Il ne peut
en parler, s'ouvrir, avouer, qu'au
moment de disparaître. Sa fureur
guerrière, son côté «s'en fout la mort»,
vient d'une immense frustration. Il
n'est absolument pas normal de ris-
quer sa vie deux fois par jour pour
aller poster une lettre! Il n'est abso-
lument pas normal d'aller tout seul
porte de Nesle affronter une centaine
de spadassins qui veulent massacrer
Lignière, un copain poète et alcoo-
lique ! Cyrano est quelqu'un qui se
dit: «De toutes façons la vie ne m'a
pas autorisé à aimer, donc...» Donc,
c'est un peu tout ou rien, l'existence
sublime ou le suicide. Ou une façon de
combiner les deux à la fois: en amour
je ne suis rien, partout ailleurs j'existe
en surrégime. Quand il dit à Le Bret:
«Qui j'aime?... Réfléchis, voyons», il
faut voir comment il arrive à sa conclu-
sion, car sa confidence est une conclu-
sion: vu «ce nez qui d'un quart d'heure
en tous lieux me précède», puisque je
suis tellement laid que «le rêve d'être
aimé même par une laide» m'est défi-
nitivement fermé, alors autant y aller
franchement : «j'aime – mais c'est
forcé! – la plus belle qui soit». Autre-
ment dit, puisque ça ne peut être que
du rêve, autant rêver large!
D. L. – Ce n'est pas trop épuisant de
jouer un personnage qui se veut tou-
jours au sommet de soi-même?
P. T. – C'est usant, ça fatigue, mais c'est
exaltant. Les autres aussi auraient
de quoi être fatigués. Après-demain,
mercredi, à Rennes, on va aborder
la 80
ème
. On est une belle troupe, on
s'entend merveilleusement bien.
On était émus et joyeux de se retrou-
ver. C'est essentiel pour moi d'être
accompagné de gens qui sont vrai-
ment heureux de faire ce spectacle.
Dans une distribution, et je comprends
cela très bien, quand on n'a qu'un ou
deux petits rôles, on peut éprouver une
sorte de lassitude, et quand certains
acteurs en ont un peu assez, on peut
le ressentir... Mais là, il ne s'agit tel-
lement pas de ça, c'est un spectacle
qui implique tellement tout le monde!
Nous sommes vraiment onze sur le
plateau. Bien sûr, c'est moi qui parle
le plus, mais nous sommes pratique-
ment tous là tout le temps. La troupe a
quelque chose de fort à jouer d'un bout
à l'autre. Et ça se répercute sur l'état
général. Il faut cette énergie pour aller
chaque soir chercher les spectateurs.
Quand les gens s'installent et voient le
décor, comme il n'y a pas de rideau, ils
ont tout le temps de se dire: «Ah non,
quand même, ce n'est pas possible,
Cyrano là-dedans, non !»... Et pour-
tant à la fin c'est tellement le contraire,
ces mêmes gens viennent nous dire:
«Mais on l'oublie! On oublie le décor,
et quand le décor nous revient quand
même, on se dit qu'il est hyper-juste
et on se demande comment on a pu le
monter autrement...»
D. L. – C'est qu'on assiste en direct à
la naissance d'un personnage occupé
à se mettre au monde...
P. T. – Oui, bien sûr, pendant tout le
temps de la représentation... Je com-
mence à jouer en m'arrêtant en pleine
phrase parce que je viens de m'aper-
cevoir qu'il y avait là du public. Je
m'avance, et c'est là que je dis à toute
la salle: «Que tous ceux qui veulent
mourir lèvent le doigt.» Comme s'il
se demandait: mais c'est quoi, là, ce
trou noir... Et à la fin de l'acte V il a
sa réponse: «Ah, je vous reconnais,
tous mes vieux ennemis!» Entretemps,
petit à petit, le jeu s'est organisé
autour de lui, celui qui a eu l'intuition
que ce trou noir, là, c'était le public.
Les autres, ses compagnons, restent
enfermés dans un espace sans trou et
sans issue. Pour eux, chaque fois que
Cyrano regarde la salle, c'est comme
s'il regardait le mur du fond. Et donc,
ce spectacle met aussi en scène le
temps de la représentation. Grâce à
Cyrano, grâce à son premier degré ou
à son intuition instinctive d'un monde
d'avant l'enfermement – à moins qu'il
ne l'ait jouée, ou qu'il n'ait été lui-même
un spectateur absolument conquis par
cette pièce... – en tout cas, grâce à lui,
on se remet dans le temps et la géogra-
phie d'une représentation théâtrale.
Comme si lui, à force de regarder le
public, obligeait finalement les autres
à faire comme lui. Et à se regarder eux-
mêmes dans le miroir qu'il tend.
D. L. – Un miroir assez sévère...
P. T. – Implacable. Qui peut oser dire
«Oui, oui, bien sûr, je suis comme
Cyrano» ? Personne. Même le plus
bravache des va-t-en-guerre. Il est un
miroir d'une pureté absolue sur notre
condition d'animal social...
D. L. – Ce miroir, est-ce qu'on n'est
pas obligé de le briser en fin de
représentation?
P. T. – C'est lui-même qui le brise pour
le public. Il a cette dernière courtoi-
sie: il se brise pour que le public n'ait
pas à le faire.
D. L. – Mais entretemps il a conquis le
costume du rôle...
P. T. – Oui, au bout de cinq actes, il a
bien gagné le droit de l'endosser au
moment de revenir prendre congé. Sa
toilette funèbre... C'est un moment
d'une très grande émotion. Le fan-
tasme s'incarne. Cyrano est passé
dans l'autre monde.
Propos recueillis par Daniel Loayza
le 20 janvier 2014
Tout ou rien.
L'existence
sublime ou
le suicide.
Cyrano veille
avec tant
d'égards sur
la langue... d’Edmond Rostand
mise en scène
Dominique Pitoiset
dramaturgie
Daniel Loayza
scénographie et costumes
Kattrin Michel
lumière
Christophe Pitoiset
travail vocal
Anne Fischer
coiffures
Cécile Kretschmar
avec
Jean-Michel Balthazar
Adrien Cauchetier
Antoine Cholet
Nicolas Chupin
Patrice Costa
Gilles Fisseau
Jean-François Lapalus
Daniel Martin
Bruno Ouzeau
Philippe Torreton
Martine Vandeville
Maud Wyler
production déléguée
Théâtre National de Bretagne – Rennes
coproduction
MC2:Grenoble ; Théâtre national de Bordeaux
Aquitaine ; Compagnie Pitoiset – Dijon ;
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ;
Espace Malraux / Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie ; Centre National de
Création et de Diffusion Culturelles de
Châteauvallon ; Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines / Scène Nationale
créé le
5 février 2013 au Théâtre National de
Bretagne – Rennes
durée2h40
rencontre avec l’équipe artistique
le vendredi 13 juin à l’issue
de la représentation
projection nouvel odéon
mardi 3 juin / 20h
Capitaine Conan de Bertrand Tavernier
avec Philippe Torreton
nouvelodeon.com
7 mai – 28 juin / Odéon 6 e
CYRANO
DE BERGERAC
Si Cyrano a tout pour séduire, c'est aussi
parce que le chef-d'œuvre de Rostand
est tout entier une histoire de séduction,
à double ou triple fond. L'une des grandes
forces de la mise en scène de Dominique
Pitoiset tient justement à ce que cette
séduction est à la fois interrogée et
exaltée, remise en question et en jeu,
quitte ou double, tous les soirs.
En surface, la pièce célèbre d’abord
le charme d’un héros paradoxal. Loin-
tain héritier du miles gloriosus de la
comédie antique et proche cousin du
Matamore de la commedia dell'arte,
il s'en distingue par un trait essentiel:
lui ne fanfaronne pas. Sous l'outrance
apparente, tous ses exploits sont vio-
lemment réels – ou plutôt, nous sug-
gère Pitoiset, ils sont supposés tels
par tout son entourage. Et il importe
qu'ils le soient, car l'héroïsme de
Cyrano répond à une certaine attente
sociale. Vous voulez du spectacle,
UN HÉROS PARADOXAL
«Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas !»
semble-t-il demander à l'acte I? Vous
en aurez, et du vrai, du meilleur. Il a un
côté sacrificiel, qu'il assume pleinement:
non seulement ce héros-là compense
les faiblesses du reste de l'humanité (à
commencer par celles de ses specta-
teurs), mais il accepte d'en payer per-
sonnellement le prix. Dans le combat du
pot de terre (appelons-le Cyrano: géné-
rosité, élégance morale, désintéresse-
ment) contre le pot de fer (appelons-le
de Guiche: manipulation, dissimulation,
cynisme), c'est toujours lui, perdant
magnifique, qui paie follement les pots
cassés.
Cyrano est bel et bien tel qu'il se veut:
sans rival, admirable en tout point, incom-
parable – et pour cette raison même, on
le sent bien d’entrée de jeu, il est voué à
disparaître, ce qui le rend d’autant plus
précieux. Il est trop pur pour être long-
temps de ce monde. Ennemi déclaré de
toute compromission, il s'attire des ini-
mitiés qui finissent par peser lourd. Il est
à l'image de son nez : la mesure, très peu
pour lui. Cyrano dépasse, a trop de relief
pour ne pas attirer la foudre, et comme
de juste, la mort finit par lui tomber du
ciel. Mais entretemps, quel brio dans
l’affirmation de soi, quelle insolence
dans la dénonciation de la médiocrité
du monde, et de combien de frustrations
ne venge-t-il pas ses humbles admira-
teurs! Cyrano ne sépare pas l’éthique de
l’esthétique. Chez lui, toute conviction
s’incarne en geste, se fait sentence,
s’achève en représentation. Si un acteur
est mauvais, il ne le tolère pas sur les
planches; si un politicien tente de le cor-
rompre, il le bafoue; si un plat courtisan
cherche à l’outrager, il le transperce de
son inoubliable verve – à moins qu’il ne le
touche «à la fin de l’envoi», car la pointe
de son épée n’est moins acérée que celle
de ses répliques. Chaque acte attire ainsi
sur sa tête une nouvelle raison de se faire
tuer, et à chaque fois, il s’en tire, contrai-
gnant ses ennemis mêmes à saluer son
incroyable et virtuose intégrité. Il y a du
funambule dans ce gaillard-là, toujours
en équilibre sur le fil des alexandrins,
fidèle à lui-même jusqu’à l’extrême mot
de la fin qu’il ne laisse à personne le soin
de dire à sa place. Cyrano est de bout
en bout une créature extraordinairement
attachante, d’une énergie et d’une vitalité
fantastiques, dont rien n’épuise jamais
l’incroyable appétit.
Mais appétit de quoi, au juste ? La
richesse, le pouvoir, n’ont aucun intérêt
pour Cyrano: «non, merci». Il a même
un côté ascétique, on ne le voit quasi-
ment jamais manger. Tout cela est bon
pour le vulgaire. Cyrano, lui, est un peu
comme Alceste, il veut qu’on le distingue.
Mais à la différence du Misanthrope, il n’y
parvient que trop bien. Il aime étonner,
aime se battre à un contre «oh! pas tout
à fait cent», aime risquer chaque jour sa
vie aussi froidement que s’il était sûr de
ne jamais la perdre – bref, Cyrano aime
jouer. Premier interprète de lui-même,
il ne peut exister qu’en étant, à tous les
sens du terme, un personnage. Pour être,
dans ce monde si étroit et si bas, il lui
faut jouer à être – à être plus et mieux
que ce que l'on est, larger than life, à être
Cyrano. L'identité sublime, la seule qui
vaille, ne s'invente qu'ainsi. Son costume,
c’est sa fierté farouche ; son acces-
soire, c’est son nez. Drapé dans l’une et
encombré de l’autre, quand il entre en
scène, c’est pour en chasser un acteur
qu’il juge inepte, mais aussi pour le rem-
placer au pied levé– et gare à qui vou-
drait lui contester le premier rôle! Il lui
faut être singulier, sous peine de n’être
rien. Et attirer sur lui tous les regards
– mais pour mieux se cacher.
Car cet homme excessif, explosif, tru-
culent, ce libertin des derniers temps
de la Fronde est aussi par un génial ana-
chronisme le dernier des romantiques.
Et non le moins timide: désespérément
épris de Roxane, il n’ose se déclarer, il
s’est déjà condamné lui-même. Est-ce
pour cela qu’il paraît souvent chercher la
mort en multipliant les provocations? Du
moins ne se suicide-t-il pas. Ce curieux
tempérament d’artiste, à la fois mélan-
colique et sanguin, sculpte librement sa
vie comme un chef-d’œuvre baroque, car
lui, «c’est moralement <qu’il a> ses élé-
gances.» Il aime trop les défis pour ne pas
s’en jeter à lui-même, à la hauteur de son
rêve. Et puisque la délicate Roxane ne
peut aimer Christian si celui-ci manque
d’esprit, qu’à cela ne tienne, Cyrano l’en-
richira du sien, puisqu'il faut, pour plaire
à la précieuse, que le ciel et la terre se
rejoignent, ou semblent le faire. Il faut
offrir à la bien-aimée, dès ici-bas, l’idéal
d’une perfection digne de ses romans
– il faut qu’à la beauté visible l’invisible
réponde. Et si c’est là une folie, tant pis,
puisque c’est à ce prix qu’est né un des
plus étonnants monstres bicéphales du
théâtre: un adorable corps d’amant muet
qu’escorte dans l’ombre sa doublure son,
âme éperdue et jouant d’autant mieux
son rôle qu’elle est absolument sincère
– une chimèresignée Cyrano.
Daniel Loayza
acte IV, scène V
© Brigitte Enguérand

6 7
Jeudi 3 juillet / 20h
En première partie, Philippe Petrucciani présentera son dernier
album Este mundo; en seconde partie, Lucky Peterson viendra
présenter en avant-première son nouvel album The Son of A Blues
Man, enregistré à Dallas.
LUCKY PETERSON
The Son of A Blues Man – nouvel album, juin 2014
Lucky Peterson – guitare, chant
Tamara Peterson – chant
Shawn Kellerman – guitare
Timothy Waites – basse
Raul Valdes – batterie
Marvin Hollie – claviers
Lucky Peterson a acquis une réputation comme l'un des artistes les plus éminents de
l'époque moderne. Un guitariste, organiste fantastique et chanteur de premier ordre.
L'un des joueurs les plus polyvalents travaillant dans le blues.
PHILIPPE PETRUCCIANI
Este mundo – album 2012
Philippe Petrucciani – guitare
Nathalie Blanc – chant
Dominique Di Piazza – basse
Manhu Roche – batterie
Grand mélodiste et rythmicien, Philippe Petrucciani est ici au sommet de son art,
tant au niveau de l'interprétation, un swing lyrique unique, que de son écriture. Lui
qui a longtemps composé pour son frère, le pianiste Michel Petrucciani, il lui dédie
l'émouvant «Mike P».
LE BLUES EST PARTOUT
OÙ JOUE UN BLUESMAN
LES
BIBLIOTHÈQUES
10 mai – 13 juin 2014
Philippe Petrucciani
© Dominique Combe
tarifs exceptionnels
(voir p.15)
LUCKY PETERSON
PHILIPPE PETRUCCIANI
AHMAD JAMAL
Lucky Peterson
© JM Lubrano
Ahmad Jamal
© Jean-Baptiste Millot
Tout concert de M. Ahmad Jamal est une
fête. Tout concert, une expérience, bien
au-delà de la musique. C’était vrai de son
trio dans les années 1950. Cela le reste
à un point rare, du quartet déjà présenté
trois fois à l’Odéon (2013).
Ahmad Jamal offre à l’œil nu la com-
munion de la musique. Pure circula-
tion d’inconscient à inconscient. Parade
nuptiale d’amour et de technique.
Érotique de groupe. Tout ce que «la grande
musique indienne-américaine» atteint
de plus haut. Ahmad Jamal – voir Miles,
Mingus, Duke Ellington – ne parle jamais de
«jazz». Ils savent de trop près ce à quoi le
mot aura servi. Il parle du blues. Il parle des
musiciens, de ce courant qui passe entre
les musiciens, et de sa ville, Pittsburgh,
Pennsylvanie. Il y est né le 2 juillet 1930.
«Nous devons une part de notre être à
notre ville natale», rêve Albert Einstein.
De loin, cette phrase sonne aussi simple
qu’une chanson des rues. Sans compter
avec cette chance : nul ne saurait choisir
sa ville natale. De près, ceci, crucial: la
phrase d’Einstein nous débarrasse des
tragiques âneries de l’origine et du terroir.
C’est déjà ça. Elle nous ramène au jazz,
sa géographie, son réseau, son rhizome.
Levé à 6h du matin, le sourire éclatant et
l'œil d’oiseau, Ahmad Jamal décline tous
les musiciens de Pittsburgh: les géants
(Mary Lou Williams, Roy Eldridge, Ray
Brown), les humbles, les phénomènes.
En scène, avec ses airs de derviche tour-
DEUX CONCERTS
2 – 3 juillet / 20h
Théâtre de l'Odéon 6e
neur au génie spontané, il les sait là, pré-
sents dans l’air, les fluides, les ondes. Il
joue avec eux, big band du big bang.
Comme tous les bluesmen, Lucky
Peterson vient des bords du Missi-
ssippi, ou peut-être de Chicago. Eh bien
non ! Il vient de Buffalo, dans l’État de
New York (1964). Son guitariste de père
y tenait le Governor’s Inn. Tous les blues-
men, et pas des moindres (Muddy Waters
ou Buddy Guy) défilent à la maison. Très
tôt, Peterson le Veinard prend des cours
d’orgue. Professeur ? M. Jimmy Smith
en personne. Il pratique le légendaire
Hammond B3 avec la même fougue que
la guitare. Le même enthousiasme qui
porte sa voix.
Le blues, c’est comme le flamenco ou la
grande musique afro-américaine. Il est
partout où joue un blues man, un fla-
menco, Ahmad Jamal. Aussi produc-
tif que toute forme fixe (le sonnet, par
exemple, dans la poésie européenne,
ou le haïku de l’école de Kyoto), le blues
aux règles faussement simples s’offre à
l’infini des combinaisons et de l’engen-
drement. Chaque fois uniques, comme
le cœur de Lucky Peterson.
L’histoire du «jazz» n’a rien à voir avec ce
qu’on raconte. C’est la géographie des
âmes et des espaces ; des chemins qui
se croisent avec le diable pour témoin.
Plus les anges tutélaires de Pittsburgh
pour rire avec les diables.
Francis Marmande
Mercredi 2 juillet / 20h
Ahmad Jamal nous fera l'honneur de revenir sur le plateau du Théâtre de l'Odéon pour un
concert unique à Paris.
AHMAD JAMAL
Saturday Morning – album 2013
Ahmad Jamal – piano
Herlin Riley – batterie
Manolo Badrena – percussions
Réginald Veal – contrebasse
Le pianiste américain Ahmad Jamal est aujourd'hui l'un des derniers grands témoins et acteurs de l'histoire de la musique
classique américaine, un terme qu'il préfère à celui de jazz.
OD ON
Romain Gary et son chien,
dessin de Joann Sfar
© Futuropolis
NOUVEL ALBUM
LUCKY PETERSON
The Son of A Blues Man – juin 2014
Dédicace par Lucky Peterson de son
nouvel album à l'issue du concert du
3 juillet au Théâtre de l'Odéon.

David Bellos
Après un doctorat en littérature française à
l'Université d'Oxford, David Bellos a enseigné
dans plusieurs universités de Grande-Bretagne
puis rejoint en 1997 le campus de Princeton, où il
occupe la chaire de Littérature Française et Com-
parée et dirige le Programme de Traduction et
Communication Interculturelle. Lauréat du premier
Man Booker International Prize décerné à un tra-
ducteur, il a signé des versions anglaises d'œuvres
de Georges Perec (dont La Vie mode d'emploi:
Life A User's Manual, 1987), Ismaïl Kadaré, Fred
Vargas ou Romain Gary (Pseudo: Hocus Bogus,
2010). Ses réexions et sa pratique en la matière
lui ont inspiré une étude intitulée Le Poisson et le
bananier. Une histoire fabuleuse de la traduction
(Flammarion, 2012). David Bellos est également
l'auteur de biographies de référence : Georges
Perec. Une vie dans les mots (Seuil, 1997, prix
Goncourt de la biographie); Jacques Tati: sa vie
et son art (Seuil, 2002); Romain Gary. A Tall Story
(Londres, Harvill Secker, 2010, inédit en français
à ce jour).
8 9
pour les Frères Zborowski, personnages d’Éducation
européenne. Paysans maquisards et peu tendres
de la Pologne orientale, ils punissent un traître non
pas d’une balle dans la tête, mais en lui prenant un
sac de patates. Ce qui garantit non seulement sa
mort à lui, mais celle de toute sa famille. «Et il parut
soudain à Janek que le monde des hommes n’était
qu’un sac immense dans lequel se débattait une
masse informe de patates aveugles et rêveuses:
L’humanité».
David Bellos, le 16 février 2014
c’est Cimarron, cette maison for-
mat château que Gary s’est fait
construire à Majorque, avec vue
imprenable sur la mer. Avant de la
vendre. Pour la racheter ensuite.
Gary, qui a fini par avoir des bribes
d’immobilier en Grèce et à Tahiti
aussi, sans compter son immeuble
de la rue du Bac, ne brillait guère
dans la gestion du foncier. Il avait
trop d’autres choses à faire.
c’est pour les désarmés, dont la
seule arme, disait Gary, citant
Freud, une fois n’est pas cou-
tume, c’est l’humour. D pour
Désopilant. D pour Désespéré.
c’est pour éléphant. Ludo, le héros si parfait du der-
nier et plus grand roman de Gary, Les Cerfs-volants,
est douée d’une mémoire d’éléphant. Comme son
auteur, il porte le fardeau d’une mémoire historique.
Ce n’est donc pas une coïncidence si Morel, dans
Les Racines du Ciel, défend les droits des hommes
en protégeant ceux des pachydermes.
c’est pour la France Libre. Romain
Gary fut parmi les tout premiers à
répondre à l’appel du 18 juin. Avant
fin juillet 1940, il signa l’engagement
dans la grande rencontre à l’Albert
Hall à Londres, et ne se désengagea
jamais. «Ma saison a été la France
libre», a-t-il dit en 1978. Sans elle, «je
n'aurais rien fait de ce que j'ai fait
dans ma vie et j'aurais été, à l'heure
actuelle, hôtelier sur la Côte d'Azur.»
Et dans Chien blanc : «Il n'y avait pas
de Gaulois, d'Algériens, de Juifs, de
Noirs ou de Grecs... il n'y avait que des
frères tueurs et tués.» Romain Gary,
tout en étant russe, polonais et juif,
est un enfant de la France libre.
c’est pour Gengis, Gengis Cohn, artiste de music-hall
à Varsovie, ainsi nommé à cause de son humour plu-
tôt féroce. Il y avait de quoi. Au moment d’être fusillé
par un SS, il baisse son pantalon et lui montre son der-
rière. Ce geste lui vaut d'être transformé en dibbouk,
un esprit malicieux qui s’installe pour l’éternité dans la
conscience du malheureux Hauptjudenfresser Schatz.
Après la guerre, Gengis se trouve donc aux commandes
d’un banal inspecteur de police de la République Fédé-
rale. Il s’y amuse comme un fou ! Le fait parler en
yiddish ! Réciter le kaddish ! C’est du plus mauvais goût.
Tant mieux.
c’est pour Ijmuiden, ville industrielle des Pays-
Bas sur laquelle Gary a fait pleuvoir des bombes
à plusieurs reprises. «Les bombes que j'ai lâchées
ont peut-être tué dans son berceau un Rilke, un
Goethe, un Hölderlin !» a-t-il dit trente ans plus
tard. Mais il a fait revivre le nom de cette ville
dévastée dans un dieu pré-colombien, Ijmujin,
objet de la dévotion de l’affreux dictateur Almayo,
dans Le Mangeur d’Étoiles. Petite compensation,
mais compensation tout de même.
c’est Jean Seberg, la Jeanne
d’Arc de Preminger et la muse de
Belmondo dans À Bout de souffle.
Lorsque Gary la croise à Los
Angeles en 1959, c’est le coup
de foudre. Cela s’est très mal ter-
miné, mais pendant une petite
décennie Jean a donné à Gary
le plus grand et peut-être le seul
véritable amour de sa vie. Sans
compter son unique enfant.
pour Kacew, le nom de famille du père
de Romain Gary, et donc le sien. C’est la
graphie polonaise du nom russe katzef,
lui-même adapté de l’Allemand Katz, qui
veut dire «chat», mais ce n’est là que le
masque des deux lettres hébraïques kuf
et tsadek, pronounces k-ts, qui forment les
lettres initiales des deux mots kohen tse-
dek, «prêtre véritable». L’itinéraire de ce
nom se prolonge lors de l’émigration pour
donner, à Nice, en 1928, la prononciation
kassef, avec une assonance plutôt arabe
que polono-russo-germano-hébraïque.
«J'étais alors dans le Midi l'équivalent d'un
Algérien aujourd'hui», a-t-il expliqué pour
éclairer sans le dire la véritable identité
de Momo, le héros de La Vie devant soi.
c’est Lady L., premier roman
rédigé en anglais par le consul
général de France à Los
Angeles. Situé à Genève, pour
faire un clin d’œil à Sous Les
Yeux d’Occident de Joseph
Conrad, ce roman léger et spi-
rituel croise anarchistes et
lords anglais, passions amou-
reuses à la Stendhal et conspi-
rations politiques. Un joyau de
malice et d’esprit français écrit
en anglais d’Angleterre aux
États-Unis par un diplomate
russo-polonais. Qui a peur de
la littérature comparée ?
pour Mina, Mina Kacewa, née Owczinska, la mère
de Romain Gary, et créée par lui sous le nom plus
russe et donc moins juif de Nina, dans La Promesse
de l’aube. «Autofiction» avant la lettre, La Promesse
est sans doute le plus grand roman d’amour filial de
la littérature française. «Je l’ai eue assez tard» dit
Gary de cette femme dure à cuire atteinte de «fran-
cophilie galopante». C’est à la volonté de fer de sa
maman que Gary doit de ne pas avoir dérapé pen-
dant son adolescence fougueuse.
est pour Nice, où Gary est arrivé à l’âge de 14 ans. Cette ville depuis toujours cos-
mopolite abritait à cette époque une population extrêmement diverse — russe,
polonaise, suédoise, anglaise, italienne et nissarde. Elle a apporté à l’immigré
du nord une mer extraordinairement bleue et le carnaval: la nage et le grotesque
seront dorénavant deux grands axes de sa vie et de son œuvre. Par ailleurs, en
nissart, pour parler d’un petit rat de ville, on dit: «garri.»
c’est pour over the top, expression anglaise qui signifie «excessif».
Oui, Gary est un homme excessif: excessivement érotomane, exces-
sif dans son habillement, qui pouvait varier d’un jour àl’autre d’un
manteau en vison à une parka de clochard, excessivement voyageur,
excessivement polyglotte, excessif autant dans sa fidélité à de Gaulle
que dans ses jeux de mots. He was just too much! disent les gens
de bon goût. Et tant pis pour eux.
permet un coup de chapeau à Raymond Queneau, le seul des lec-
teurs professionnels du manuscrit de La Solitude du python à Paris à
avoir flairé sous ce prétendu premier roman un écrivain chevronné.
L’auteur, écrit-il dans sa note de lecture pour Gallimard, doit être
«pas mal imbu de lui-même et sûrement un emmerdeur. Ce n'est
qu'un épigone, mais, dans le genre, le talent est certain». Par retour
du bâton Queneau sera un des auteurs que la presse parisienne
soupçonnera d’avoir inventé Émile Ajar.
c’est pour Sganarelle, ce person-
nage de la commedia dell'arte que
Gary prenait pour un picaro. C’est
sa formule personnelle d’une aven-
ture toujours à recommencer et
donc du roman à la façon de Gary.
C’est pour cette idée d’un person-
nage toujours fuyant en avant, et
donc «Pour Sganarelle», que Gary
a pondu son seul texte de théorie lit-
téraire. C’est le plus long et le moins
lu de tous ses ouvrages. Dommage
qu’il n’ait pas eu le temps d’en faire
la version courte.
pour Tulipe, roman-pamphlet contre la
bonne conscience de l’Occident, rédigé
à Londres dans les premiers jours de
la paix en 1945. Le personnage central,
un rescapé de Buchenwald ayant des
points communs avec Gandhi d’une part
et Groucho Marx de l’autre, lance un mou-
vement «une prière pour les vainqueurs»
et engage une grève de la faim tout en
mangeant un sandwich au jambon.
Dans Tulipe paraissent pour la première
fois l’humour extravagant et l’insolence
politique de l’auteur de La Danse de
Gengis Cohn. Sartre avait promis de
publier le second texte de Gary. Lorsqu’il
a lu le manuscrit de Tulipe, il a changé
d’avis d’un seul coup.
c’est pour la Rue du Bac. Gary y loue un logement en 1960, au retour de Los Angeles,
avec Jean, avant d’y acheter un appartement de 10 pièces, le premier et seul véritable
port d’attache dans cette vie de déplacements successifs. Gary se trouveainsi le
voisin de Georges Perec — qui ne pensait même pas à le lire. Mais lorsqu’on deman-
dait à l’auteur des Racines du Ciel s’il se considérait plus français que russe, plus
polonais que juif, et ainsi de suite — Gary se retranchait dans son petit quartier de
Paris et se déclarait fièrement «citoyen de la rue du Bac».
NATALIE DESSAY
lit L'échange des princesses de Chantal Thomas
Lydie Debièvre – Que représente pour
vous le passage de la voix lyrique à la
voix narrative ?
Natalie Dessay – Une libération ! On
est dans le pur plaisir de raconter une
histoire, sans le souci de la technique,
sans se préoccuper d'avoir à projeter
la voix, de faire de beaux sons. On est
libre de placer sa concentration ail-
leurs. Cela dit, il faut tout un travail
préliminaire. Une bonne lecture est
un exercice exigeant.
L. D. – Avez-vous déjà lu L'échange des
princesses ?
N. D. – Oui, dès que cette lecture à
l'Odéon s'est décidée. Je suis très
heureuse de la faire et je m'y pré-
pare depuis longtemps. J'ai d'ail-
leurs beaucoup apprécié ce texte, qui
a été pour moi l'occasion de décou-
vrir Chantal Thomas. J'aime rencon-
trer des auteurs comme cela, à partir
de propositions qui m'évitent parfois
de choisir...
L. D. – Qu'est-ce qui vous a plu en parti-
culier dans ce texte ?
N. D. – La façon qu'a Chantal Thomas
de montrer l'oppression de toute une
société. On pourrait s'imaginer qu'au
XVIIIe siècle le peuple était esclave
et que les souverains n'en faisaient
qu'à leur tête, mais non : eux aussi
sont sous pression, eux aussi sont
pris dans une espèce d'engrenage
qui les broie, eux et leurs enfants. En
fait, tout le monde est en prison, les
riches comme les pauvres. Il n'est
pas question des basses classes
dans L'échange des princesses, mais
on se rend d'autant mieux compte
que ces puissants, ces monarques,
tous ces gens qui détiennent le pou-
voir, comme on dit, sont eux aussi des
captifs : ils sont tellement enchaînés
par l'étiquette, par les manœuvres
nécessaires pour asseoir leur position
et les privilèges de leur caste, qu'ils
sont prêts à sacrifier leurs propres
enfants. C'est atroce. On s'en dou-
tait, bien sûr, mais la description qui
en est faite nous fait toucher du doigt
l'horreur de ce mécanisme – de cette
vente, ni plus ni moins, de princesses
entre deux pays, sans aucun souci des
individus.
L. D. – Vous parliez à l'instant de la libé-
ration qu'est pour vous le passage du
lyrique au dramatique. Et vous abordez
ce roman à travers la question de l'op-
pression. La liberté est un thème qui
semble vous toucher spécialement...
N. D. – Oui. C'est un livre très riche,
qui permettrait d'aborder beaucoup
d'autres points. Celui-là n'est que
le premier qui me vienne à l'esprit...
Mais vous avez raison, la question de
la liberté me hante depuis longtemps.
L. D. – Aujourd'hui, envisagez-vous de
vous lancer dans une carrière purement
dramatique ?
N. D. – Oui, et c'est ça qui est drama-
tique !... (grand éclat de rire). Non,
sérieusement, tant que j'ai la santé,
je vais continuer à chanter. J'ai beau-
coup de plaisir à donner des récitals,
à chanter de la chanson. Mais quelque
part, les récitals, les chansons, c'est
aussi une façon de se rapprocher du
texte. Et c'est aussi ce que je voudrais
faire par la pratique du théâtre pur.
Pour être plus proche des mots qu'on
ne l'est quand on fait de l'opéra. C'est
cela qui m'intéresse.
L. D. – Pour vous rapprocher aussi d'une
certaine vérité, peut-être ?
N. D. – Il y a de cela. Il y a aussi le fait
d'être plus créatif. Je pense qu'un lec-
teur et un chanteur sont créatifs dif-
féremment. Et pour moi, le lecteur est
le plus créatif des deux. Précisément
parce que la musique n'est pas don-
née. On doit recréer la musique. Et
c'est cela que je trouve merveilleux.
L. D. – Votre propre musique ?
N. D. – C'est délicat. Il faut trouver sa
propre musique tout en respectant
celle de l'auteur. La musique de Duras
n'est pas celle de Beckett... Il y a une
plus grande part de créativité per-
sonnelle, mais qui se mêle à toute une
recherche, à tout un travail sur l'auteur
et sur sa langue.
L. D. – En somme, vous restez une
interprète...
N. D. – C'est vrai. Pour moi, la lecture
permet d'affiner des sensations d'in-
terprète. Pour aller encore plus loin.
Propos recueillis par Lydie Debièvre
Les afches européennes
de Les Racines du Ciel.
Film tourné en 1958 par
John Huston d'après le roman de
Romain Gar y.
PETIT ABÉCÉDAIRE DE ROMAIN GARY
Il parlait plusieurs langues, signait de plusieurs noms, vécut plusieurs vies. Romancier, diplomate, héros de
guerre, immigrant, étudiant, homme à femmes, grand maître ès pseudonymes, Romain Gary alias Émile
Ajar, né Roman Kacew en 1914 en Lituanie, demeure le seul auteur à avoir remporté le Prix Goncourt deux
fois. L'Odéon-Théâtre de l'Europe tenait à s'associer à la célébration de son centenaire. David Bellos, l'un
de ses plus fins connaisseurs, nous a fait l'amitié de composer en guise de portrait et d'hommage ce bel
abécédaire apéritif.
pour xénisme, figure de rhé-
torique qui consiste à insé-
rer un terme étranger dans
un texte français. Gary en
est un des grands maîtres.
En fait, on aurait du mal à
trouver une seule page
de cette œuvre multiple
et étendue qui soit écrite
exclusivement avec des
mots français. Mais lorsque
des critiques malveillants
ont reproché à Gary de ne
pas savoir écrire la langue
nationale, ils ont reçu une
réplique admirable. Gary
s’est mis à écrire en anglais.
lundi 2 juin / 20h
VOIX DE FEMMES
Chantal Thomas s'entretient
avec Jean Birnbaum
Textes lus par Natalie Dessay
lundi 19 mai / 20h
EXILS
conversation avec Paula Jacques
ROMAIN GARY / JOANN SFAR
Textes lus par Bruno Abraham-Kremer
couverture du livre
L’échange des princesses (détail)
Le Seuil © Josse/Leemage
c’est pour Boston, l’avion bombardier
fabriqué aux États-Unis et fourni par
les Britanniques au groupe Lorraine
des Forces Aériennes de la France
Libre, basé à Hartford Bridge à partir
de janvier 1943. Gary a effectué plus
d’une centaine de missions dans ces
lourdes carcasses volantes. Le soir, à
la caserne, il griffonnait son premier
roman, qui ne s’appelait pas encore
Éducation européenne. Après la guerre,
Romain Gary se sentait toujours en
sécurité lorsqu’il prenait l’avion. Après
tout, on ne tirait pas dessus. Et surtout,
ce n’était pas un Boston.
c’est évidemment le yiddish, qui aurait pu et peut-être aurait dû être la langue maternelle de Romain
Gary, comme elle l’était pour une bonne moitié de la population de sa ville natale. Mais Gary a parlé le
russe d’abord, et, lors de son retour à Wilno, il a adopté le polonais, nouvellement imposé comme langue
d’enseignement. L’écho du yiddish surgit d’abord dans Les Racines du Ciel, lorsque Gary croit faire
parler allemand à un de ses personnages, mais bien davantage dans les œuvres signées Ajar. Pourquoi?
Parce que pendant son service consulaire à Hollywood dans les années 50, Gary a dû réapprendre la
langue de ses voisins d’enfance pour bien suivre les dialogues entre Billy Wilder, Sam Goldwyn et bien
d’autres figures de l’industrie du cinéma qui n’avaient pas très bien maîtrisé l’anglais.
pour Ajar, Prix Goncourt 1975 pour La Vie devant soi. D’où vient donc cet
énième pseudonyme ? D’Al Azhar, l’université du Caire ? De l’Azharie,
pays du Caucase ? D’Azhar, le domaine de chasse des rois d’Afghanis-
tan ? Des initiales de «l’Association des Juifs Anciens Résistants», qui n’a
jamais existé ? «Ajar» veut dire «mi-ouvert, mi-fermé» en anglais, mais
Gary laisse entendre dans Vie et mort d’Émile Ajar que ces deux syllabes
signifient «braise» en russe. Ce qui est faux! Gary est un artiste de la
mystification onomastique. Émile Ajar est son chef-d’œuvre.
c’est pour Hoppenot, Éric Hoppenot, ambas-
sadeur au long parcours et fin connaisseur
des hommes. C’est à lui que Gary doit d’être
nommé à New York, en 1952, dans un poste
qui lui a été doublement propice. C’est dans
un minuscule appartement à Manhattan que
Gary a pu rédiger son grand roman d’Afrique,
Les Racines du Ciel, qui lui a valu son premier
Goncourt en 1956. Et c’est en tant que porte-
parole de la délégation française auprès des
Nations Unies dirigée par Hoppenot que
Romain Gary fait ses premiers pas dans
les médias. Grâce à son anglais parfait, ses
beaux yeux et ses costumes élégants, Gary
devient rapidement le visage le plus connu
de la France après de Gaulle à la télévision
américaine.
c’est pour Pseudo, ouvrage
inventé en quelques semaines
pour établir une fois pour
toutes qu’Émile Ajar était
Paul Pavlowitch et que ledit
Pavlowitch était fou. Chef-
d’œuvre de roublardise en
trompe-l’œil, Pseudo porte l’in-
vention langagière à un sommet
inégalé. Nul virtuose oulipien n’a
tordu la syntaxe et l’orthographe
de la langue française avec un
irrespect plus hilarant. Opéra-
tion à tel point réussie qu’il n’a
jamais pu faire reconnaître son
immense talent d’écrivain sous
le nom d’Émile Ajar.
c’est pour Ulla, «notre mère à tous», la chef
des putes. «Nos saintes mères et sœurs
les putes sont ce qu’il y a aujourd’hui de
moins pseudo», déclare Pavlowitch, l’au-
teur prétendu d’Ajar. J’avoue ne pas com-
prendre les rapports que Romain Gary
entretenait avec la prostitution, peut-être
même que je ne veux pas les comprendre.
Ce qui est sûr, c’est que Gary lui-même
n’en faisait pas un mystère.
pour Vilna, cette ville si tristement
située sur les confins de la Russie
et de la Pologne, à portée de main
de la Prusse et au milieu de la Litua-
nie. Occupée par les Allemands
en 1916, tiraillée entre Polonais et
Lithuaniens de 1917 à 1922, avalée par
l’Allemagne nazie en 1941, et absorbée
par l’Union soviétique en 1945, Vilna
abrite au cours du XXe siècle surtout
des minorités. «Je suis un minoritaire-
né», disait Gary. Forcément, puisqu’il
est né à Vilna.
pour le whisky, que Gary détestait. C’était
peut-être le seul de sa génération de com-
battants et d’écrivains à éviter l’alcool et
même le vin. Il avait une sainte horreur des
drogues de toutes sortes et a fait un très
mauvais film pour dénoncer le trafic des
stupéfiants. Ce n’était pas un gourmand
non plus: il préférait un plat de petits pois
vapeur à un gueuleton à la française.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%

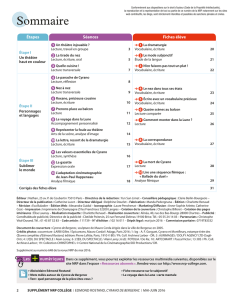


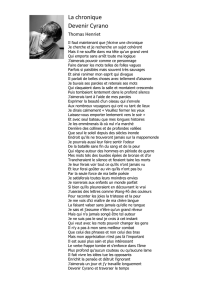

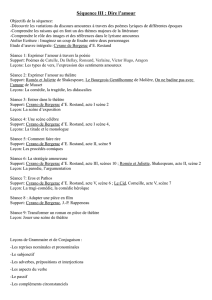

![Cyrano_recto [Converti] copie](http://s1.studylibfr.com/store/data/006409814_1-1a012a9a36a5abce98eeab588b0cd945-300x300.png)