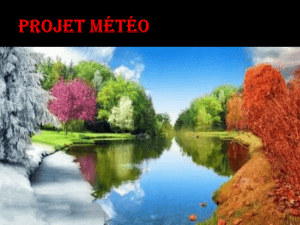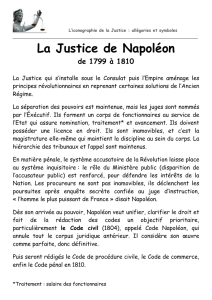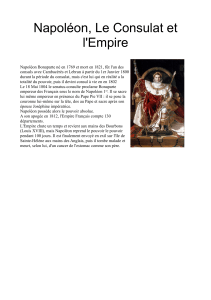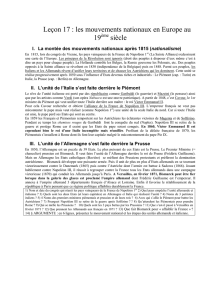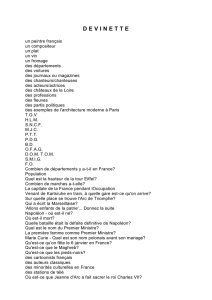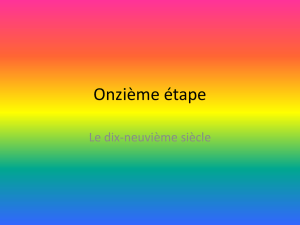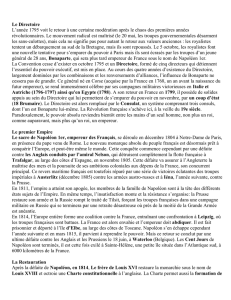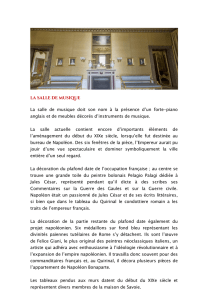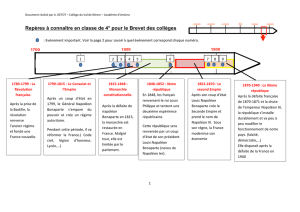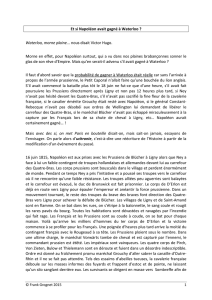L`Empire c`est la paix

La Guerre de Crimée
Ce conflit oppose la Russie, qui menace l’Empire Ottoman, à la Turquie, l’Angleterre, la France et
le royaume de Piémont Sardaigne, de 1854 à 1856. Il se déroule principalement sur les bords de
la mer Noire, à Sébastopol, en Crimée.
Les troupes françaises sont mal préparées au combat. Grâce à l’héroïsme des zouaves, elles
remportent tout de même la victoire face aux Russes lors de la bataille de l’Alma le 20 septembre
1854, puis lors de la prise de la tour de Malakoff le 10 septembre 1855.
Les troupes françaises rentrent victorieuses en 1856, ce qui donne l’occasion à Napoléon III
d’organiser un grand congrès de la Paix à Paris.
Pour célébrer la victoire française, les faïenceries de Creil et Montereau éditent les séries
d’assiettes sur le Siège de Sébastopol et Campagne de Crimée.
Le bassin de chaque assiette présente les différentes étapes suivies par les troupes françaises,
de leur départ à la victoire finale. L’aile de la série Siège de Sébastopol est ornée de quatre
trophées symbolisant la France, la Grande Bretagne, l’Empire Ottoman et le Piémont.
La campagne d’Italie
A la suite de la Guerre de Crimée, Napoléon III s’allie avec le royaume de Piémont Sardaigne, en
mariant son cousin à la fille du roi en 1859. Lorsque l’Autriche déclare la guerre au Piémont
quelques mois plus tard, Napoléon III vient en personne défendre le royaume. Fort de 140 000
hommes, il remporte les victoires de Magenta et de Solferino. Etant donné les nombreuses pertes
causées par ces batailles et la menace d’une alliance austro-prussienne, Napoléon III signe
finalement la paix de Villafranca, qui impose la présence autrichienne dans le Piémont. Avec cette
expédition, l’Empereur obtient le rattachement du comté de Nice et de la Savoie à la France en
1860.
A Solferino, les victimes sont abandonnées sur le champ de bataille. Le soldat suisse Henri
Dunant, bouleversé, conçoit alors le projet de constituer des sociétés qui soigneraient tous les
blessés de guerre, peu importe leur nationalité. Une association nait en 1863, dont les démarches
amènent à la Convention de Genève de 1864, pour la protection des victimes de la guerre. C’est
ainsi qu’est créé le symbole de la Croix-Rouge sur fond blanc.

L’expédition du Mexique
Le rêve de suprématie de Napoléon III s’étend outre-Atlantique, avec l’expédition du Mexique. En
1861, il s’associe à l’Angleterre, l’Espagne et l’Autriche pour renverser le gouvernement mexicain
mené par le républicain Juarez, accusé de ne plus payer ses dettes à la France. Les troupes
françaises se retrouvent rapidement les seules engagées. Elles prennent Mexico en 1863, et
installent au pouvoir l’Archiduc Maximilien d’Autriche.
Les faïenceries de Creil et Montereau en profitent pour éditer une nouvelle série, relatant les
événements de l’expédition du Mexique, du point de vue de l’Empire.
Napoléon III a sous-estimé la dangerosité de son adversaire, et fait miroiter un Empire à l’archiduc
Maximilien d’Autriche, qui est finalement abandonné par la France. Une guérilla menée par Juarez
et soutenue par les Etats-Unis dure pendant trois ans, et provoque le départ des troupes
françaises en 1867. L’échec est total : Napoléon III est vaincu, Maximilien meurt fusillé et les
relations européennes de la France sont au plus bas.
1
/
2
100%