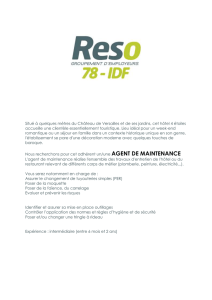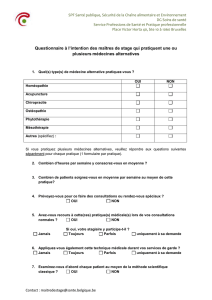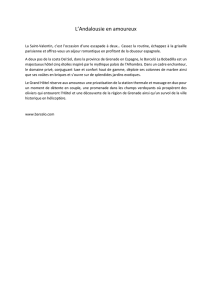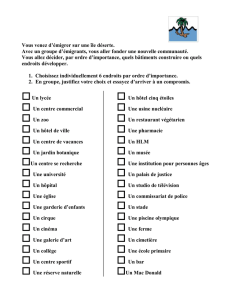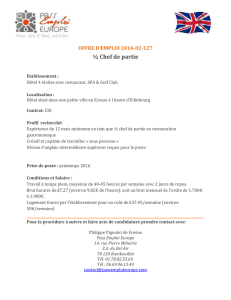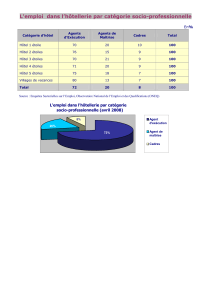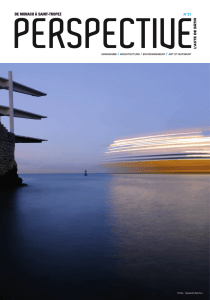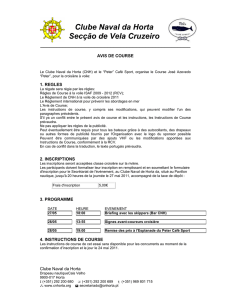Victor Horta, version étudiant

Katherine Rondou
Victor Horta
Aux côtés de Gaudí, de Guimard, de Van de Velde, de Mackintosh, d'Otto Wagner,
l'architecte belge d'origine gantoise Victor Horta est, à la charnière du XIX
e
et du XX
e
siècle,
l'un des plus brillants créateurs d'espaces. Il est aussi l'un des disciples les plus convaincus
de Viollet-le-Duc à avoir ouvert, en termes sensibles, simultanément industriels et
artisanaux, une problématique de l'architecture, problématique fondée sur le refus d'une
pratique obnubilée par des modèles anciens; sur l'hostilité à la dichotomie qui s'est opérée
au XIX
e
siècle entre architecture et construction (industrielle); sur la dénonciation d'une
croyance, à savoir que l'ingénieur « pionnier d'un nouvel art de bâtir » est seul habilité à
innover.
Effectivement, Horta est l'un des premiers à avoir dominé la résistance des
architectes, l'un des premiers à avoir perçu la vocation ornementale, calligraphique et non
seulement technologique du fer, l'un des rares constructeurs de la Belle Époque à avoir
retrouvé le sens de la communication architecturale. De cette œuvre il faut souligner la
densité, l'originalité, la puissance de persuasion et une épaisseur sémantique à ce point
remarquée, dès son apparition, qu'elle suscita dans l'agglomération de Bruxelles des sous-
codes de type stylistique ou rhétorique. Il y eut ainsi en Belgique, vers les années 1900, un
style Horta, une ligne Horta (la ligne « en coup de fouet »), un paling stijl (style anguille),
encore que ces désignations visent davantage le « décor » que les structures
fondamentales.
À cet égard, il convient de relever les innovations de Horta au niveau du plan :
remaniement du plan traditionnel de l'habitation bourgeoise (hôtel Tassel, Bruxelles, 1892-
1893), réponses à des programmes sociaux, économiques et culturels nouveaux (grands
magasins À l'Innovation, 1901; extensions du Grand Bazar Anspach, Bruxelles 1903; Grand
Bazar, Francfort, 1903; palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1922-1928), articulations
d'éléments tendant à postuler une « idéologie de l'habitat » (à Bruxelles : hôtel Solvay, 1895-
1900; hôtel Van Eetvelde, 1895 hôtel Aubecq, 1899-1900).
Au niveau du code syntaxique, il a procédé à l'invention et à la mise en place de
fermes métalliques, de tirants articulés et réglables, d'une coque à nervures métalliques
exceptionnellement légère, de consoles en pierre (maison du Peuple), de couvertures
translucides (verrières : hôtel Solvay, hôtel Aubecq, maison Horta, 1898), de façades
métalliques vitrées, nervurées, festonnées, fleuries (À l'Innovation, Grand Bazar), de piliers

Katherine Rondou
de soutien inclinés (À l'Innovation). Cette pratique architecturale conteste partout les canons
établis de l'éclectisme régnant, tout en reliant des fonctionnements inédits à une esthétique
de classe. Elle est, enfin, génératrice de rythmes ondoyants, où l'on identifie les pulsations
d'une « écriture », car c'est bien d'une écriture qu'il s'agit, concept qui désigne à la fois le
geste physique de l'inscription et « l'essence intérieure d'une activité ». L'écriture de Horta a
ses intonations spécifiques, ses nœuds (hôtel Solvay, maison Horta), ses transparences
(hôtel Tassel, hôtel Van Eetvelde), sa sobriété (hôtel Dubois, 1901), son économie (façade
de l'hôtel Van Eetvelde), sa nervosité (façade de À l'Innovation).
1
/
2
100%