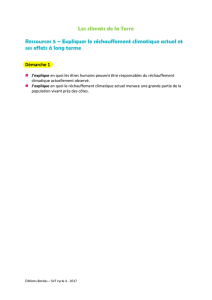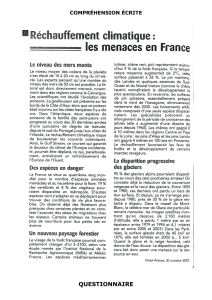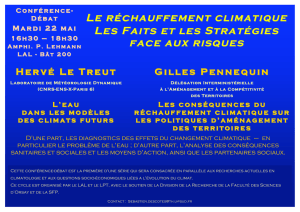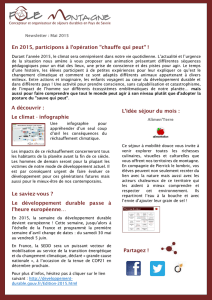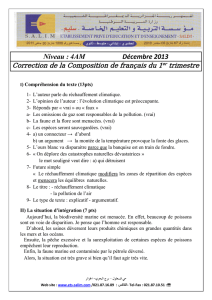La question climatique: un retour vers la pondération

La question climatique: un retour vers la raison.
Les médias et la conférence COP21
La future conférence COP21 sur le climat qui se déroulera à Paris du 30
novembre au 15 décembre a de grandes ambitions : il ne s'agit pas moins que
d’amener tous les pays du monde à souscrire à un engagement ferme pour
limiter de façon plus que drastique leurs émissions de gaz à effet de serre (c.à.d.
principalement le CO2). Puisque cette date tombe sous la présidence
luxembourgeoise, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger du Luxembourg
une approche de pionnier « ambitieuse » et « exemplaire » dans le combat
contre le changement climatique.
Pratiquement tous les médias, de quelque bord qu’ils soient, partagent cette
appréciation et essaient chacun à son tour d’amener les Luxembourgeois à
accepter les efforts à venir. En effet il s’agit d’éviter un réchauffement planétaire
dépassant 2°C en l’an 2100, hypothèse pratiquement non étayée par des
résultats scientifiques vérifiables, mais présentée comme la panacée pour éviter
de graves conséquences climatiques.
Nous voulons appeler, dans ce crescendo émotionnel et cette atmosphère de
zèle missionnaire, à un retour au calme et à la raison ; nous proposons une
analyse neutre qui ne s’appuie pas sur les modèles théoriques mais sur les
observations et mesures, et sur le bon sens commun.

Changement climatique, évidemment !
Le climat est communément défini comme l’état moyen de l’atmosphère, compte
tenu de ses variations statistiques. La période de calcul devrait s’étendre sur au
moins 30 années. Le soleil qui réchauffe notre atmosphère et la terre est le
moteur du climat. Son activité n’est cependant pas constante, mais varie selon
de nombreux cycles qui s’étendent sur des périodes de longueurs très
différentes.
Il est donc impossible que le climat reste constant. Les positions astronomiques
de la terre et de son axe par rapport au soleil sont la cause des grandes
glaciations, qui se suivent à peu près tous les 100000 ans. Durant les périodes
interglaciaires beaucoup plus courtes (env. 15000 à 20000 ans) d’autres cycles
sont à l’œuvre. Un des plus faciles à vérifier est le cycle de Bond millénaire qui
nous a fourni dans le passé les périodes chaudes (appelées souvent optimum
climatique !) minoenne, romaine, moyen-âgeuse et la période actuelle. Enfin les
cycles courts d’environ 11 et 22 ans de l’activité lumineuse et magnétique du
soleil se retrouvent dans pratiquement toutes les observations de températures.
Il est évident qu’une planète où vivent 7 milliards d’individus sera soumise à
d’autres contraintes qu’un monde peuplé de quelques centaines de milliers de
personnes. Une des influences humaines les plus importantes est certainement
le passage vers l’agriculture, puis vers l’urbanisation, qui toutes les deux
modifient les échanges radiatifs avec la terre, que ce soit par les changements
réflectifs du sol ou les émissions de poussière, de particules carbonées ou de
différents gaz.

Si la notion même de climat global constant est un oxymore, il est clair qu’une
politique « climatique » ne saurait éviter les changements intrinsèques, mais tout
au plus limiter dans une faible mesure un éventuel impact humain.
Les données.
Depuis les années 80 des milliards de fonds ont été injectés dans la recherche
climatique, mais des données fiables ne sont toujours pas disponibles en
quantité et en qualité suffisantes. Curieusement le nombre des stations de
mesure météorologiques a diminué de façon importante autour de 1990, et de
larges parties du globe (comme p.ex. l’Arctique) sont sous-représentées. Le
problème du calcul d’une « anomalie de température globale » n’est donc pas
négligeable, pour autant que cette notion même de température globale ait un
sens pratique. Les meilleures données sont celles fournies par les satellites
d’observation, mais ces séries ne commencent qu’en 1978/79. Cependant ces
mesures elles non plus ne sont pas sans problèmes, comme ceux des dérives
des instruments ou de la position orbitale des satellites. Néanmoins on les
considère comme les plus fiables, surtout qu’elles sont évaluées par deux
groupes indépendants (UAH et RSS), utilisant des méthodes différentes et
arrivant à des résultats presque identiques.
Si l’on observe ces mesures satellitaires, on n’y détecte aucune sérieuse cause
d’inquiétude, surtout que la tendance thermique des 21 dernières années est
pratiquement plate.

La place manque dans cet article pour discuter les nombreux scénarios
alarmistes sur la fonte des glaces polaires, la hausse du niveau des mer, la
multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes etc. Le plus simple
pour un lecteur averti est de consulter les données, qui sont librement
accessibles (comme p.ex. sur le site excellen[t] http://www.climate4you.com du
professeur Ole Humlum). Il y verra bien des cycles naturels, ou un léger
réchauffement tout aussi naturel pour une planète qui sort depuis 1850 d’un petit
âge glaciaire. Aucune des ces évolutions ne représente pour le moment un
danger réel.
Le GIEC (IPCC) et ses modèles climatiques.
Le GIEC (IPCC) n’est pas une organisation scientifique, mais une organisation
de l’ONU qui dès sa conception défend la thèse que l’influence humaine est la
cause principale des changements climatiques. Le principal responsable du
changement anthropogénique serait le gaz CO2 ; n’oublions cependant pas qu’il
existe à côté des émissions humaines dues à l’utilisation d’énergies fossiles des
sources importantes naturelles (biologiques et tectoniques), dont l’amplitude
n’est pas connue avec précision. Un autre oubli, ô combien important, est que le
CO2 fait vivre et croître le monde végétal ; depuis quelques années on peut
observer une nette augmentation des surfaces vertes planétaires (comme p.ex.
au Sahel), causée pour une bonne mesure par la fertilisation accrue du CO2
atmosphérique.

La question la plus importante dans toute cette discussion autour du CO2 est
celle de la sensibilité climatique : la sensibilité correspond au réchauffement
global provoqué par une concentration atmosphérique du CO2 qui deviendrait le
double des 280 ppm estimés au début du 19ème siècle. Après 37 années de
recherche climatique, il n’y a toujours pas de réponse satisfaisante. Le seul
résultat visible est que les publications récentes ont tendance à réduire de plus
en plus les valeurs prônées par l’IPCC.
Les modèles climatiques du IPCC proposent des scénarios qui bien entendu
sont importants dans l’étude de l’atmosphère. Ces scénarios sont cependant
presque toujours vus par les médias comme des prévisions infaillibles, bien
qu’une comparaison avec l’évolution observée et mesurée du climat montre des
différences importantes. Les plus de 100 différents modèles fournissent pour
l’échauffement futur des résultats étonnamment disparates, inutilisables
individuellement. On prend donc leur moyenne comme représentative d’une
vérité climatique. La figure suivante du Dr. John Christy de l’équipe UAH, montre
l’écart entre cette moyenne et les mesures des satellites et ballons.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%