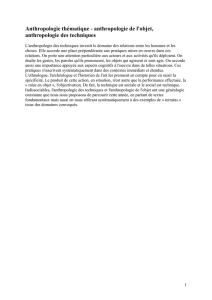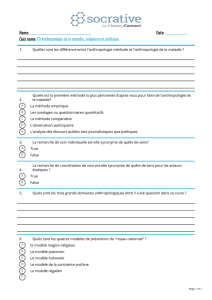Liste des interventions - fonds pour la recherche en ethique

ISEC
Institut de sociologie
économique et culturelle
L’anthropologie économique : un domaine à explorer.
Journée d’études du 15 / 16 octobre 2015
Université du Havre
11 propositions d’interventions :
Aléas climatiques et migration. Pourquoi les gens ne migrent pas alors qu’ils ont toutes
les raisons de le faire : une étude de cas dans la région Analanjirofo, Madagascar
Jérôme Ballet (Maître de conférences en économie
Université de Bordeaux)
Mahefasoa Randrianalijaona, Emilienne Raparson, Thierry Razanakoto
Une des caractéristiques majeures des populations pauvres de Madagascar est le fort degré
d’insécurité alimentaire auquel elles doivent faire face (FAO, 2004). Cette insécurité
alimentaire chronique est associée dans plusieurs régions à des évènements climatiques qui
accroissent les risques et donc la vulnérabilité des populations pauvres (sécheresse,
inondations, cyclones notamment). Comme le souligne Lallau (2011), la montée en puissance
des analyses sur les risques climatiques a poussé l’émergence d’analyses centrées sur
l’adaptation des individus et/ou des sociétés aux chocs et aux changements. Cependant, étant
donnée la faible capacité d’ajustement des populations pauvres, celles-ci optent la plupart du
temps pour des stratégies défensives qui réduisent aussi leurs capacités à sortir de l’ornière de
la pauvreté (Dercon, 2005). Parmi les stratégies utilisées, la migration constitue une solution
forte qui, si elle implique des risques est aussi porteuse d’espoir. Ainsi, Stark et Levhari
(1982) soulignent que la migration de membres au sein des ménages constitue un mécanisme
de diversification des sources de revenu via les transferts qu’elle génère.
Parmi les facteurs qui poussent à la migration, un relatif consensus s’est forgé sur l’idée que
les facteurs environnementaux ont un impact (Bates, 2002 ; Döös, 1997 ; Lonergan, 1998 ;
Wood, 2001) et que le changement climatique ou plus globalement les changements
environnementaux constituent des phénomènes d’accroissement des migrations au point que
la relation entre changement climatique et migration est devenue de « sens commun »
(Castles, 2002). De nombreux travaux ont d’ailleurs souligné ce fait dans une perspective
historique (Hugo, 1996 ; Afoloyan et Adelekan, 1999 ; Fang et Liu, 1992 ; Huang et al. 2003 ;
Mc Leman et Smit, 2006 ; Meze-Hausken, 2000 ; Rosenzweig et Hillel, 1993 ; Tyson et al.,
2002) La question ne serait alors plus de savoir si les facteurs environnementaux ont un
impact mais de savoir quelle sera l’importance de cet impact en termes de réfugiés

climatiques (El-Hinnawi, 1985 ; Jacobsen, 1988 ; Myers, 1993 ; Lonergan, 1998 ; Bates,
2002).
Cependant, cette relation si évidente fait l’objet de nuances. Perch-Nielsen et al. (2008)
indiquent par exemple que la relation dépend de la vulnérabilité effective des populations
mais aussi des régions qui sont affectées. Y compris pour des zones où la migration paraît
inéluctable comme certaines îles du Pacific, notamment les îles Tuvalu (Farbotko, 2005 ;
Chambers et Chambers, 2007, Mimura et al. 2007), Mortreux et Barnett (2009) ont montré
que les populations n’envisageaient pas de migrer pour des raisons culturelles et identitaires.
Plus généralement, il convient de tenir compte de la perception par les populations des
modifications environnementales (Dessai et al., 2004 ; Mc Leman et Smit, 2006), des
stratégies d’adaptation qu’elles mettent œuvre (Black, 2001) et de la perception qu’elles ont
de l’efficacité des stratégies d’adaptation (Barnett et Adger, 2003).
Dans cet article, nous analysons, à partir d’une enquête de terrain, pourquoi les populations ne
migrent pas alors qu’elles ont toutes les raisons de le faire. Autrement dit, nous voulons
souligner que les populations enquêtées ont toutes les raisons de migrer, e.g. elles se trouvent
en situation de survie et subissent des aléas climatiques dévastateurs, en particulier des
cyclones, de manière régulière, mais n’optent pas pour la stratégie de migration. Cette étude
met alors en évidence que les stratégies d’adaptation aux aléas environnementaux permettent
de relativiser l’impact des facteurs environnementaux sur la migration. De plus, cette étude
souligne que ces stratégies d’adaptation doivent être analysées sous l’angle de l’influence des
institutions sociales qui affectent l’accès aux ressources (Berry, 1989).
Dans la première section, nous présentons la zone d’étude et la méthodologie d’enquête. La
seconde section s’attache à analyser la situation des ménages dans la zone d’étude, en
particulier leur degré d’insécurité alimentaire et les stratégies alimentaires qu’ils mettent en
œuvre durant la période de soudure. Dans la troisième section nous analysons les effets des
cyclones sur l’insécurité alimentaire. Dans la quatrième section nous nous demandons alors
pourquoi, dans un contexte où les populations ont toutes les bonnes raisons de migrer, elles ne
migrent pas. Notre étude sur deux communautés rurales de l’Est de Madagascar, révèle que la
migration, bien qu’elle puisse être une solution aux problèmes rencontrés par les ménages,
n’est pas une solution envisagée. Les stratégies migratoires se heurtent aux obligations
communautaires et détruiraient les mécanismes de réciprocité et de solidarité qui permettent
aux villages de se maintenir.
Les femmes rurales et la création d’entreprise dans le cadre du dispositif d’aide CNAC
Melle EL GHAZI Halima
(Sociologue / Doctorante
Accompagnatrice en création d’entreprise)
L’Etat Algérien a mis en œuvre un dispositif d’aide à la création d’entreprise pour les
personnes âgées de 30 à 50 ans.
Beaucoup de femmes rurales, analphabètes se présentent afin d’avoir accès au financement en
bénéficiant de prêts en vue de créer leurs propres activités.
Dans un environnement culturel comme le nôtre en Algérie, ces femmes sont tantôt qualifiées
de courageuses, tantôt de soumises et inconscientes. Et même si elles sont conscientes, la
suprématie de l’homme (le mâle) les oblige à se plier à ses exigences. Même si le plus
souvent ces entreprises ne sont que des prête-noms pour leurs conjoints, frères ou pères qui
eux, pour une quelconque raison, ne sont pas éligibles au dispositif; dans la plupart des cas, on
retrouve la femme rurale qu’incarnaient jadis nos mères et grands-mères. En effet, ces
femmes décidées, sans aucune instruction, descendent en ville, accompagnées de leur
compagnon, pour passer des tests qui justifieraient de leur qualification en rapport avec

l’activité souhaitée et le projet sollicité. Elles passent devant une commission composée d’une
dizaine de membres et répondent à des questions qui leur sont posées sur leur projet. Elles
font preuve d’une ténacité et d’un entêtement tels, même si parfois devant les membres de la
commission il est évident qu’elles n’ont rien à voir avec le projet d’entreprise sollicité. Elles
« farfouillent » répondent laconiquement à des questions auxquelles elles n’ont pas de
réponses. Nous sentons qu’elles doivent faire ceci par esprit de famille, par crainte de refuser
et de subir les réprimandes du mâle, ou par volonté de saisir cette chance et de pouvoir enfin
s’imposer grâce à cette indépendance que lui confère le projet et à la contribution financière à
la subvention des besoins de la famille.
Nous y trouvons plusieurs types et profils selon différentes situations, que l’on s’attèlera à
décrire dans notre proposition d’intervention.
Anthropologie et économie : Oppositions, complémentarité ou intégration dans un
contexte de globalisation ; Philippe Hugon
(Professeur émérite de sciences économiques,
Université Paris Ouest La Défense)
Les disciplines peuvent être conçues comme un mode d’inclusion et d’exclusion dans le
champ de l’analyse au nom de méthodes spécifiques, de référents irréductibles et de conflits
de valeur. Elles sont alors en opposition plus ou moins radicale. On opposera, le don et
l’échange, l’utilitarisme et le symbolique, les valeurs « traditionnelles » et les valeurs «
modernes », communautaires et individualistes, les structures pré ou non capitalistes et les
structures capitalistes. L’anthropologie économique est alors définie comme analysant le rôle
de l’économie dans les sociétés non occidentales. Les disciplines sont également une manière
de découper le réel et de donner un éclairage partiel à une réalité complexe. Elles sont alors
complémentaires ou peuvent être intégrées au sein d’une anthropologie économique générale
et transdisciplinaire. Les disciplines anthropologiques et économiques sont complémentaires
et s’appliquent à toutes les sociétés pour analyser une réalité hybride et évolutive faite de
destruction/restructuration, de combinaisons plus ou moins conflictuelles de référents
pluriels, de confrontation de systèmes de valorisation. Elles doivent être par contre
contextualisées.
Cette communication rappellera l’histoire des relations entre anthropologie et économie qui
peuvent relever de ces deux interprétations. Elle illustre ce débat à propos des sociétés
d’Afrique sahélienne dans un contexte de mondialisation, d’hybridation et de rapports
asymétriques.
L’anthropologie économique, un retour au sujet ? François Régis Mahieu
(Professeur émérite de sciences économiques,
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines)
Le statut et l’objet de l’anthropologie économique sont très discutés en sciences sociales,
sauf par les économistes. Cette méthode permet une vision alternative à l’homo oeconomicus,
celle de la « personne totale », intégrant ses différentes dimensions, notamment
psychologiques. Elle rend l’économie responsable en élargissant le crime économique jusqu’à
toute décision pouvant augmenter la souffrance

Représentations culturelles de transferts d’argent au Cameroun : une analyse
anthropologique des fonds diasporiques Paul Ulrich Otye Elom
(Anthropologue,
Université de Maroua-Cameroun)
Au Cameroun, avoir des accointances familiales avec des individus installés dans les pays
occidentaux est synonyme de recevoir constamment d’eux des cadeaux et de l’argent. Il va de
soi qu’ici, l’Occident reste l’eldorado dont tout le monde rêve pour sortir de la misère ; et
pour ceux qui voient un des leurs partir, c’est une fierté immense, car avec lui, naît l’espoir de
lendemains meilleurs. En effet, chaque année, sont envoyées de fabuleuses sommes d’argent
provenant des pays du Nord, à des particuliers. Le constat est que, le plus souvent, cet argent
est utilisé pour les besoins essentiels et peu sont ceux qui prennent le risque de l’investir dans
des projets à long terme. Toutefois, il faut reconnaître que ce ne sont pas les intentions qui
manquent, et celui qui n’investit pas sérieusement, accuse l’Etat d’être responsable de cette
situation. On peut ainsi en déduire que l’argent des transferts d’argent, reste en grande partie
l’ « argent du ventre », puisqu’il s’agit de résoudre les problèmes primaires ; l’ « argent de la
frime », puisqu’il faut montrer aux autres qu’on est passé de la survie à la vie. Une analyse
des « sens du dedans » de l’argent des transferts nous permettra de mieux cerner le comment
et le pourquoi de l’emploi de cet argent par les camerounais. Cet article s’évertue ainsi à
révéler les patterns culturels qui font des fonds diasporiques, des fonds de subsistance, plutôt
que des fonds pour un investissement économique durable.
Monnaie, travail et genre au Maroc Pepita Ould Ahmed
(Economiste, chargé de recherche
Institut de Recherche et de Développement)
Dans le cadre d’un travail de terrain que je mène actuellement au Maroc dans cinq zones
géographiques marocaines spécifiques (Tadala, Marrakech, Tanger, Essaouira et Casablanca),
je cherche à analyser en quoi la rémunération salariale des femmes modifie leur rapport à la
monnaie et les rapports hommes/femmes dans le cadre familial mais aussi extrafamilial.
Cette recherche s’inscrit dans la continuité d’approches théoriques émanant de l’hétérodoxie
économique, la socio économie et de l’anthropologie économique qui réfutent l’hypothèse de
la théorie économique de la monnaie comme moyen de paiement fongible, i.e. un moyen de
paiement aux usages indifférenciés. Le caractère de fongibilité de la monnaie, qui définit la
monnaie comme pouvoir d’achat indifférencié, est rejeté. A l’inverse, mon travail privilégie
l’hypothèse d’un cloisonnement des pratiques monétaires dans nos sociétés contemporaines,
c’est-à-dire d’une différenciation des façons d’utiliser les monnaies selon les circonstances
sociales et sexuées. La monnaie n’est donc pas fongible mais cloisonnée, et ne revêt pas une
signification sociale une mais multiple. La monnaie se révèle ainsi à la fois être marquée
socialement et sexuellement, sa signification et ses usages évoluant selon la nature des dettes
à honorer (dette économique, dette sociale), ses utilisateurs attitrés, ses destinataires, sa
provenance, etc.
Parce que la monnaie n’est pas seulement un instrument des échanges marchands, homogène,
mais un symbole, un langage pour la communauté qui l’utilise, mon travail de terrain vise à
analyser les implications de la rémunération salariale des femmes au regard de ces cinq
questionnements intimement liés :
les perceptions et les usages de la monnaie des hommes et des femmes dans les zones
étudiées du Maroc. Le rapport à la monnaie prend toute sa signification si l’on
comprend ce que veulent dire les notions de temporalité, de spatialité, d’honneur,

d’échange, de don, d’obligation, de prêt qui structurent les pratiques des acteurs. Il
s’agit de révéler les arrière-plans extra-économiques qui déterminent les pratiques
monétaires.
interroger l’existence et les formes de marquage social et sexué des pratiques
monétaires. Il s’agit d’établir une typologie des dettes des ménages (économiques et
sociales) et des modalités de leur règlement en tenant compte de la provenance
physique ou sociale (gagnée ou héritée) des ressources, du sexe de leur détenteur, et de
la nature de leurs destinataires.
analyser en quoi la rémunération du travail des femmes transforme la structuration de
ces dettes et de leur règlement. Quels types de dépenses sont soldés par les femmes?
Est-ce que le travail des femmes engendre de nouvelles dépenses (comme des
dépenses liées au travail domestique externalisé) ? Si oui, qui les finance ?
étudier les répercussions de la salarisation des femmes sur les circuits de financement
formels et informels auxquels les femmes ont l’habitude d’avoir recours (circuits de
financement solidaires, tontines, microcrédit, etc.).
étudier si la salarisation des femmes modifie la condition et le rôle des femmes au sein
de la famille et dans leurs rapports extra-familiaux. Il s’agit notamment d’analyser
notamment si l’accès aux revenus pour les femmes engendre une implication plus
grande de leur part dans la prise de décision de la gestion familiale ainsi que de son
portefeuille.
Méthodologie et enquêtes :
Pour mettre au jour la diversité des régimes de significations et de représentations sociales de
la monnaie particuliers, la méthodologie retenue se caractérise par une double spécificité. Le
particularisme des pratiques monétaires se révèle nécessairement à travers une analyse micro,
voire méso, du fait monétaire. En outre, l’analyse de la signification sociale des pratiques
monétaires exige de se pencher sur la monnaie telle qu’elle se révèle dans les pratiques.
Mon travail reposera sur des enquêtes de terrain, des entretiens semi-directifs, des statistiques
et de la photographie. Les enquêtes qualitatives seront axées sur la méthode des trajectoires de
vie des acteurs. Cette méthode, inspirée de celle des «récits de vie» très courante en
anthropologie ou en sociologie qualitative, a pour objectif de restituer d’un point de vue
dynamique (et non statique) les motivations, les logiques et les contraintes qui sous-tendent
les stratégies et comportements adoptés par les acteurs. Tout en veillant à collecter des
données systématisées, cette méthode est particulièrement adaptée aux contextes où la
mémoire orale domine et où la quantification ne peut être opérée par un simple transfert des
modalités de mesure. L’objectif consiste à mettre les personnes interrogées dans une situation
de récit concernant les grands événements ou étapes de leur vie (vie familiale, sociale,
religieuse, politique, économique) et de mettre ces éléments en parallèle avec l’évolution de
leur capital humain, social et économique (terre, main d’œuvre, bétail, stock, épargne,
habitat…).
Don et dette versus partage dans le champ monétaire. L’exemple des monnaies
complémentaires locales ». Jean-Michel Servet
(Professeur de sciences économiques,
Institut des hautes études internationales et du développement Genève)
Sophie Swaton
(Economiste,
Faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne)
L'anthropologie économie s'appuyant sur le don contre don maussien et une lecture
catallactique de la réciprocité ont largement occulté le partage. L'application des communs au
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%