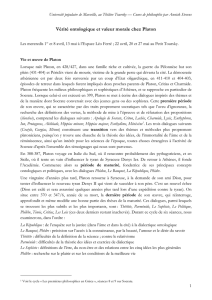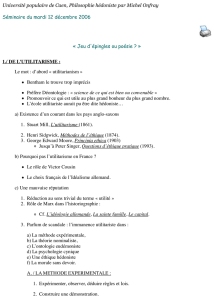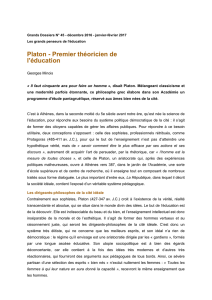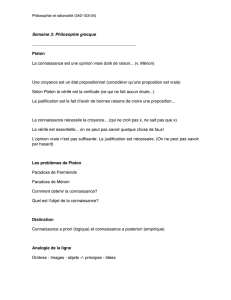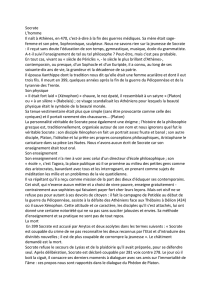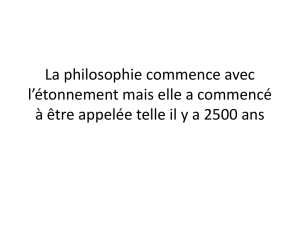Entretien avec Alain Caillé

Conjonctures n 23 139
Propos sur l’utile
Entretien avec Alain Caillé
ou
Dialogue entre un sociologue et un rêveur
par Thierry Hentsch
n octobre 1994, après un match mouvementé, deux
footballeurs amateurs, l'un rêveur, l'autre sociologue (à
moins que ce ne fût l'inverse) en vinrent à deviser sur
l'utile. L'un d'eux s'était réjoui que le ballon joignît
l'utile à l'agréable. Sur quoi, l'autre avait fait remarquer que
l'idée d'utilité prêtait à confusion. Quittant le terrain d'exercice
sans laisser celui du jeu, la discussion s'engagea bientôt sur l'uti-
lité du savoir et se poursuivit à peu près en ces termes
1
:
Le rêveur (R). L'utilité des sciences sociales me laisse toujours
songeur...
Le sociologue (S). C'est peut-être que le mot n'est pas bien
choisi. L'idée d'utilité est un caméléon, elle change en fonction
des objets sur lesquels elle se pose. L'utilité d'une voiture n'est
pas celle d'un cheval, même si tous deux sont mobiles et aptes à
transporter.
1
Comme on l'aura compris à la lecture de ce préambule, l'entretien a
été quelque peu réaménagé après coup, dans le plus grand respect pos-
sible de la pensée d'Alain Caillé. Fondateur du MAUSS (mouvement
antiutilitariste dans les sciences sociales), Alain Caillé a notamment
publié Splendeurs et misères des sciences sociales (Paris, Droz, 1986),
Critique de la raison utilitaire (Paris, La Découverte, 1989), La démis-
sion des clercs (Paris, La Découverte, 1993) et Don, intérêt et désinté-
ressement (Paris, La Découverte, 1994), sans compter ses nombreux
articles dans la revue MAUSS. Il a également contribué à L'Esprit du
don de Jacques T. Godbout (Montréal et Paris, Boréal et La Décou-
verte, 1992).
E

140 Conjonctures n 23
R. Oui, le transport est différent, et il peut être plus grand sur un
cheval...
S. Ou dans une voiture de course, c'est selon. Autre exemple,
l'utilité d'une découverte a peu de rapport avec celle d'un ta-
bleau, bien que tous deux soient le produit de l'invention. Il y a
autant d'utilités que de choses, et l'usage de ce terme varie tel-
lement d'un objet à l'autre qu'il ne définit plus rien. Rien
d'évident, rien d'absolu, en tous cas.
R. C'est que l'utilité désigne un rapport entre la chose et son
usage...
S. Même là, l'ambiguïté subsiste. Dire des sciences sociales
qu'elles devraient être utiles aux hommes, ne dit pas en quoi
elles le devraient. Mais si l'on disait : « Faut-il que les sciences
sociales parlent aux hommes ? » nous serions déjà plus près
d'une vraie question.
R. D'accord. Mais si je pense au mouvement que tu as fondé, le
« mouvement antiutilitariste dans les sciences sociales »
(MAUSS), je vois mal sur quelle base y adhérer s'il n'y a pas
moyen de s'entendre sur l'utile.
S. Le paradoxe est effectivement assez cocasse. Il vient du fait
que ce mouvement, outre le jeu de mots que ses initiales for-
maient avec un des plus grands théoriciens du don, Marcel
Mauss, a commencé par épouser sans trop réfléchir l'idée la
plus communément répandue sur l'utilitarisme : celle qui, à
toutes fins pratiques, le confond avec l'économisme qui im-
prègne nos sociétés. Il est évident que nous ne pouvons plus
nous satisfaire aujourd'hui du concept contre lequel le mou-
vement s'est élevé. L'utilitarisme est beaucoup plus vaste et
beaucoup plus ancien que ne le laisse supposer ce réduction-
nisme à l'utilitaire économique. Il y a là tout un champ à redé-
couvrir, que l'histoire de la philosophie a trop négligé.
R. Cet utilitarisme réducteur commence avec Bentham, non ?

Conjonctures n 23 141
S. Justement pas. Bentham est devenu, par ignorance ou mau-
vaise lecture, le symbole de l'utilitarisme malfaisant. En réalité,
il est le dernier des utilitaristes classiques.
R. Le dernier des classiques ? À la fin du XVIIIe siècle ? Mais
alors, avant lui ?
S. Avant lui ? La philosophie occidentale dans son entier !
L'axiomatique de l'intérêt est le fil rouge qui traverse 2 500 ans
de pensée politique. Le langage de l'utilité, la question de
l'équilibre des plaisirs et des peines sont déjà omniprésents
dans la philosophie politique de l'Antiquité. Le premier utilita-
riste est Socrate.
R. Allons donc ! Ce bon à rien, incapable de subvenir aux be-
soins de sa famille, qui passait son temps à se balader et à dis-
courir dans la rue, utilitariste ? De toute façon, il n'a rien laissé,
alors...
S. Disons le Socrate de Platon, accessoirement le Socrate de
Xénophon. À lire Platon et Xénophon, on trouve chez Socrate
une série d'identités entre le juste, le bon, le beau et l'utile. Que
reproche Socrate aux sophistes ? Pas du tout d'être des utilita-
ristes, mais de parler à vide, de défendre tout et son contraire,
de mettre leur l'éloquence au service de n'importe quelle cause,
sans discernement; de se laisser emporter par la beauté de la
rhétorique sans souci du bien public. Or il existe un critère du
bon, du beau et du juste : c'est l'utile - aux antipodes de ce
qu'on dit d'ordinaire de Platon. Dans La République, Socrate
tient des jugements très sévères sur la poésie et les poètes. Ho-
mère lui-même en prend pour son grade, bien que Platon, par
ailleurs, ne se montre pas insensible à sa grandeur et ne se gêne
pas non plus pour lui emprunter de belles formules.
R. Cette lecture de Platon se défend. Mais alors on pourrait tout
aussi bien faire une interprétation utilitariste de la mythologie,
de l'art, de la religion, non ? L'utilitarisme serait inhérent à la
société, il existerait avant d'avoir été pensé, et Platon ne ferait
que systématiser une tendance déjà à l'œuvre...

142 Conjonctures n 23
S. Platon le dit lui-même, les hommes s'assemblent par intérêt
matériel. L'harmonisation des intérêts va même très loin chez
Platon : si les intérêts matériels des classes productrices ne
parviennent pas à s'harmoniser d'eux-mêmes, il faut leur ra-
conter des histoires, ne pas craindre d'utiliser le mensonge.
C'est le premier degré de la vie en société. Dans La République,
Socrate appelle ça la république des pourceaux. C'est sans
doute ainsi qu'il qualifierait nos sociétés à nous. Mais selon lui,
il y a moyen de faire mieux. Le calcul des coûts et bénéfices
peut s'élever à un niveau supérieur. Ce calcul n'exclut pas la
norme, il la fonde, et toutes les classes de la cité ont intérêt à ce
que cette norme soit aussi haute que possible. La vertu est
éminemment rationnelle.
R. Dans La République, la question de savoir s'il faut être juste
ou s'il suffit de le paraître est effectivement posée en termes de
calcul...
S. A tel point que Thrasymaque reproche à Socrate ses ma-
nières de comptable !
R. Oui, mais par la suite, la discussion se complique. Ce qu'on
croyait clair se brouille. La justice, cette espèce d'équilibre idéal
que Platon désigne quelque part comme « l’accord avec soi-
même » ne se laisse pas quantifier. Elle ne se laisse même pas
saisir, finalement — qu'il s'agisse de l'âme ou de la cité.
S. Bien d'accord. Tout Platon n'est pas utilitariste, et son utili-
tarisme est très éloigné du nôtre. Il n'empêche qu'il est le pre-
mier à construire une axiomatique de l'intérêt (que le christia-
nisme ne manquera pas de reprendre et d'adapter), un système
de rémunération, de tarification dans lequel la rentabilité ne se
fait sentir qu'après un certain nombre de réincarnations :
mieux vivre cette vie-ci pour mieux choisir les suivantes. De
même, la cité idéale est inatteignable, mais on peut s'en rap-
procher, elle reste comme modèle, comme référence.
R. Justement, pour être conséquent avec la position socratique
de non-savoir, il faut admettre que l'utilité demeure introuvable.
S. Oui, fondamentalement, l'utilitarisme est impossible. Très
difficile à définir, foncièrement réversible. Si on pousse l'utili-

Conjonctures n 23 143
tarisme platonicien à son extrême, comme le fait Bentham, on
débouche sur l'antiutilitarisme. Reste que toutes les grandes
œuvres de la philosophie politique se situent d'une manière ou
d'une autre par rapport à cette logique de l'intérêt. Un des
rares à y échapper, paradoxalement, c'est Aristote, parce que
chez lui, le souverain bien est au-delà du calcul, il lui échappe.
Il n'y a rien non plus à gagner dans un autre monde, la beauté
est accessible ici bas. Sa théorie politique est fondée sur l'ami-
tié, la philia, sur le plaisir d'être ensemble et non sur l'harmo-
nisation naturelle de la république des pourceaux ou l'harmo-
nisation artificielle de la république des sages. Cela dit, l'équa-
tion entre le beau, le bon et l'utile est présente chez Aristote,
mais elle n'y est pas « calculée ».
R. Paradoxal, en effet, quand on sait que le vieil Aristote passe
souvent pour l'ancêtre du positivisme moderne. Mais, pour reve-
nir à Socrate et Platon, nous avons passé un peu vite tout à
l'heure sur la question de l'ignorance fondamentale. Tentons de
la reposer autrement : l'axiomatique de l'intérêt, de façon géné-
rale, suppose l'existence d'un sujet maître de lui-même, au clair
avec ses désirs. Le Ich (je) divisé de Freud indique qu'il n'en est
rien : nous sommes souvent à côté de nos désirs, nos pulsions
agissent masquées, à notre insu. Et cette division, on peut penser
qu'elle est déjà chez le Socrate de Platon.
S. Peut-être. Mais partons plutôt de Freud. D'abord, il faut se
rappeler que Freud (le premier Freud en tout cas) s'inscrit
dans l'axiomatique de l'intérêt; il a sans doute lu Bentham, et
la présence de métaphores économiques dans son œuvre n'est
pas due au hasard. Il y a chez lui, de toute évidence, un maté-
rialisme rationaliste qui s'inscrit dans le droit fil du calcul des
plaisirs et des peines, de sa rentabilité, etc. Or Freud, en
France particulièrement, est souvent brandi comme un auteur
qui serait dans une tout autre tradition. Cette lecture de Freud
est possible, et il ne s'agit pas de l'invalider mais simplement de
souligner la présence de cette dimension utilitariste chez
Freud, qui a tendance à disparaître sous la présentation sym-
boliciste du père fondateur (notamment par Lacan). On peut
discuter du point où Freud est arrivé, mais il ne faut pas ou-
blier d'où il est parti : d'une tradition qu'on peut faire remon-
ter à l'utilitarisme socratique sans difficulté.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%