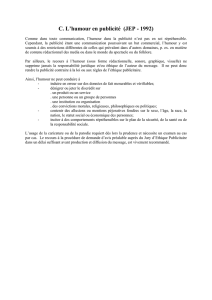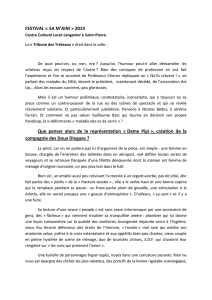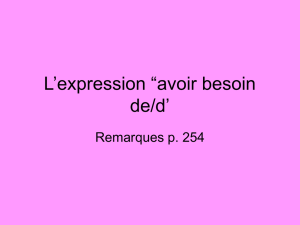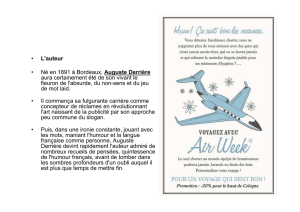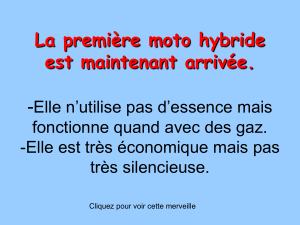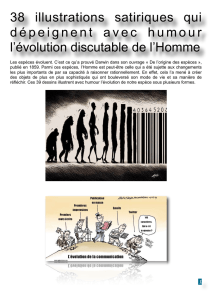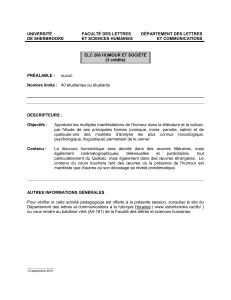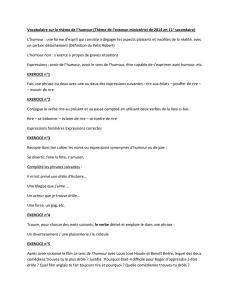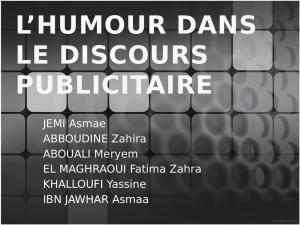Plan détaillé

Ce qu’apporte l’humour au lecteur ou au spectateur.
Analyse du sujet : il ne s’agit pas de critiquer l’humour ! Le verbe apporter est positif. On va
chercher en quoi l’humour nous enrichit, quels sont les bénéfices de l’humour. Pourquoi les
auteurs choisissent-ils d’avoir recours à l’humour ? Pourquoi les lecteurs ou les spectateurs
apprécient-ils l’humour ? A quoi sert l’humour ?
« au lecteur ou au spectateur » signifie qu’il fallait parler de l’humour dans l’art(littérature,
spectacle), mais pas dans la vie de tous les jours (blague belge racontée au coin d’un bar…)
Plan détaillé : (je ne développe pas tout)
I. L’humour répond à un besoin de divertissement
A. L’humour travestit un monde triste en monde joyeux, faisant surgir le sourire : rôle
carnavalesque de l’humour. On rit pour échapper au désespoir. Selon Boris Vian :
« l’humour est la politesse du désespoir ». ex : le film « la Vie est belle » de Roberto
Benigni, qui travestit la pire des tragédies humaines en aventure comique sans faute
de goût.
B. Le rire : un réflexe, un processus simple. Selon Bergson dans le Rire, c’est « de la
mécanique plaquée sur du vivant » « le vice comique est celui qui nous impose sa
raideur au lieu de nous emprunter notre souplesse ». Ainsi le comique de répétition,
le comique de mots est assez mécanique. Les temps modernes de Charlie Chaplin
assimilent l’homme à une machine. Les dessins animés montrent des êtres vivants
qui s’aplatissent en tombant, puis reprennent leur forme initiale.
C. L’humour est un exutoire. Le rire détend, apaise. C’est une forme de défoulement,
par rapport à des conditions de vie pas toujours faciles. On peut se moquer des
puissants à travers la satire. Ex : dessins de presse de Plantu. Guignols de l’info, etc…
II. L’humour permet de faire réfléchir
a. Un rôle provocateur. Il heurte volontiers les tabous dans le cas de l’humour noir. En
nous dégoûtant il va provoquer une révolte en nous. Ex : Swift dans « Modeste
proposition concernant les enfants de la classe pauvre », utilise le tabou de
l’anthropophagie pour mieux montrer le mépris des riches à l’égard des pauvres .
b. Une fonction critique et morale ; « castigat ridendo mores » dit-on en latin de la
comédie : c’est-à-dire « elle corrige les mœurs par le rire ». L’humour libère l’esprit
des fausses valeurs, développe le sens de la relativité par l’exercice du doute,
débouche sur une critique sociale. Ainsi Voltaire dans « De l’horrible danger de la
lecture » critique à la fois le despotisme, l’obscurantisme culturel et religieux…
c. Une façon efficace de convaincre. L’humour n’est pas explicite, c’est au lecteur de
faire le travail logique, donc sa réflexion est sollicitée de façon active et non passive.
Dans De l’esclavage des Nègres de Montesquieu, le lecteur peut croire à première
vue que l’auteur défend l’opinion des esclavagistes, mais on se rend compte au fil du
texte que les arguments sont tous plus bêtes et révoltants les uns que les autres, et il
s’agit d’une vraie démonstration par l’absurde de la stupidité du racisme et de
l’esclavage. Mais c’est le lecteur qui doit faire l’effort intellectuel de le réaliser.
Finalement, ce texte sera plus efficace qu’une dénonciation sérieuse.
1
/
1
100%