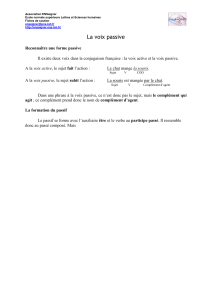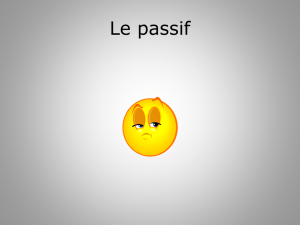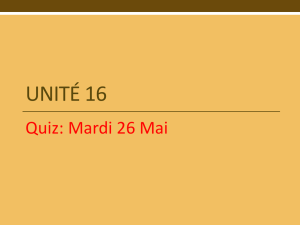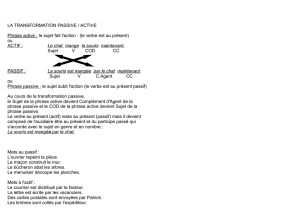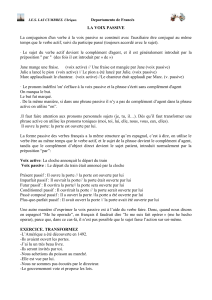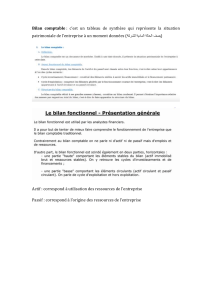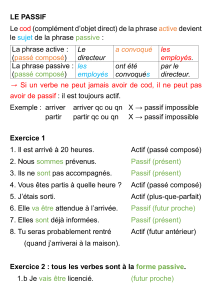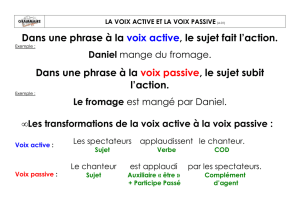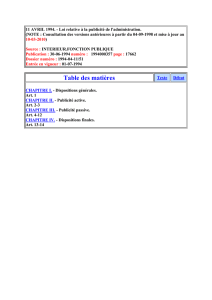La construction se faire+Vinf : analyse modulaire et contrastive

La construction se faire+Vinf : analyse fonctionnelle
La constructions se faire+Vinf a été analysée de différentes façons. Pour certains
auteurs (Spang-Hanssen 1967, Riegel et all 1993) il s’agit d’une forme de passif. D’autres
(Tasmowski & Van Oevelen1987) proposent un traitement unitaire : malgré des valeurs très
similaires à la construction passive, le tour reste causatif. D’autres encore (Kupferman 1995)
optent pour une analyse binaire : construction causative pronominale et passive. La plupart de
ces travaux mettent en avant un argument sémantique commun, à savoir que le sujet de se
faire +Inf aurait une part de responsabilité dans le procès dénoté par l’infinitif, qui reste
cependant difficilement démontrable dans les procès « désagréables ». L’analyse syntaxique
de la construction est souvent reléguée au second plan. Rares sont enfin les études (Gaatone
1983) qui induisent la valeur passive de se faire+Vinf à partir de facteurs pragmatiques.
L’objectif de cette communication sera de proposer une analyse fonctionnelle de se
faire+Vinf qui articule les paramètres syntaxiques, sémantiques et pragmatiques dans le calcul
de la signification de la construction. Les données seront analysées dans le cadre de
l’approche modulaire (Noelke 1999). Je comparerai la fréquence et les valeurs de se
faire+Vinf dans des textes littéraires (Frantext), des textes journalistiques (Le Monde 1994) et
des messages de forums (sur l’enseignement, l’interdiction de fumer) (Internet , 2006).
Ainsi, dans certaines distrubutions, se faire+Vinf n’est pas interchangeable avec le
passif (Trois kamikazes se sont fait exploser dans la banlieue), contrainte syntaxique due au
verbe intransitif. Dans d’autres contextes, les deux constructions sont interchangeables : Pour
gagner les élections, il faut se faire aimer / être aimé des Français, avec un sujet instigateur
actif du procès pour le causatif pronominal et un sujet passif « subissant » le procès pour le
passif. C’est donc le rôle sémantique du sujet qui, dans ce cas, motive le choix de la
construction. Enfin, l’articulation entre les visées discursives et la construction syntaxique
(thématisation du cod, du coi) permet d’expliquer des cas comme Il s’est fait offrir un livre,
où le locuteur fait du destinataire (ou bénéficiaire) du procès le thème de l’énoncé. Il s’agit là
d’un procédé qui pallie l’absence de passif oblique en français (He was offered a book).
Suite à cette analyse fonctionnelle, j’essaierai de répondre à la question suivante: y a -
t-il deux constructions se faire +Vinf (pronominale et passive) ou une seule construction
causative qui a des valeurs passives dans des conditions de sélection syntaxique, sémantique
et pragmatiques bien précises ? Plutôt d’y voir une homonymie de formes et scinder le tour en
deux, j’opterai pour une analyse unitaire à travers un continuum allant de l’actif au passif
(Bat-Zeev Shyldkrot 2005). On pourrait y ajouter un argument d’ordre diachronique : à partir
d’une valeur causative, l’interprétation passive se serait développée par l’intermédiaire d’une
réflexivisation.
Bibliographie :
Bat-Zeev Shyldkrot H. (2005) « Comment définir la périphrase ‘se laisser+inf’ », Lingvisticae
Inversitationes Supplementa 25.
François J. (2000) « Désémantisation verbale et grammaticalisation , (se)voir employé comme
outil de redistribution des actants », Syntaxe & Sémantique No 2, 2000.
Gaatone D. (1983) « Le désagréable dans la syntaxe », Revue Romane 18 / 2.
Kupferman L. (1995) « La construction passive en « se faire », Journal of French Language
Studies 5.
Noelke H. (1999) « Linguistique modulaire : principe méthodologiques et applications »,
Approches modulaires, Noelke &Adam (dir), Lausanne.
1
/
1
100%