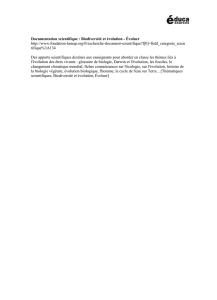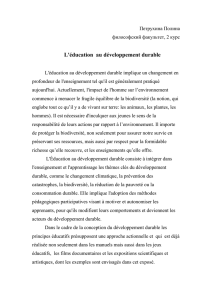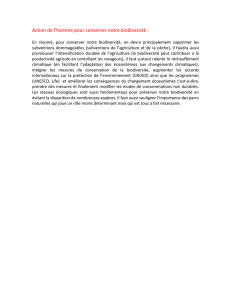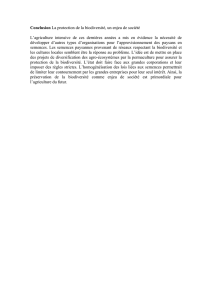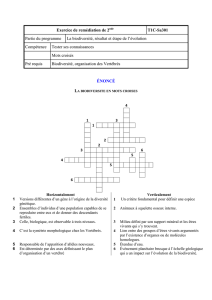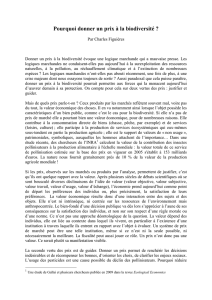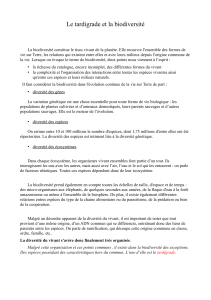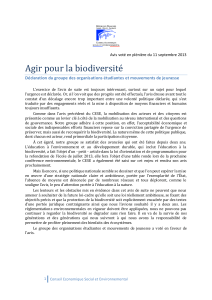Conservation et développement

75.jpg ¬
Biodiversité
Conserver pour qui ?
SOMMAIRE>
Lisez les
articles en
ligne
Lire des revues
de presse
sur le
numéro
Laisser un
commentai
re sur le
numéro
Conservation et développement
Laurence Tubiana et Sélim Louafi, Institut du développement durable et des
relations internationales.
E
spèces menacées", " forêts en danger ", " écosystèmes fragilisés ", etc. : les
qualificatifs alarmistes ne manquent pas pour décrire les menaces, certes réelles,
qui pèsent sur le monde vivant dans toutes ses dimensions (gènes, espèces,
écosystèmes).
Pourtant, lorsque le concept de biodiversité est apparu au milieu des années 80, il
s'agissait surtout pour les scientifiques (naturalistes et écologues essentiellement)
de convaincre le monde politique de s'attacher à la diversité du vivant dans son
ensemble plutôt qu'à des espèces emblématiques isolées ou à leur habitat. La
préoccupation initiale était de mettre en place une coordination internationale pour
la gestion de la biodiversité, considérée comme un patrimoine commun de
l'humanité.
Il s'agissait aussi de prendre en compte les interactions de l'homme avec le monde
vivant dans toute définition d'outils de gestion de la biodiversité.
Une des conséquences spectaculaires de ce tournant conceptuel - pourtant
insuffisamment soulignée - a été d'intégrer de manière pleine et entière les
préoccupations de développement des pays du Sud, les plus riches en biodiversité.
Si bien qu'aujourd'hui, la Convention sur la diversité biologique (CDB), ouverte à la
signature à Rio en 1992 lors de la Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement, est sans nul doute l'accord international
environnemental dans lequel les pays en développement (PED) se sentent les plus
investis et où ils ont développé de grandes capacités d'expertise.
Par ailleurs, la CDB est porteuse d'innovations dans trois domaines : le lien fait
entre l'utilisation durable des ressources naturelles et leur conservation ;
l'introduction de la notion d'équité dans la définition des droits d'accès et de
propriété dans le domaine du vivant et, enfin, la reconnaissance des savoirs
traditionnels et des peuples indigènes.

La première manifestation de la modernité de cette convention porte donc sur le
renouvellement de l'idée même de conservation. Les travaux des anthropologues et
des ethnobotanistes ont montré le caractère construit et dynamique de la
patrimonialisation : la nature est également le produit d'une interaction avec les
activités humaines. Conserver tel ou tel paysage, espèce, variété ou savoir
particulier sur la nature est presque toujours un choix collectif. Aussi, la
conservation de la biodiversité est d'autant plus efficace que ces choix n'ont pas été
imposés de l'extérieur suivant des critères strictement scientifiques ou politiques.
Redéfinition des modes de conservation
Cette approche relègue les conceptions purement conservationistes à une vision
figée et nostalgique de la nature, sorte de patrimoine donné qu'il conviendrait de
transmettre inchangé aux générations futures. Elle entraîne des conséquences
pratiques et politiques : sans association des populations locales et des usagers et
sans prise en compte de leurs intérêts respectifs, la biodiversité a peu de chances
d'être conservée efficacement sur le long terme.
En terme de gouvernance, on est passé progressivement d'une volonté initiale de
coordination internationale sur une base scientifique, avec des outils
essentiellement réglementaires (définition de taxons ou d'aires à protéger), à une
coordination internationale centrée sur des questions d'équité qui se jouent dans
l'accès et l'utilisation des ressources biologiques. La définition de la conservation en
tant qu'enjeu global change donc de nature, marginalisant tout un courant qui avait
initialement porté cette question sur l'agenda international.
Cette dimension a abouti à la seconde innovation instaurée par la CDB, à savoir
qu'il n'y aurait pas de conservation de la biodiversité sans développement et
partage équitable des avantages tirés de l'exploitation de ses éléments. A la fin des
années 80, avec l'apparition d'enjeux économiques dans l'utilisation des ressources
biologiques liés aux progrès des biotechnologies, la diversité biologique fut
présentée comme une réserve de gènes et d'organismes qu'il fallait conserver pour
pouvoir les commercialiser. Quelque soit le jugement que l'on porte sur ce projet de
nature marchande, la conséquence immédiate a été l'abandon de la conception des
ressources biologiques comme patrimoine commun en accès libre et gratuit, à la
fois par la communauté préservationniste et celle des agronomes.
>Il n'est pas inutile en effet de rappeler que la pratique de l'amélioration des
plantes dans le monde agricole s'est faite sur la base de la disponibilité d'une vaste
gamme de ressources génétiques comprenant à la fois les ressources anciennes et
les variétés améliorées.
>C'est l'accent mis sur la question de l'accès, comme lieu et moment où se créé la
valeur économique de la ressource, qui a conduit à affirmer la souveraineté des
Etats sur leurs ressources pour qu'ils puissent en commercialiser l'accès et en tirer
par là même des incitations à la conserver.
>Enfin, le troisième apport de la CDB réside dans le statut attribué à des
communautés locales, à des minorités culturelles et à des peuples, souvent ignorés
ou réprimés par des gouvernements soucieux de contrôler leur territoire. Ces
groupes ont réussi à faire reconnaître leur apport à la connaissance et à la
conservation de la biodiversité. Ils négocient dans ce cadre international la défense

de leurs modes de vie, de leurs savoirs ou de leurs droits sur l'espace comme une
des conditions de leur contribution au bien commun.
>La question des savoirs naturalistes locaux oblige à penser le lien entre l'accès
aux ressources et l'usage de ces ressources à l'échelle locale (de la même manière
que la question de la valorisation a induit l'idée d'un lien entre accès et équité à
l'échelle nationale). >lire Meriem Bouamrane et Natarajan
Ishawaran: Réconcilier les intérêts. Au-delà des oppositions trop
souvent simplistes entre appropriation privée et souveraineté des Etats à propos de
la gestion des biens communs, on a pris conscience qu'il fallait s'intéresser plus en
détail aux formes d'usage intermédiaire, elles aussi créatrices de normes et,
surtout, garantes d'une certaine efficacité. Les connaissances, innovations et
pratiques des communautés autochtones et locales entrent dans cette catégorie des
formes d'usage intermédiaire avec lesquelles le cadre international formel de
négociation n'a jamais eu l'habitude d'interagir.
>Les discussions qui résultent de la nécessaire prise en compte de la diversité des
règles d'accès, des systèmes juridiques et des pratiques de conservation et
d'utilisation conduisent à une réflexion sur le moyen de mieux articuler les
différents échelons de gestion de la biodiversité. Plus que tout autre sujet de
négociation internationale sur l'environnement, la biodiversité renvoie en effet à
une multitude de situations locales très diverses, notamment pour la prise en
compte des savoirs et pratiques liés à la biodiversité. Cette subsidiarité, au sens
large, a permis de renouveler en profondeur l'approche classique de division
verticale des responsabilités : acteurs locaux gérant des ressources locales, acteurs
nationaux élaborant des politiques publiques et Etats négociant les normes
internationales.
Associer les nouveaux acteurs
La notion d'équité, en lien avec le contrôle des ressources biologiques et génétiques
par les Etats détenteurs, est une pierre dans le jardin des systèmes de droit de
propriété intellectuelle. Elle ouvre le débat sur la compatibilité des accords de
l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle avec les objectifs de la CDB. >lire Anil K. Gupta: Protéger
pour partager.
Pour jeter les bases d'un règlement équitable de l'utilisation des ressources
biologiques, il convient de reconnaître que les difficultés posées par les droits de
propriété intellectuelle ne se limitent pas au seul problème technique d'application
de normes juridiques. Or, jusqu'ici, les réponses apportées n'ont suivi que deux
pistes : l'aménagement du système existant des droits de propriété intellectuelle
(combinaison de différents types de droits, ré-interprétation des critères de
protection, création de droits spécifiques dits sui generis) ou bien le développement
de nouveaux outils en complément des droits de propriété intellectuelle.
Mais si l'on décide de prendre en compte la nécessité de promouvoir d'autres
valeurs sociales telles que la libre détermination des peuples, l'équité, la
redistribution de bien-être et la préservation d'identités culturelles (autant de
valeurs attachées, qu'on le veuille ou non, à la préservation de la biodiversité), les
ressources juridiques existantes dans le champ de propriété intellectuelle s'avèrent

clairement insuffisantes.
Sans doute victime de son propre succès et de sa volonté d'affronter la
conservation dans sa complexité, la CDB peine à trouver une efficacité et une
lisibilité extérieure. Cantonnée à une discussion d'experts, redécoupée en une
multitude d'enjeux sectoriels, soumise à des revendications qui dépassent ses
propres compétences, elle exaspère et décourage souvent ceux qui, malgré tout,
restent sensibles au rythme d'appauvrissement accéléré de la diversité biologique.
Dans le contexte actuel de crise du multilatéralisme, certains s'interrogent sur
l'utilité de telles négociations et parlent de revenir à des conceptions plus simples
de la conservation, qui prônent un retour à des mesures réglementaires excluant de
facto ou de jure toute intervention humaine sur la nature. D'autres encore
proposent de conduire des opérations de conservation sur grandes échelles,
choisies à partir des données scientifiques : la mise en défense, excluant les
usagers traditionnels, étant considérée comme plus efficace que les projets de
conservation associant les populations locales.
Ce retour de balancier est sans doute ce qui menace le plus l'avancée des
discussions internationales et la mise au point de solutions durables. Cette
tendance bénéficie malheureusement d'appuis financiers importants provenant de
fondations, d'agences de développement bilatérales et multilatérales et
d'entreprises privées, convaincues de la justesse de l'approche par de grandes
organisations de protection de l'environnement >lire Mac Chapin: Le défi
indigène.
Pourtant, il nous paraît illusoire et inefficace de traiter de conservation en ignorant
les questions politiques d'équité et de développement, seules garanties d'une plus
grande efficacité à long terme de la conservation. Toute autre approche, et le rêve
néocolonial de certains conservationnistes en est un exemple, manque
particulièrement de réalisme. Combien d'aires protégées souffrent de conflits
relatifs à l'usage des ressources naturelles, ce qui compromet leur efficacité ? Et
quand bien même ces conflits seraient apaisés (de gré ou de force, par exemple en
déplaçant des populations), l'appel constant à la générosité des donateurs peut-il
faire office de politique de long terme ?
La conservation de la biodiversité passe par un accord avec les PED dont le rôle n'a
cessé de croître dans la définition des règles du jeu mondial. Il passe aussi par le
fait de reconnaître qu'au-delà des questions juridiques (règles nationales d'accès,
harmonisation des droits de propriété intellectuelle) et des inévitables conflits de
normes et de valeurs qu'elles suscitent, il convient de trouver les moyens de mieux
comprendre et de s'appuyer davantage sur le réseau d'acteurs et d'institutions dont
la mise en œuvre des solutions dépendra in fine. C'est la grande leçon apportée par
ces nouveaux acteurs évidents que sont les communautés autochtones et locales.
Mais c'est aussi celle dont sont potentiellement porteurs de nombreux acteurs, qui
restent pourtant encore complètement absents de ces débats sur l'accès et le
partage des avantages ou se contentent d'un rôle de lobbyiste. C'est à cette
condition que la communauté internationale préoccupée par la biodiversité

parviendra à concilier efficacité économique (investissement et innovation dans les
ressources biologiques) et légitimation sociale (conservation, préservation
d'identités culturelles, équité).
1
/
5
100%