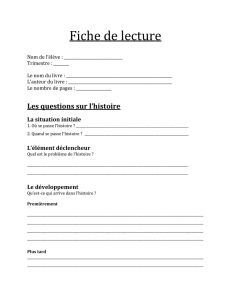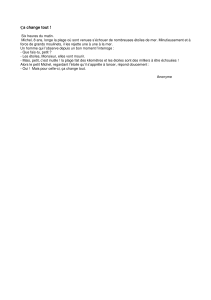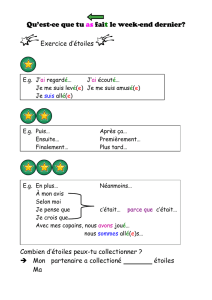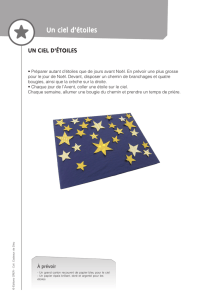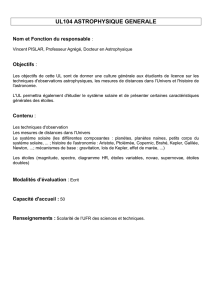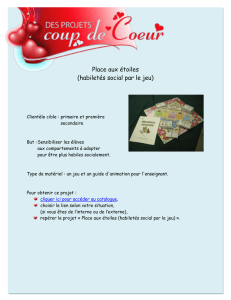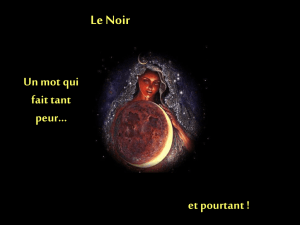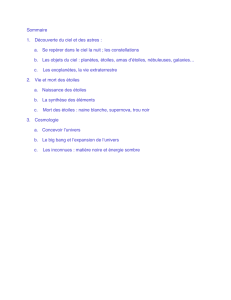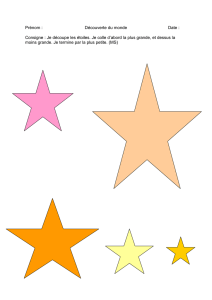mieux comprendre notre univers

POUR COMPRENDRE L'UNIVERS
MIEUX COMPRENDRE NOTRE UNIVERS
PAR L’ÉTUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DES ÉTOILES GÉANTES
Sophie Van Eck
1 COMPRENDRE LES ÉTOILES
La compréhension de la
composition chimique des étoiles
et la connaissance de leurs
distances sont fondamentales
pour déduire la masse des étoiles
– donc prédire leur évolution.
Nous pouvons ainsi appréhender
comment les étoiles, véritables
usines à fabriquer des atomes,
enrichissent l’univers d’éléments
lourds.
Des informations cruciales
n o t a m m e n t p o u r m i e u x
comprendre l’évolution chimique
et le devenir des galaxies
formées de milliards d’étoiles, et
en particulier le futur de notre
propre galaxie, la Voie Lactée.
Née en 1971. Docteur en physique
(1999), Ingénieur physicien (1995).
Chercheuse Qualifiée au FNRS et
Chercheuse à l’Institut d’Astronomie et
d’Astrophysique de l’ULB. Experte au
Comité d’allocation de temps du
télescope de l’ESO (Observatoire
Européen Austral, Chili). Responsable
du groupe de travail chargé d’analyser
les étoiles atypiques qui seront
détectées dans le cadre du
recensement Gaia-ESO. Nous lui
devons notamment la découverte des
premières étoiles au plomb, deux
étoiles S symbiotiques et les premières
abondances précises dans les étoiles S.
Sophie a notamment reçu le Prix du
Fonds International Wernaers (FNRS)
et le Prix Paul et Marie Stroobant
(Académie Royale de Belgique).
Sophie Van Eck
Ce projet permettra de mieux
comprendre l’évolution chimique
des galaxies, véritables univers-îles
peuplés de milliards d’étoiles

2 LE DEFI : DES COMPOSITIONS ULTRA-PRÉCISES
Les étoiles sont les alchimistes
de l’Univers. En effet, le Big Bang
n’a produit que les éléments les
plus légers, durant les premières
minutes de l’Univers où la
température était encore
suffisamment chaude pour
fa bri q u e r de s él ém e nt s
chimiques. Mais quasiment tous
les éléments plus lourds que
l’hélium sont produits au cœur
des étoiles, par des processus
encore mal contraints. Ces
éléments sont amenés, par
mélange convectif, à la surface
des étoiles, où ils deviennent
accessibles à l’observation.
La coupole du télescope Mercator, à
l’Observatoire de La Palma, sur lequel
l’Institut d’Astronomie et d’Astrophysique
a du temps d’observation garanti, suite à
son importante implication dans la
construction du spectrographe équipant
ce télescope.
La composition chimique des
étoiles s’obtient grâce à des
spectres (c’est-à-dire la lumière
de l’étoile fortement dispersée et
résolue en longueur d’onde grâce
à un spectrographe). Ces
dernières années, plusieurs
spectrographes haute-résolution
extrêmement performants ont
été développés et permettent
d’obtenir des compositions
chimiques de précision inégalée.
L’Institut d’Astronomie et
d’Astrophysique de l’ULB utilise
en particulier les spectrographe
de l’ESO (European Southern
3 UN PROJET A DEUX VOLETS: GAIA-ESO et HERMES
Observatory, basé au Chili) et le
s p e c t r o g r a p h e H E R M E S ,
c o n s t ru it g r â c e à u n e
collaboration entre l’ULB, la
KULeuven et l’Observatoire Royal
de Belgique, et installé à La
Palma (Espagne).
Le projet de Sophie Van Eck porte
sur l’étude de la composition
chimique des étoiles géantes. Il
se fonde sur la modélisation
d’atmosphè re s st e l l aires
d’étoiles à composition chimique
non-standard. Sophie Van Eck fait
partie des rares chercheurs
européens spécialistes en cette
matière.
Son projet comporte deux volets
principaux:
1. LE PROJET « GAIA-ESO
SURVEY »
Le projet « GAIA-ESO Survey »
est un « Large Programme »
accepté par l’ESO (European
Southern Observatory) qui
c o n s i s t e à o b s e r v e r
spectroscopiquement plus de 100
000 étoiles sur 5 ans, et qui
couvre les compos antes
principales de la Voie Lactée,
depuis les régions de formation
stellaire jusqu’aux vielles étoiles
du halo. Il fournira à terme une
vue homogène de la cinématique
(m o u v e m en t s ) et d e la
composition chimique des
é t o i l e s , e t s e r a a i n s i
complémentaire de la mission
spatiale GAIA (ESA).
Sophie Van Eck est coordinatrice
du groupe de travail du GAIA-
ESO Survey concernant les objets
non-standards.
Il s’agit de :
- détecter les objets atypiques
- les caractériser (température,
gravité, composition chimique,
statut évolutif, etc…)
Il est fondamental d’interpréter
ces données avant qu’elles ne
tombent dans le domaine public
(courant 2015).

La binarité est un phénomène
très répandu : en effet, plus de la
moitié des étoiles de notre
Galaxie appartiennent à des
systèmes binaires (ou multiples) :
elles possèdent une étoile
compagnon qui est liée
gravitationnellement (elles
tournent toutes deux autour de
leur centre de gravité commun).
Lorsque ces étoiles sont
suffisamment proches l’une de
l’autre, leur évolution peut s’en
trouver considérablement
perturbée (échange de matière,
fusion). Sophie Van Eck exploite
ces particularités pour tester
l’évolution des étoiles : c’est ainsi
qu’elle a découvert les étoiles au
plomb (Nature, 2001) et mesuré
la température au cœur des
étoiles S (Nature, 2015).
UN FINANCEMENT CATALYSEUR
Le financement de la Fondation
ULB aura un rôle catalyseur en :
> Rassemblant à l’ULB un noyau
d’expertise en spectroscopie
stellaire constitué d’une équipe
internationale de chercheurs;
> Fédérant efficacement les
expertises déjà présentes à l’ULB
(nucléosynthèse, évolution
stellaire, atmosphères stellaires,
observations sur les grands
télescopes spatiaux et au sol) en
un tout cohérent centré sur une
thématique de recherche
ambitieuse et d’actualité.
L’EQUIPE S’ENGAGE A:
> Former des étudiants via des
encadrements de mémoires et de
thèse de doctorats (dont le
financement sera sollicité via les
c a n a u x h a b i t u e l s :
F.N.R.S.,F.R.I.A., E.S.O.);
> Diffuser les résultats afin
d’assurer la reconnaissance
internationale de l’expertise
acquise, via :
1. La participation à des
conférences internationales;
2. La publication d’articles dans
des revues internationales à haut
facteur d’impact;
> Evaluer régulièrement
l’avancement du projet, via un
site internet dédié (wiki) et la
publication de rapports annuels.
2. Le projet HERMES
Le spectrographe HERMES a été
c o n s t ru it g r â c e à u n e
collaboration entre l’ULB (via le
FNRS), la KULeu ven et
l’Observatoire Royal de Belgique.
L’ULB bénéficie de temps garanti
sur ce spectrographe. Le but de
ce projet est de mieux
comprendre les liens entre
binarité et composition chimique.
La constellation d'Orion, bien visible depuis
l ' h é m i s p h è r e N o r d .
La température à la surface des étoiles peut
aisément être déterminée par leur couleur: par
exemple, Betelgeuse (3600 degrés) apparait rouge
et Bellatrix (21 000 degrés) bleue. En revanche,
mesurer la température
à l'intérieur des étoiles
constitue un véritable défi. La constellation d'Orion
contient justement deux étoiles géantes rouges de
type S étudiées récemment par Sophie Van Eck.
L'une, V1261 Orionis, a permis d'estimer la
température de la fabrication des éléments plus
lourds que le fer au coeur des étoiles (environ 100
millions de degrés). Il a été démontré que l'autre,
o1 Orionis, produit ces éléments lourds depuis 1.3
millions d'années.

RESSOURCES HUMAINES
1 Chercheur post-doctorant
1 chercheur post-doctorant
264.000 €
264.000 €
FONCTIONNEMENT
Matériel informatique et
échanges scientifiques.
25.000 €
553.000 €
BUDGET TOTAL
Le Pr. Sophie Van Eck est
m e m b r e d e l ’ I n s t i t u t
d’Astronomie et d’Astrophysique
de l’ULB. Celui-ci s’est
considérablement développé au
cours des 20 dernières années, et
s’est forgé une réputation
internationale pour ses études
sur la composition chimique des
étoiles.
Toute la palette d’expertises
complémentaires nécessaires à
l a c o m p r é h e n s i o n d e s
abondances stellaires est réunie
en un même lieu :
> prédictions théoriques
d’abondances stellaires à l’aide
de modèles d’évolution stellaire
et de nucléosynthèse ;
> observations sur les plus
grands télescopes au sol et
spatiaux [Mercator (La Palma),
VLT (ESO), Herschel, GAIA, …] et
réduction des données;
> déterminations d’abondances
à l ’ a i d e d e m o d è l e s
d’atmosphères performants et de
codes semi-automatiques.
L’abondance de données
observationnelles récoltées ces
dernières années requiert une
équipe plus importante de
chercheurs à même d’analyser
ces données. Le but du présent
projet est d’atteindre la masse
critique permettant d’exploiter
ces données et d’attirer de
nouveaux talents à l’Institut
d’Astronomie et d’Astrophysique.
4 DES AVANCEES MAJEURES DE L’ASTROPHYSIQUE A l’ULB
Avancées majeures réalisées à l’Institut
d’Astronomie et d’Astrophysique de l’ULB:
> Compilation NACRE des réactions nucléaires
d’intérêt astrophysique (1999, 2005) >
Découverte des étoiles au fluor (1992) >
Découverte des étoiles au plomb (2001, 2003) >
Structure et nucléosynthèse des étoiles
primordiales (2002) > Etude holistique des
étoiles CEMP > Première grille de modèles
d’atmosphères d’étoiles S (2013) > Découverte
de thermomètre et de chronomètre stellaire
(2015)
5 BUDGET / 3 ANS
RESSOURCES HUMAINES
L’Institut d’Astronomie et
d’Astro ph ys i que souhaite
engager 2 post-doctorants
experts en spectroscopie
stellaire.
FONCTIONNEMENT
Les déterminations automatiques
de composition chimique de
grands ensembles d’étoiles (105)
sont extrêmement exigeantes sur
le plan informatique. Les
ordinateurs du CECI (Consortium
des Equipements de Calcul
intensif du FNRS) seront utilisés.
Pour les tâches routinières ou les
analyses d’étoiles individuelles.
Pour plus d’informations : Fondation ULB – Av. F. D. Roosevelt, 50, CP 130 – B - 1050 Bruxelles
Le Very Large Telescope
de l’Observatoire
Européen Austral (ESO)
au Chili.
1
/
4
100%