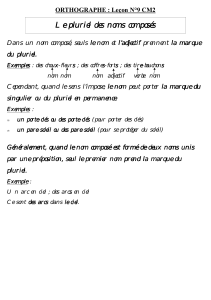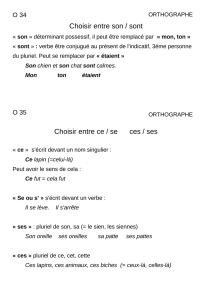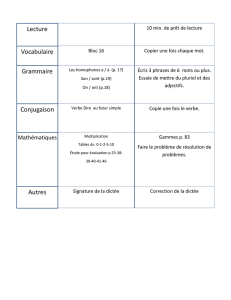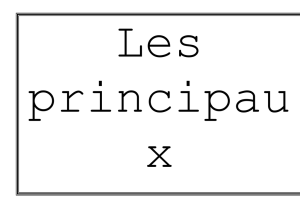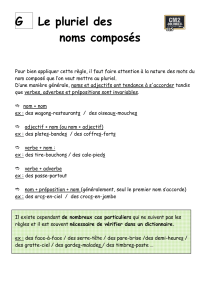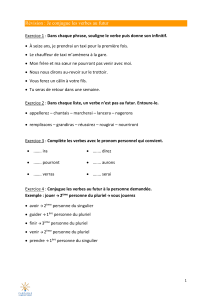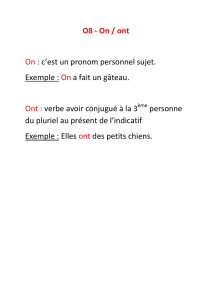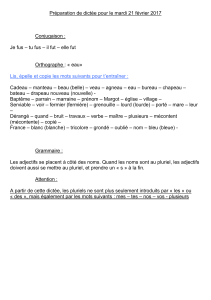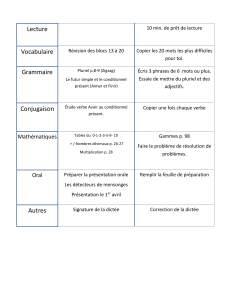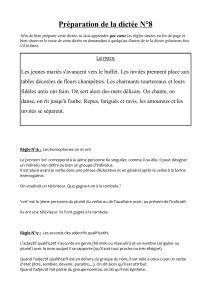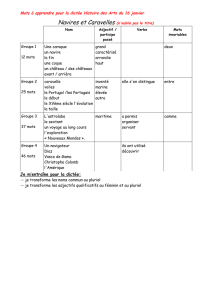Les marques grammaticales - sien-unsa

Les élèves de 2005 et la dictée (DANIÈLE MANESSE)
La partie qui suit va présenter la dictée Les Arbres et les résultats des élèves de 2005 comparés à ceux
des élèves de 1987. Elle le fera de deux points de vue.
– Dans une perspective quantitative, on répondra à la première question qu’on est en droit de se poser :
comment ont évolué ces résultats en à peu près vingt ans ?
– Suivra l’analyse des résultats des élèves du point de vue de la nature des erreurs qu’ils ont commises.
On verra ainsi que la baisse de résultats qui est intervenue entre les deux enquêtes tient essentiellement
à l’augmentation significative d’un type d’erreur.
Le texte de dictée sur lequel repose la comparaison du niveau des élèves entre 1987 et 2005 est un court
passage de Fénelon, de 83 mots, composé de quatre phrases.
Il est extrait du Traité de l’existence de Dieu, écrit par Fénelon entre 1701 et 1712, et publié pour la
première fois en 1713, sous le titre Démonstration de l’existence de Dieu, tirée de la connaissance de la
nature & proportionnée à la faible intelligence des plus simples… Nous ne revenons pas ici sur ce qui
avait guidé le choix qu’avait fait l’inspecteur Beuvain… Contentons-nous d’exposer les caractères de ce
petit texte pour comprendre comment les élèves de 2005, comme ceux de 1987, ont pu le recevoir.
Le texte de la dictée
« Les arbres s’enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs
branches s’élèvent vers le ciel. Leurs racines les défendent contre les
vents et vont chercher, comme par de petits tuyaux souterrains, tous les
sucs destinés à la nourriture de leur tige. La tige elle-même se revêt
d’une dure écorce qui met le bois tendre à l’abri des injures de l’air. Les
branches distribuent en divers canaux la sève que les racines avaient
réunie dans le tronc. »
C’est un texte suffisamment bref pour être proposé à des élèves d’âges et de capacités à écrire très
divers. Les problèmes d’accord y sont nombreux et ils nous donneront l’occasion de réfléchir sur certains
grands types des difficultés de l’orthographe « grammaticale ». Les difficultés d’orthographe lexicale n’y
sont pas considérables. En référence à l’échelle Dubois-Buyse
1
, outil de référence commun à l’époque,
on pouvait dire :
« Sur les cinquante-deux mots recensés dans la dictée, trente-quatre appartiennent à des “échelons” de
difficulté inférieurs à 19, c’est-à-dire qu’ils sont normalement acquis à dix ans ; douze appartiennent à des
échelons compris entre 20 et 23, et sont en principe acquis à onze ans ; et quatre présentent des
difficultés présumées maîtrisées à douze ans. Deux seulement, abri et souterrains, ne sont du niveau que
des élèves de treize ans
2
. » Enfin, ce qu’on appelle à l’école les « mots outils », ceux qui charpentent un
texte à raison de 50 % de la totalité des mots, y sont représentés en nombre.
Comme en 1987, nous avons pu observer dans les classes, à l’exception peut-être de celles de CM2, que
« Le texte de la dictée a été généralement jugé facile par les élèves et par les maîtres, souvent rassurés,
un peu vite peut-être, après la première lecture. Mais l’épreuve a montré que, même dans un texte court,
des difficultés inattendues pouvaient s’élever en orthographe à propos de textes classiques dont le sens
exact échappe partiellement aux élèves. »
L’une des caractéristiques de la dictée Les Arbres est en effet sa langue très « classique ». Le propre de
la langue classique est qu’elle n’affirme pas ouvertement son étrangeté comme le fait, par exemple,
l’ancien français. Ainsi, tous les mots sont connus des élèves, plus ou moins, à une ou deux exceptions
près pour les plus jeunes. Mais le décalage de sens qu’ils présentent, qu’il soit important ou minime,
associé à des tours de syntaxe inhabituels, perturbe les processus de mise en place de l’orthographe.
De ce fait, le texte présente un certain nombre de difficultés sournoises, qui, pour n’être pas forcément
toutes des difficultés orthographiques, n’en gênent pas moins la perception du sens. Parmi ces difficultés,
on citera :
– « comme leurs branches… » (première phrase) : aucun problème particulier d’orthographe ; mais ce
type de propositions de comparaison est déroutant (quel sens donner à comme ?).
– « leur tige » : qu’est-ce qu’une tige d’arbre ? se demandera peut-être encore l’élève. Entre le tronc, la
branche, le rameau, il pourra hésiter. D’autant que l’usage a tranché depuis longtemps. On n’utilise plus le
mot tige pour désigner le tronc comme le faisait encore, en 1694, le Dictionnaire de l’Académie : « La
partie de l’arbre ou de la plante qui sort de la terre, & qui porte les branches et les feuilles. » Littré lui-

même, malgré son goût prononcé pour l’archaïsme, avait rendu compte de ce changement.
– « se revêt » : le verbe est rare et on en verra le témoignage dans la fuite massive vers un quasi-
homophone…
– « une dure écorce » : même incompréhension, en français, on dit une « écorce dure » et l’antéposition
de l’adjectif a posé un problème.
– « des injures de l’air » : curieuse acception du mot pour les élèves…
– « distribuer, réunir de la sève » : expressions pour le moins déconcertantes, ces deux verbes étant
habituellement employés avec des objets ou des personnes qu’on peut compter, ce qui n’est pas le cas
de la sève ! Même perplexité, chez les élèves, concernant les sujets : comment des branches pourraient-
elles « distribuer », et les racines « réunir » quoi que ce soit ?
– « en divers canaux » : double difficulté. Canal est technique ou désuet dans ce sens. Quant à divers, il
est ici impropre et ne peut que troubler les élèves, ceux du moins qui maîtrisent le mot : il signifie «
plusieurs, pris sur un ensemble plus large », et l’on voit mal pourquoi les branches ne diffuseraient pas la
sève sur tous les canaux.
Enfin l’obstacle que présentait l’accord du participe passé réunie, par exemple, était ainsi commenté en
1989 : « Les difficultés du sens sont, dans cette phrase, telles que même un élève bien entraîné à l’accord
“avec le complément d’objet direct s’il est placé avant” peut échouer à trouver la forme correcte, tout
simplement parce que le sens ne lui permet pas d’identifier d’une manière plausible le sujet et le complé-
ment d’objet. »
Et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les jeunes Français de 1873 n’étaient pas plus familiers avec
la langue écrite de 1710 que ne l’étaient ceux de 1987 ! La chronologie, ici, ne fait pas grand-chose à
l’affaire. Les grandes mutations de la langue, entre le français classique et le français moderne, ont déjà
eu lieu à l’époque de Beuvain, et tout porte à croire que l’étrangeté de la langue classique est ressentie
de la même façon par les élèves au cours des trois enquêtes : celle de Beuvain, celle de 1987, celle de
2005 enfin. On verra en effet dans la troisième partie que les mots de la dictée peu réussis, voire
incompris dans le texte Les Arbres, l’ont été dans les trois enquêtes.
62
Les difficultés orthographiques : des fautes d’inégale importance
(DANIÈLE COGIS, DANIÈLE MANESSE, CHRISTINE TALLET, MICHÈLE DORGANS)
Il en va de la maîtrise de l’orthographe comme de la maîtrise du langage, ou plus généralement de bien
des fonctions humaines : une fois acquises, leur évidence masque les processus complexes qui les sous-
tendent : « D’une manière générale, les adultes alphabétisés, et à plus forte raison l’expert, n’ont pas
vraiment conscience des opérations mentales qui sous-tendent la compétence orthographique . » Ce long
chapitre est donc un parcours, nécessairement un peu technique, mais que nous avons souhaité le plus
explicite possible, des caractéristiques de divers domaines orthographiques que notre classification
qualitative des erreurs nous permet de traiter séparément.
96
Comme les résultats de la deuxième partie l’ont montré, l’orthographe grammaticale est la zone à haut
risque. Que ce soit l’accord entre le verbe et le sujet ou au sein du groupe nominal, la conjugaison,
l’infinitif en er ou le pluriel de certains noms, sans oublier le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir,
la dictée Les Arbres propose quelques solides problèmes grammaticaux à résoudre, dont manifestement
les élèves de 2005 ne se sortent pas bien.
Rappelons les chiffres : en 2005, les élèves totalisent plus de 19 000 fautes de type grammatical (types 4,
5, 6) contre moins de 8 500 en 1987, alors qu’ils sont moins nombreux de 10 % environ. Mais dire que le
nombre de fautes d’orthographe grammaticale a plus que doublé en vingt ans est un constat général. Que
recouvre ce résultat ? Est-ce à dire, en effet, que les élèves ne savent plus rien aujourd’hui et qu’ils
n’apprennent plus ? Quelles formes, quelles marques, quels accords, qui font la spécificité de notre
orthographe, ignorent-ils ? Que ne connaissent-ils plus que connaissaient leurs prédécesseurs ?
Bref, où en sont vraiment les élèves en ce début de XXIème siècle ?
À ces questions, nous allons nous efforcer d’apporter des éléments de réponse. Après un bref rappel de
la dimension grammaticale de notre orthographe, nous proposerons une étude quantitative et qualitative
des résultats de 2005, d’abord en les comparant à ceux d’il y a près de vingt ans, puis en examinant de
près les mots de la dictée tels que les élèves d’aujourd’hui les écrivent, et, enfin, en observant l’évolution
d’une classe à l’autre.

97
L’orthographe grammaticale : une difficulté majeure
1. - Un système complexe
Les catégories grammaticales
En français, déterminants, noms, adjectifs et verbes sont des mots « variables », c’est-à-dire qu’ils sont
dotés de deux ou plusieurs formes. Les formes sont elles-mêmes déterminées par les catégories
morphologiques de genre, de nombre, de mode, de temps, de personne. Tous les mots ne sont pas
affectés par les mêmes catégories : seuls les verbes varient selon le mode et le temps ; seuls les adjectifs
(et certains noms) peuvent avoir quatre formes, en combinant genre et nombre ; les noms ont un seul
genre (sauf quelques-uns comme photographe), mais la plupart ont les deux nombres. Évidemment, dans
un énoncé donné, une seule forme est sélectionnée. En fonction de ce que l’on veut signifier, on parlera
donc d’un arbre ou des arbres, de la racine ou des racines. On voit ici que le nombre du nom se
différencie du genre, puisqu’il dépend du choix du locuteur, alors que le genre est inhérent au nom et qu’il
ne relève pas d’une décision (un arbre/une tige). L’adjectif, lui, prend la forme que les catégories du nom
auquel il se rapporte lui imposent (une dure écorce) ; il en va de même pour le nombre du verbe qui
dépend du nombre du sujet qui le commande. Il y a donc une relation étroite entre la forme que prend un
mot dans un énoncé et les relations syntaxiques qu’il entretient avec d’autres mots. Un mot est d’ailleurs
quelque chose d’assez abstrait, puisque, quand il figure dans un énoncé, il est nécessairement affecté
d’une valeur grammaticale. Le mot pur, cela n’existe pas, même si l’usage du dictionnaire nous a habitués
à assimiler une des formes du mot au mot lui-même : c’est sous sa forme au singulier que l’on parle d’un
nom, au masculin singulier d’un adjectif, et avec le mode infinitif d’un verbe. Tout cela n’est pas propre à
l’écrit, mais c’est l’apprentissage de l’écrit qui amène à appréhender plus clairement ce rapport
mot/formes.
Sur les 83 mots de la dictée, 64 peuvent être considérés comme variables. Parmi ceux-ci, 37
appartiennent à la classe des noms, verbes, adjectifs : 98
– 11 noms au singulier et 11 noms au pluriel (dont 2 en aux) ;
– 4 adjectifs, soit 2 au masculin, 1 au féminin et 1 adjectif épicène (qui présente la même forme au
masculin et au féminin), ou encore 2 au singulier et 2 au pluriel ;
– 2 verbes à la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif, 5 à la troisième personne
du pluriel du présent de l’indicatif et 1 à la troisième personne du pluriel du plus-que-parfait ;
– 2 participes passés, l’un employé comme adjectif, au masculin pluriel ; l’autre comme constituant
d’un temps composé, au féminin singulier, car il s’accorde avec un complément d’objet direct
placé avant l’auxiliaire avoir ;
– 1 infinitif.
Les déterminants seront traités dans la troisième partie avec les « mots outils ».
À l’écrit, un mot apparaît sous la forme d’une suite de lettres qui lui est propre et qui, à l’exception de
certains homophones, le différencie des autres. Mais les mots variables ont en commun certaines lettres,
celles qui indiquent les catégories de genre, de nombre ou celles qui concernent plus spécifiquement le
verbe. Ainsi, tous les noms au pluriel prennent un s, parfois un x (sauf, bien sûr, s’ils se terminent déjà par
s, x ou z) ; tous les adjectifs au féminin se terminent par un e ; tous les verbes à l’imparfait comportent ait
à la troisième personne du singulier. C’est cette partie de l’orthographe que l’on appelle grammaticale, par
opposition à lexicale, et qui sera traitée dans la prochaine partie.
Les marques grammaticales
Les lettres, dans un système d’écriture alphabétique, servent d’abord à noter des phonèmes. Or ce sont
les mêmes lettres qui sont utilisées comme marques grammaticales : elles changent simplement de
statut. Il faut donc jongler entre des lettres dont le rôle est de transcrire des sons et les mêmes lettres qui
notent des valeurs grammaticales. La variation morphologique qui se pratique tout naturellement à l’oral
quand on parle avec quelqu’un exige à l’écrit une attention extrême.
Par exemple, s a tantôt la valeur d’un /s/ ou d’un /z/, tantôt la valeur d’un pluriel ou d’une deuxième
personne verbale, mais il est alors « muet », sauf quand il reprend du service dans la « liaison » ; la suite
de lettres er transcrit l’enchaînement phonique /åÇÅ/ ou sert de marque à l’infinitif des verbes du premier

groupe qui correspond alors au phonème /e/ comme dans chercher qui réussit l’exploit de réunir les deux
fonctions ; ai note un /å/ comme dans air, ou un imparfait comme dans avaient. Quant au t, tout « muet »
qu’il soit en position finale de petits, vents, revêt, met, avaient, il ne remplit pas la même fonction : marque
de famille lexicale pour petits et vents (petite, éventé) ; marque de famille encore pour revêt et met
(vêtement, émetteur), mais qui est en quelque sorte absorbée par la marque de troisième personne de
toute la conjugaison verbale (cas d’espèces mis à part), seule pour marquer le singulier ou en
combinaison avec la lettre n pour marquer le pluriel comme dans avaient (avai-t/avai-e-nt).
Les principales marques utilisent un petit nombre de lettres : e, s, t, nt, x, er, ai, é. Seules, certaines sont
en relation avec la « chaîne orale » et transcrivent un élément phonique.
Reprenons avaient : 3 phonèmes, mais 7 lettres dont les 5 dernières jouent un rôle grammatical dans une
succession réglée, marque de temps, marque de nombre, marque de personne. Un changement de lettre
finale et c’est une partie du sens qui se modifie (avait/avais) !
Grande différence avec d’autres langues, on le sait, qui ont des marques morphosyntaxiques limitées
comme l’anglais (adjectif invariable, par exemple), ou des marques correspondant à des variations
phoniques comme l’italien (amico/amica vs ami/amie). La forme orale de chercher, par exemple,
correspond à dix formes graphiques différentes (sans tenir compte des différences de prononciation
possibles) : chercher, cherchez, cherché, cherchés, cherchée, cherchées, cherchai, cherchais, cherchait,
cherchaient.
Les stratégies à l’œuvre en orthographe
Les mots de la dictée comportent des marques diverses (petits, tuyaux, dure, distribuent) ou sont
susceptibles d’en comporter dans un autre contexte (écorce, tige, tendre, met). Parmi les erreurs, on
trouve l’absence de marque quand il en faut une (*les vent au lieu de vents), la présence d’une marque
quand il n’en faut pas (*la nourritures), la marque d’une catégorie appliquée à une autre (*destinaient au
lieu de destinés ; *branchent au lieu de branches ; *vons au lieu de vont). Mais si on y regarde de plus
près, on constate que branchent et branches sont deux formes qui indiquent le pluriel, tout comme
destinaient et destinés ; que vent se termine par nt qui, sur d’autres mots, est une marque de pluriel ; que
bois, précédé de l’article singulier le, prend un s. Par ailleurs, un adjectif comme dur prend un e au
féminin, mais tendre ne perd jamais le sien quand bien même il se rapporte à un nom masculin. Ainsi le
groupe le bois tendre aurait de quoi dérouter au regard des règles que la mémoire retient de l’école : on
met un s au pluriel, un e au féminin !
Toutes les marques ne requièrent pas le même travail cognitif, la même dépense d’attention. Elles ne
« pèsent» donc pas d’un poids égal et les erreurs diffèrent selon les cas : là où l’omission est possible
quand une marque ne s’entend pas, cette omission est impossible quand elle s’entend. Par exemple, si
17 % des élèves peuvent écrire destiné sans s, ils sont obligés de transcrire le phonème/e/qui constitue la
marque du participe passé, quitte à l’écrire avec un ai erroné, ce qu’ils sont 5 % à faire. Leur choix
d’ailleurs peut se porter sur é, non pas parce qu’ils ont analysé le mot comme un participe passé, mais
tout simplement parce que é est le graphème le plus fréquent pour noter le phonème /e/.
On est en droit de penser que le ciel, la sève, la terre, sont grammaticalement plus faciles à écrire que les
racines ou des injures, puisqu’il n’y a rien à faire d’autre que d’écrire la partie fixe du mot ; de même ces
derniers sont plus faciles à écrire que leurs branches ou leurs racines, puisque l’homophonie entre leur et
leurs ne permet pas de trancher aussi aisément qu’avec le, la ou les, dont le nombre ne laisse planer
aucun doute. On ne peut donc faire l’impasse sur la réflexion pour déterminer s’il faut apposer une
marque ou non, tantôt en se servant du verbe qui suit (défendent/défend), tantôt en se servant du sens en
l’absence d’indicateur phonique, notamment quand le verbe comporte des formes homophones (élèvent/
élève/élèves).
D’autres cas sont plus ardus encore. En l’absence de différence phonique entre leur tige et leurs tiges,
comment choisir ? C’est la phrase suivante qui détient la clé : en effet, l’enchaînement avec la suite du
texte se fait par la reprise du mot tige, sous la forme du singulier La tige elle-même. Il faut alors avoir
maintenu en mémoire la question portant sur leur tige et revenir en arrière pour finalement décider de
s’abstenir de toute marque (comme en 1987, le pluriel n’a cependant pas été décompté dans les erreurs,
en raison du changement de sens de ce mot).
Ajoutons que, dans une dictée, quand les mots ne sont pas connus ou le sont mal, les renseignements
qui permettraient de trancher ne sont pas toujours objectivement disponibles. C’est en partie le cas de
destinés : comprendre qu’il faut une marque de pluriel se déduit aisément de la présence du déterminant

les devant sucs, mot que l’on peut parvenir à écrire « juste » sans le connaître ; mais, pour savoir si suc
était un nom masculin ou féminin, puisqu’un pluriel fait disparaître l’opposition de genre, il fallait être
attentif à la présence de tous vs toutes devant les. Si on ne connaît pas le mot, et en l’absence de signal
clair constitué par le déterminant, on a donc une chance sur deux de se tromper. On trouve ainsi 7 % des
élèves qui ont fait de suc un féminin en accordant destiné au féminin (avec ou sans marque de pluriel)
sans tenir compte de tous.
2. - Un apprentissage long et difficile
L’orthographe grammaticale est enseignée à l’école dès le cycle 2, c’est-à-dire le CP ou le CE1. Le pluriel
des noms et des verbes, l’accord en genre et en nombre des adjectifs, l’accord sujet-verbe, l’accord du
participe passé, tout figure dans les programmes, les plus récents comme les précédents, de l’école au
collège.
On le constate : très peu d’éléments nouveaux font leur apparition au fil des années ; aucun ne disparaît.
C’est bien parce que l’institution est consciente que les objectifs fixés ne sont pas atteints qu’ils sont
réinscrits à peu près dans les mêmes termes au niveau suivant. Mais ce maintien des mêmes notions
provoque le découragement des enseignants d’avoir toujours tout à reprendre : ceux-ci s’attendent en
effet à ce que les « compétences devant être acquises » le soient ; ils doivent pourtant se rendre à
l’évidence : elles ne le sont pas. La nécessité, pour qu’un savoir s’enracine, de reprises et de répétitions
sous d’autres formes, notamment sous des formes de plus en plus complexes, mériterait d’être rappelée
et davantage explicitée.
103
Toutefois, le participe passé n’est pas vraiment envisagé avant le cycle 3.
Les exemples tirés de la dictée montrent que, si dans bien des cas des automatismes peuvent jouer, le
calcul mental auquel il faut se livrer pour orthographier correctement est souvent complexe. Croire que le
pluriel, parce que les élèves commencent à en appréhender certains aspects dès leur plus jeune âge, est
une notion toujours simple est une erreur. Et le pluriel n’est que l’une des catégories grammaticales à
manier dans un énoncé. Or toutes recèlent des difficultés. Les connaissances nécessaires en français
pour écrire sans faute couvrent en réalité une large partie de la grammaire. Et l’absence de ces
connaissances est à l’origine de nombreuses erreurs comme l’absence de réflexion ou de vigilance.
Programmes des différents niveaux
• Compétences devant être acquises en fin de cycle 2 :
– en situation d’écriture spontanée ou sous dictée, marquer les accords en nombre et en genre dans le
groupe nominal régulier (déterminant, nom, adjectif) ;
– en situation d’écriture spontanée ou sous dictée, marquer l’accord en nombre du verbe et du sujet dans
toutes les phrases où l’ordre syntaxique régulier est respecté.
• Compétences devant être acquises en fin de cycle 3 :
– marquer l’accord sujet/verbe (situations régulières) ;
– repérer et réaliser les chaînes d’accords dans le groupe nominal.
• Programmes de 6ème :
– accords dans la proposition : sujet-verbe, sujet-attribut ;
– accords dans le groupe nominal.
• Programmes de 5ème et 4ème :
– marques du genre et du nombre ;
– accords dans la phrase et dans le texte ;
– marques de l’énonciation (je suis venu/je suis venue).
• Programmes de 3ème :
– accords dans le groupe nominal, dans la phrase verbale et dans le texte ;
– marques de l’énonciation (ex. : je suis venu/je suis venue).
104
Il faut savoir en effet déterminer à tout moment si on est dans le «système nominal» ou dans le «système
verbal», sans oublier que l’adjectif fonctionne comme le nom, tout comme le participe passé dans certains
cas, mais pas dans tous ; il faut savoir identifier l’appartenance d’un mot à une classe grammaticale à
coup sûr ; il faut, pour chaque catégorie, connaître les lettres qui sont des marques grammaticales, avoir
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%